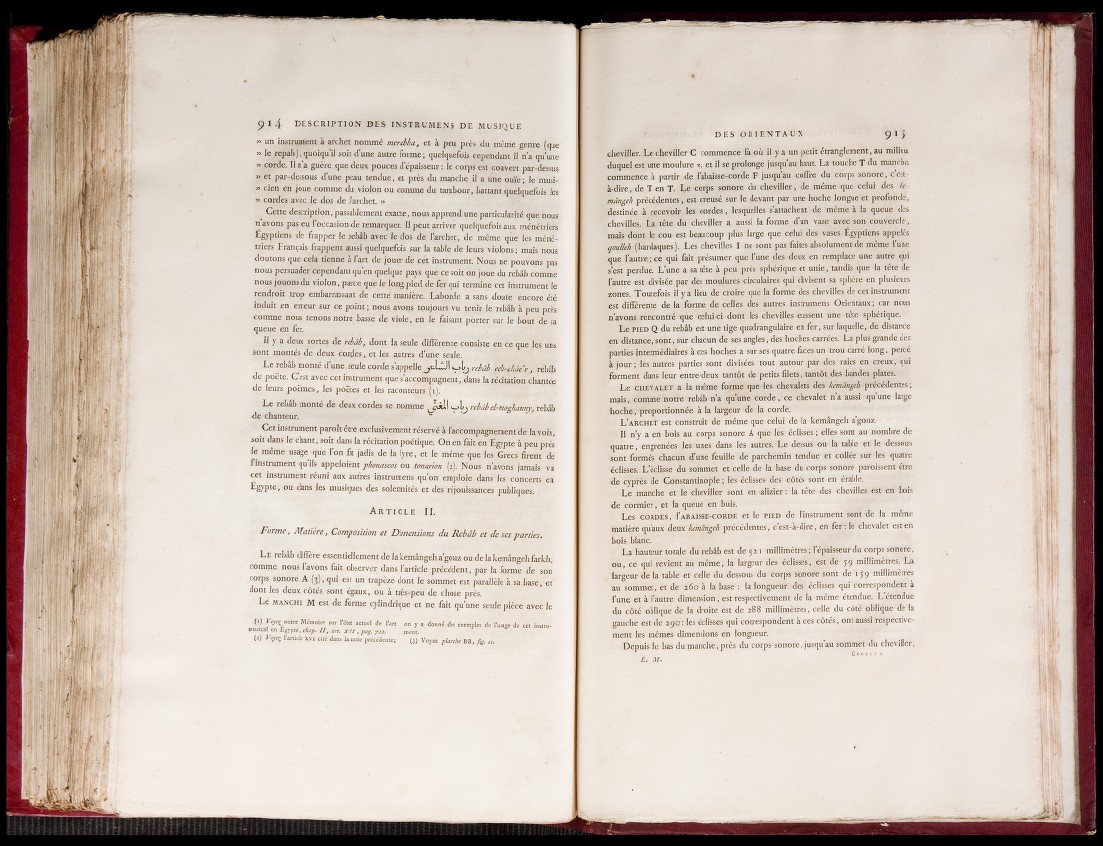
9 I 4 D E S C R IP T IO N DES' INSTRUMENS DE MUSIQUE
” tm instrument a aichet nommé merabba, et s. peu près du même genre (que
» le repab), quoiquil soit dune autre forme; quelquefois cependant il n’a qu’une
» corde. Il n’a guère que deux pouces d’cpaisseur : le corps est couvert par-dessus
» et par-dessous d une peau tendue, et près du manche il a une ouïe ; le musi-
» cien en joue comme du violon ou comme du tambour, battant quelquefois les
» cordes avec le dos de l’archet »
Cette description, passablement exacte, nous apprend une particularité que nous
n avons pas eu 1 occasion de remarquer. Il peut arriver quelquefois aux ménétriers
Egyptiens 'de fiapper le rebab avec le dos de 1 archet, de même que les ménétriers
Français frappent aussi quelquefois sur la table de leurs violons ; mais nous
doutons que cela tienne à l’art de jouer de cet instrument. Nous ne pouvons pas
nous persuader cependant qu en quelque pays que ce soit on joue du rebâb comme
nous jouons du violon, parce que le long pied de fer qui termine cet instrument le
rendioit trop embarrassant de cette manière. Laborde a sans doute encore été
induit en erreur sur ce point; nous avons toujours vu tenir le rebâb à peu près
comme nous tenons notre basse de viole, en le faisant porter sur le bout de sa
queue en fer.
Il y a deux sortes de rebâb, dont la seule différence consiste en ce que les uns
sont montés de deux cordes, et les autres d’une seule.
Le rebâb monté d’une seule corde s’appelle rebâb ecli-cliâe’r , rébâb
de poëte. Cest avec cet instrument que s’accompagnent, dans la récitation chantée
de leurs poëmes, les poètes et les raconteurs (i).
L e rebâb monté de deux cordes se nomme J U i l e -X , rebâbel-moghanny, rebâb
de chanteur.
Cet instrument paroit etre exclusivement réservé à l’accompagnement de la voix,
soit dans le chant, soit dans la récitation poétique. On en fait en Egypte à peu prés
k même usage que l’on fît jadis de la lyre, et le même que les Grecs firent de
1 instrument qu ils appeloiént phonascos ou tonarion (2). Nous n’avons jamais vu
cet instrument reuni aux autres instrumens qu’on emploie dans les concerts en
Egypte, ou dans les musiques des solennités et des réjouissances publiques.
Forme, M atière, Composition et Dimensions du Rebâb et de ses parties.
L e rebab diffère essentiellement de lakemângeha’gouz ou de la kemângeh farkl:
comme nous lavons fait observer dans l’article précédent, par la forme de so
corps sonore A (3), qui est un trapèze dont le sommet est parallèle à sa base, t
dont les deux côtés sont égaux, ou à très-peu de chose près.
Le m a n c h e M est de forme cylindrique et ne fait qu’une seule pièce avec I
(0 notre M émoire sur l’état actuel de l’art on y a donné des exemples de l’usagé musical en Egypte, chap. II, art. x v i , pag. 722.. ment. de cet instru
(2) Koyrj l’article x v t cité dans la note précédente; (3) Voyez planche B B , fig.
cheviller. Le cheviller C commence là où il y a un petit étranglement, au milieu
duquel est une moulure ti, et il se prolonge jusquau haut. La touche T du manche
commence à partir dè l’abaisse-corde F jusqu au coffre du corps sonore, c est-
à-dire, de T en T. Le corps sonore du cheviller, de même que celui des ke •
mânget précédentes, est creusé sur le devant par une hoche longue et profonde,
destinée à recevoir les cordes, lesquelles s’attachent de même à la queue des
chevilles. La tête du cheviller a aussi la forme d’un vase avec son couvercle,
mais dont le cou est beaucoup plus large que celui des vases Égyptiens appelés
qotdleli (bardaques). Les chevilles I ne sont pas faites absolument de même l’une
que l’autre; ce qui fait présumer que l’une des deux en remplace une autre qui
s’est perdue. L ’une a sa tête à peu près sphérique et unie, tandis que la tete de
l’autre est divisée par des moulures circulaires qui divisent sa sphere en plusieurs
zones. Toutefois il y a lieu de croire que la forme des chevilles de cet instrument
est différente de la forme de ceUes des autres instrumens Orientaux; car nous
n’avons rencontré que celui-ci dont les chevilles eussent une tete spherique.
Le p i e d Q du rebâb est une tige quadrangulaire en fer, sur laquelle, de distance
en distance, sont, sur chacun de ses angles, des hoches carrées. La plus grande des
parties intermédiaires à ces hoches a sur ses quatre faces un trou carre long, perce
à jour; les autres parties sont divisées tout autour par des raies en creux, qui
forment dans leur entre-deux tantôt de petits filets, tantôt des bandes plates.
L e C H E V A L E T a la même forme que les chevalets des kemângeh précédentes;
mais, comme notre rebâb n’a qu’une corde, ce chevalet n’a aussi qu une large
hoche, proportionnée à la largeur de la corde.
L ’ a r c h e t est construit de même que celui de la kemângeh a’gouz.
Il n’y a en bois au corps sonore A que les éclisses ; elles sont au nombre de
quatre, engrenées les unes dans les autres. Le dessus ou la table et le dessous
sont formés chacun d’une feuille de parchemin tendue et collée sur les quatre
éclisses. L ’éclisse du sommet et celle de la base du corps sonore paroissent être
de cyprès de Constantinople ; les éclisses des côtés sont en erable.
Le manche et le cheviller sont en alizier : la tête des chevilles est en bois
de cormier, et la queue en buis.
Les c o r d e s , I’ a b a i s s e - c o r d e et le p i e d de l’instrument sont de la meme
matière qu’aux deux kemângeh précédentes, cest-a-dire, en ferrie chevalet est en
bois blanc.
La hauteur totale du rebâb est de 921 millimètres ; l’épaisseur du corps sonore,
ou, ce qui revient au même, la largeur des éclisses, est de 59 millimètres. La
largeur de la table et celle du dessous du corps sonore sont de 15 9 millimètres
au sommet, et de 260 à la base : la longueur des éclisses qui correspondent à
l’une et à l’autre dimension, est respectivement de la même étendue. L étendue
du côté oblique de la droite est de 288 millimétrés; celle du cote oblique de la
gauche est de 290: les éclisses qui correspondent à ces côtés, ont aussi respectivement
les mêmes dimensions en longueur.
Depuis le bas du manche, près du corps sonore, jusqu au sommet du cheviller,
C C C C C C i m M .