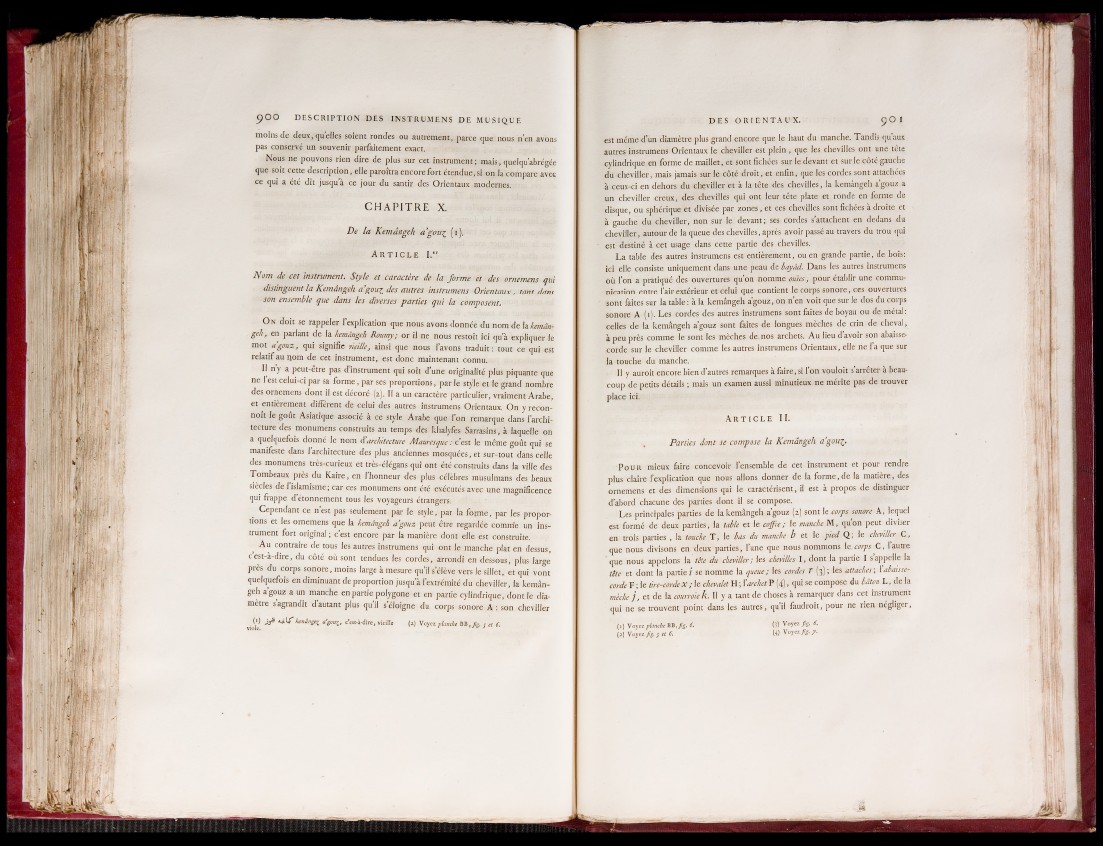
^ O O DES C R I P T I O N DES INSTRUMENS DE MUSI QUE
moins de deux, quelles soient rondes ou autrement, parce que nous n’en avons
pas conservé un souvenir parfaitement exact.
Nous ne pouvons rien dire de plus sur cet instrument; mais, quelqu’abrégée
que soit cette description, elle paraîtra encore fort étendue, si on la compare avec
ce qui a été dit jusquà ce jour du santir des Orientaux modernes.
C H A P I T R E X.
De la Kemângeh a ’gouz (i).
A r t i c l e I . "
Nom de cet instrument. Style et caractère de la forme et des ornemens qui
distinguent la Kemângeh a gouz des autres instrumens Orientaux, tant dans
son ensemble que dans les diverses parties qui la composent.
On doit se rappeler l’explication que nous avons donnée du nom de la kemân-
geh, en parlant de la kemângeh Rowny; or il ne nous restoit ici qu’à expliquer le
mot a'gouz, qui signifie vieille, ainsi que nous l’avons traduit: tout ce qui est
relatif au ijom de cet instrument, est donc maintenant connu.
Il n’y a peut-être pas d’instrument qui soit d’une originalité plus piquante que
ne 1 est celui-ci par sa forme, par ses proportions, par le style et le grand nombre
des ornemens dont il est décoré (2). Il a un caractère particulier, vraiment Arabe,
et entièrement différent de celui des autres instrumens Orientaux. On yrecon-
noit le gout Asiatique associé à ce style Arabe que l’on remarque dans l’architecture
des monumens construits au temps des Idialyfes Sarrasins, à laquelle on
a quelquefois donné le nom d architecture Mauresque : c’est le même goût qui se
manifeste dans l’architecture des plus anciennes mosquées, et sur-tout dans celle
des monumens très-curieux et très-élégans qui ont été construits dans la ville des
Tombeaux près du Kaire, en l’honneur des plus célèbres musulmans des beaux
siècles de l’islamisme ; car ces monumens ont été exécutés avec une magnificence
qtii frappe d étonnement tous les voyageurs étrangers.
Cependant ce n’est pas seulement par le style, par la forme, par les proportions
et les ornemens que la kemângeh a ’gouz peut être regardée comm’e un instrument
fort original ; c est encore par la manière dont elle est construite.
Au contraire de tous les autres instrumens qui ont le manche plat en dessus,
cest-à-dire, du côté où sont tendues les cordes, arrondi en dessous, plus large
près du corps sonore, moins large à mesure qu’il s’élève vers le sillet, et qui vont
quelquefois en diminuant de proportion jusqu’à l’extrémité du cheviller, la kemângeh
agouz a un manche en partie polygone et en partie cylindrique, dont le diamètre
s agrandit d autant plus qu’il s’éloigne du corps sonore A : son cheviller
(0 kemângei a*g0UZ> c’est-à-dire, vieille
viole.
(2) Voyez planche BB ,fg . j et <f.
S I X .î'î
D E S O R I E N T A U X . 9 O I
est même d’un diamètre plus grand encore que le haut du manche. Tandis quaux
autres instrumens Orientaux le cheviller est plein, que les chevilles ont une tête
cylindrique en forme de maillet, et sont fichées sur le devant et sur le coté gauche
du cheviller, mais jamais sur le côté droit, et enfin, que les cordes sont attachées
à ceux-ci en dehors du cheviller et a la tete des chevilles, la kemângeh agouz a
un cheviller creux, des chevilles qui ont leur tete plate et ronde en forme de
disque, ou sphérique et divisée par zones, et ces chevilles sont fichées à droite et
à gauche du cheviller, non sur le devant; ses cordes s’attachent en dedans du
cheviller, autour de la queue des chevilles, après avoir passé au travers du trou qui
est destiné à cet usage dans cette partie des chevilles.
La table des autres instrumens est entièrement, ou en grande partie, de bois:
ici elle consiste uniquement dans une peau de hayâd. Dans les autres instrumens
où l’on a pratiqué des ouvertures qu’on nomme oiiies, pour établir une communication
entre l’air extérieur et celui que contient le corps sonore, ces ouvertures
sont faites sur la table : à la kemângeh a’gouz, on n’en voit que sur le dos du corps
sonore A (1). Les cordes des autres instrumens sont faites de boyau ou de métal:
celles de la kemângeh a’gouz sont faites de longues mèches de crin de cheval,
à peu près comme le sont les mèches de. nos archets. Au lieu d avoir son abaisse-
corde sur le cheviller comme les autres instrumens Orientaux, elle ne l’a que sur
la touche du manche.
Il y auroit encore bien d’autres remarques à faire, si l’on vouloit s arrêter à beaucoup
de petits détails ; mais un examen aussi minutieux ne mérite pas de trouver
place ici.
A r t i c l e I I .
Parties dont se compose la Kemângeh a’gouz•
'Po u r mieux faire concevoir Iensemble de cet instrument et pour îendre
plus claire l’explication que nous allons donner de la fo rm e ,d e la matière, des
ornemens et des dimensions qui le caractérisent, il est a propos de distinguer
d’abord chacune des parties dont il se compose.
Les principales parties de la kemângeh a’gouz (2) sont le corps sonore A, lequel
est formé de deux parties, la table et le coffre ; le manche M, quon peut divLer
en trois parties , la touche T, le bas du manche b et le pied Q; le cheviller C,
que nous divisons en deux parties, l’une que nous nommons le.corps C, 1 autre
que nous appelons la tête du cheviller; les chevilles I, dont la partie I s appelle la
tête et dont la partie/ se nomme la queue; les cordes T (3); les attaches', 1 abaisse-
corde F ; le tire-corde X; le chevalet H ; \archet P (4), qui se compose du bâton L , de la
mèche j , et de la courroie k . Il y a tant de choses à remarquer dans cet instrument
qui ne se trouvent point dans les autres, qu’il faudrait, pour ne rien négliger,
(1) Voyez planche BB, fig. 6.
(2) Voyez fig. y et 6.
(3) Voyez fig, 6.
(4) Voyez/«-. 7 .
l ’M Kl