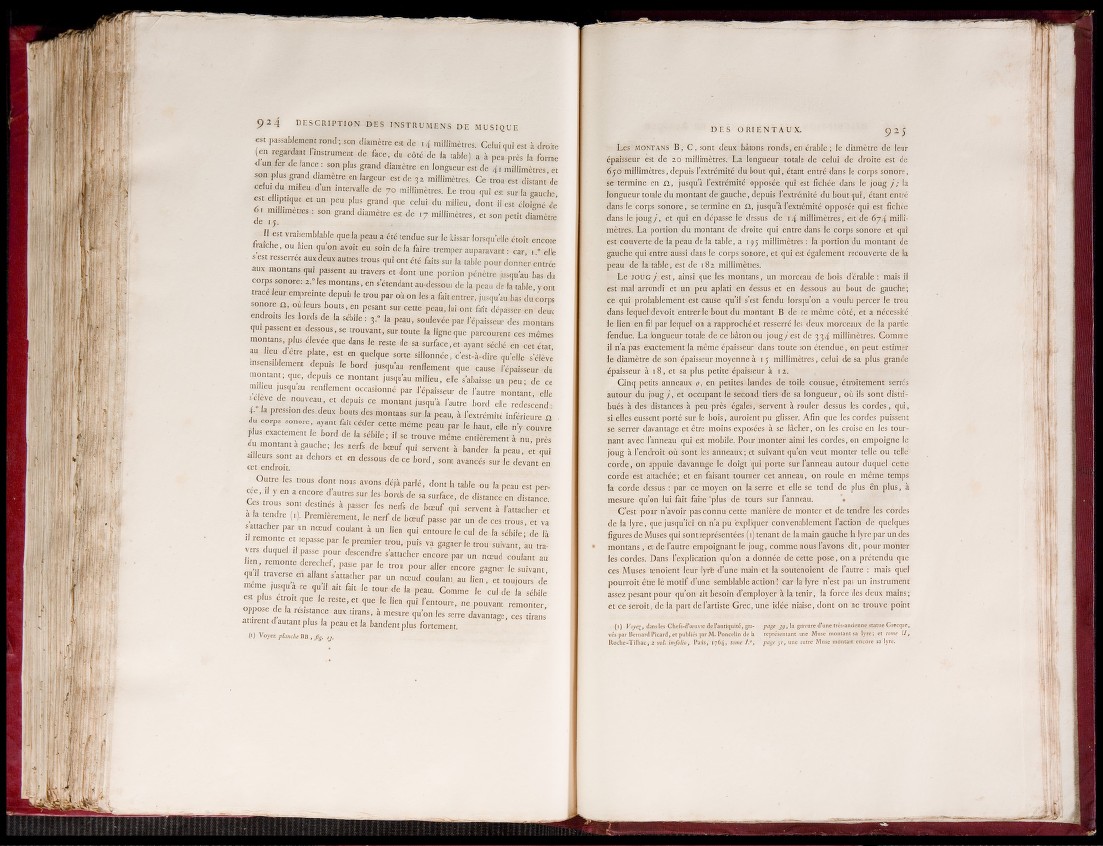
est passablement rond;.son diamètre est de ,4 millimètres. Celui qui est à droite
(en regardant 1 instrument de face, du côté de la table) a à peu près la forme
d un fer de lance : son plus grand diamètre en longueur est de 4 , millimètres, et
son plus grand diamètre en largeur est de 32 millimètres. Ce trou est distant de
celui du milieu d’un intervalle de 70 millimètres. L e trou qui est sur la gauche
est elliptique et un peu plus grand que celui du milieu, dont il est éloigné de’
I 1111 imetres : son grand diamètre est de 17 millimètres, et son petit diamètre
<ie 1 j . , r
II est vraisemblable que la peau a été tendue sur le kissar lorsqu’elle étoit encore
fraîche, ou bien qu’on avoit eu soin de la faire tremper auparavantj car, i.° elle
s est resserrée aux deux autres trous qui ont été faits sur la table pour donner entrée
■aux montans qui passent au travers et dont une portion pénètre jusqu’au bas du
corps sonore: 2.“ les montans, en s’étendant au-dessous de la peau de la table vont
trace leur empreinte depuis le trou par où on les a fait entrer, jusqu’au bas du corps
sonore a ou leurs bouts, en pesant sur cette peau, lui ont fait dépasser en deux
endroits les bords de la sébile : 3.» la peau, soulevée par l’épaisseur des montans
qui passent en dessous, se trouvant, sur toute la ligne que parcourent ces mêmes
montans plus elevée que dans le reste de sa surface, et ayant séché en cet état
au lieu detre plate, est en quelque sorte sillonnée, c’est-à-dire qu’elle s’élève
insensiblement depuis le bord jusqu’au renflement que cause l’épaisseur du
montant; que, depuis ce montant jusqu’au milieu, elle s’abaisse un peu- de ce
f ü 'USCΓ aU renflement o^asionné par l ’épaisseur de l’autre montait, elle
seleve de nouveau, et depuis ce montant jusqu’à l’autre bord elle redescend:
4- la pression des.deux bouts des montans sur la peau, à l’extrémité inférieure a
u corps sonore ayant fait céder cette même peau par le haut, elle n’y couvre
plus exactement le bord de la sébile; il se trouve même entièrement à nu, près
du montant a gauche; les nerfs de boeuf qui servent à bander la peau, et qui
ailleurs sont au dehors et en dessous de ce bord, sont avancés sur le devant en
cet endroit. . :
Outre les trous dont nous avons déjà parlé, dont la table ou la peau est per-
ççe, il y en a encore d’autres sur les bords de sa surface, de distance en distance
Ces trous sont destinés à passer Tes nerfs de boeuf qui servent à l’attacher et
a la tendre (1). Premièrement, le nerf de boeuf passe par un de ces trous, et va
s attacher par un noeud coulant à un lien qui entoure le cul de la sébile - de là
1 remonte et repasse par le premier trou, puis va gagner le trou suivant, au travers
duquel il passe pour descendre s’attacher encore par un noeud coulant au
hen remonte derechef, passe par le trou pour aller encore gagner le suivant,
q il traverse en allant s attacher par un noeud coulant au lien, et toujours' de
meme ,usqua ce qu’il ait fait le tour de la peau. Comme le cul de la sébile
É Ï H S Ë p B ® ie reSK’ Ct qUÊ 16 ,iCn W remoure’ ne P °uvant remonter,
oppose de la résistance aux tirans, à mesure qu’on les serre davantage, ces tirans
attirent d autant plus la peau et la bandent plus fortement.
0 ) Voyez planche BD , fig. ,j.
Les m o n t a n s B , C , sont deux bâtons ronds, en érable ; le diamètre de leur
épaisseur est de 20 millimètres. La longueur totale de celui de droite est de
650 millimètres, depuis l’extrémité du bout qui, étant entré dans le corps sonore,
se termine en a , jusqu’à l’extrémité opposée qui est fichée dans le joug /,- la
longueur totale du montant de gauche, depuis l’extrémité du bout qui, étant entré
dans le corps sonore, se termine en Et, jusqu’à l’extrémité opposée qui est fichée
dans le joug/ , et qui en dépasse le dessus de i4 millimètres, est de 6y4 millimètres.
La portion du montant de droite qui entre dans le corps sonore et qui
est couverte de la peau de la table, a 195 millimètres : la portion du montant de
gauche qui entre aussi dans le corps sonore, et qui est également recouverte de la
peau de la table, est de 182 millimètres.
Le j o u g / est, ainsi que les montans, un morceau de bois d’érable : mais il
est mal arrondi et un peu aplati en dessus et en dessous au bout de gauche;
ce qui probablement est cause qu’il s’est fendu lorsqu’on a voulu percer le trou
dans lequel devoit entrer le bout du montant B de ce même côté, et a nécessité
Je lien en fil par lequel on a rapproché et resserré les deux morceaux de la partie
fendue. La longueur totale de ce bâton ou joug/ est de 334 millimètres. Comme
il n’a pas exactement la même épaisseur dans toute son étendue, on peut estimer
le diamètre de son épaisseur moyenne à t y millimètres, celui de sa plus grande
épaisseur à 18, et sa plus petite épaisseur à 12.
Cinq petits anneaux o, en petites bandes de toile cousue, étroitement serrés
autour du joug / , et occupant le second tiers de sa longueur, où ils sont distribués
à des distances à peu près égales/servent à rouler dessus les cordes, qui,
si elles eussent porté sur le bois, auroient pu glisser. Afin que les cordes puissent
se serrer davantage et être moins exposées à se lâcher, on les croise en les tournant
avec l’ànneau qui est mobile. Pour monter ainsi les cordes, on empoigne le
joug à l’endroit où sont les anneaux ; et suivant qu’on veut monter telle ou telle
corde, on appuie davantage le doigt qui porte sur l’anneau autour duquel cette
corde est attachée; et en faisant tourner cet anneau, on roule en même temps
la corde dessus : par ce moyen on la serre et elle se tend de plus en plus, à
mesure qu’on lui fait faire ‘plus de tours sur 1 anneau.
C ’est pour n’avoir pas connu cette manière de monter et de tendre les cordes
de la lyre, que jusqu’ici on n’a pu expliquer convenablement l’action de quelques
figures de Muses qui sont représentées (1) tenant de la main gauche la lyre par un des
montans, et de l’autre empoignant le joug, comme nous l’avons dit, pour monter
les cordes. Dans l’explication qu’on a donnée de cette pose, on a prétendu que
ces Muses tenoient leur lyrfe d’une main et la soutenoient de l’autre : mais quel
pourrait être lé motif d’une semblable action! car la lyre n’est pas un instrument
assez pesant pour qu’on ait besoin d’employer à la tenir, la force des deux mains;
et ce serait, de la part de l’artiste Grec, une idée niaise, dont on ne trouve point
(1) Voyez, dans les Chefs-d’oeuvre de l’antiquité, gra- page jÿ , la gravure d’une très-ancienne statue Grecque,
vés par Bernard Picard, et publiés par M . Poncelin de la représentant une M use m ontant sa lyre; et tome 11, R oche-Tilhac, 2 vol. in-folio, Paris,’ 1764, tome page f i , une autre Muse m ontant encore sa lyre.