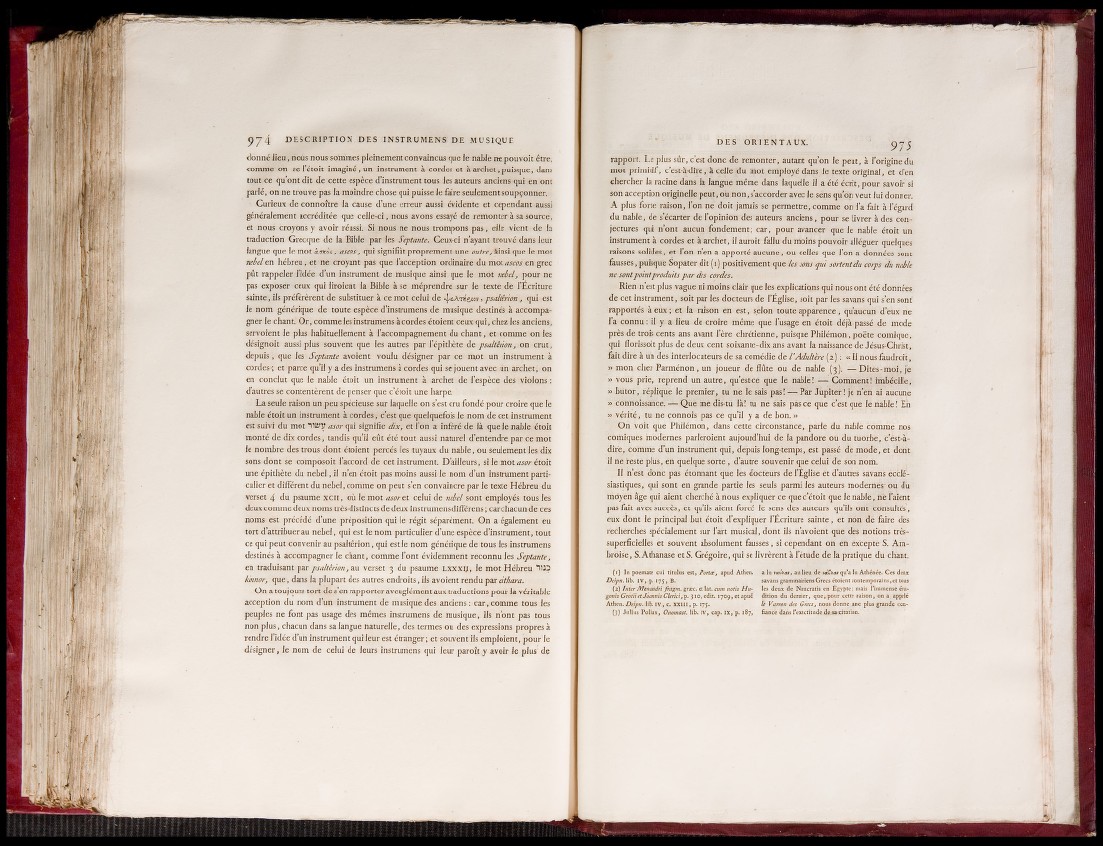
donné lien, nous nous soïnmes pleinement convaincus que le nabie ne pouvoit être,
comme on se l’étoit imaginé, un instrument à cordes et à archet, puisque, dans
tout ce qu’ont dit de cette espèce d’instrument tous les auteurs anciens qui en ont
parlé, on ne trouve pas la moindre chose qui puisse le faire seulement soupçonner.
Curieux de connoître la cause d’une erreur aussi évidente et cependant aussi
généralement accréditée que celle-ci, nous avons essayé de remonter à sa source,
et nous croyons y avoir réussi. Si nous ne nous trompons pas, elle vient de la
traduction Grecque de la Bible par les Septante. Ceux-ci n’ayant trouvé dans leur
langue que le mot ¿reo'<, ascos, qui signifiât proprement une outre, àinsi que le mot
nebelen hébreu, et ne croyant pas que l’acception ordinaire du m otascos en grec
put rappeler l ’idée d’un instrument de musique ainsi que le mot nebel, pour ne
pas exposer ceux qui liraient la Bible à se méprendre sur le texte de l’Écriture
sainte, ils préférèrent de substituer à ce mot celui de 4/ttÀ-nie/ov, psaltêrion, qui est
le nom générique de toute espèce d’instrumens de musique destinés à accompagner
le chant. Or, comme les instrumens à cordes étoient ceux qui, chez les anciens,
servoient le plus habituellement à l’accompagnement du chant, et comme on les
désignoit aussi plus souvent que les autres par l’épithète de psaltêrion, on crut,
depuis , que les Septante avoient voulu désigner par ce mot un instrument à
cordes->; et parce qu’il y a des instrumens à cordes qui se jouent avec un archet, on
en conclut que le nable étoit un instrument à archet de l’espèce des violons :
d’autres se contentèrent de penser que c’étoit une harpe.
La seule raison un peu spécieuse sur laquelle on s’est cru fondé pour croire que le
nable étoit un instrument à cordes, c’est que quelquefois le nom de cet instrument
est suivi du mot 1 Wy asor qui signifie dix, et l’on a inféré de là que le nable étoit
monté de dix cordes, tandis qu’il eût été tout aussi naturel d’entendre par ce mot
le nombre des trous dont étoient percés les tuyaux du nable, ou seulement les dix
sons dont se composoit l’accord de cet instrument. D ’ailleurs, si le mot asor étoit
une épithète du nebel, il n’en étoit pas moins aussi le nom d’un instrument particulier
et différent du nebel, comme on peut s’en convaincre par le texte Hébreu du
verset 4 du psaume x c i l , où le mot asor et celui de nebel sont employés tous les
deux comme deux noms très-distincts de deux instrumens différens ; car chacun de ces
noms est précédé d’une préposition qui le régit séparément. On a également eu
tort d attribuer au nebel, qui est le nom particulier d’une espèce d’instrument, tout
ce qui peut convenir au psaltêrion, qui est le nom générique de tous les instrument
destinés à accompagner le chant, comme l’ont évidemment reconnu les Septante,
en traduisant par psaltêrion, au verset 3 du psaume l x x x i j , le mot Hébreu "IU3
kinnor, que, dans la plupart des autres endroits, ils avoient rendu par cithara.
On a toujours tort de s’en rapporter aveuglément aux traductions pour la véritable
acception du nom d’un instrument de musique des anciens : car , comme tous les
peuples ne font pas usage des mêmes instrumens de musique, ils n’ont pas tous
non plus, chacun dans sa langue naturelle, des termes ou des expressions propres à
rendre l’idée d’un instrument quileur est étranger; et souvent ils emploient, pour le
désigner, le nom de celui de leurs instrumens qui leur paraît y avoir le plus de
rapport. Le plus sûr, c’est donc de remonter, autant qu’on le peut, à l’origine du
mot primitif, c’est-à-dire, à celle du mot employé dans le texte original, et d’en
chercher la racine dans la langue même dans laquelle il a été écrit, pour savoir si
son acception originelle peut, où non, s’accorder avec le sens qu’on veut lui donner.
A plus forte raison, l’on ne doit jamais se permettre, comme on l’a fait à l’égard
du nable, de s’écarter de l’opinion des auteurs anciens, pour se livrer à des conjectures
qui n’ont aucun fondement; car, pour avancer que le nable étoit un
instrument à cordes et à archet, il aurait fallu du moins pouvoir alléguer quelques
raisons solides, et l’on n’en a apporté aucune, ou celles que l’on a données sont
fausses, puisque Sopater dit (1) positivement que les sons qui sortent du corps du nable
ne sont point produits par des cordes.
Rien n’est plus vague ni moins clair que les explications qui nous ont été données
de cet instrument, soit par les docteurs de l’Église, soit par les savans qui s’en sont
rapportés à eux ; et la raison en est, selon toute apparence, qu’aucun d’eux ne
1 a connu : il y a lieu de croire même que l’usage en étoit déjà passé de mode
près de trois cents ans avant l’ère chrétienne, puisque Phiiémon, poëte comique,
qui florissoit plus de deux cent soixante-dix ans avant la naissance de Jésus-Christ,
fait dire à un des interlocuteurs de sa comédie de l ’Adultère (2) : « 1 nous faudrait,
» mon cher Parménon, un joueur de flûte ou de nable (3). — Dites-moi, je
» vous prie, reprend un autre, qu’est-ce que le nable! — Comment! imbécille,
» butor, réplique le premier, tu ne le sais pas! — Par Jupiter ! je n’en ai aucune
» connoissance. — Que me dis-tu là! tu ne sais pas ce que c’est que le nable! Ën
» vérité, tu ne connois pas ce qu’il y a de bon. »
On voit que Phiiémon, dans cette circonstance, parle du nable comme nos
comiques modernes parleraient aujourd’hui de la pandore ou du tuorbe, c’ést-à-
dire, comme d’un instrument qui, depuis long-temps, est passé de mode, et dont
il ne reste plus, en quelque sorte, d’autre souvenir que celui de son nom.
Il n’est donc pas étonnant que les docteurs de l’Église et d’autres savans ecclésiastiques,
qui sont en grande partie les seuls parmi les auteurs modernes’ ou du
moyen âge qui aient cherché à nous expliquer ce que c’étoit que le nable, né l’aient
pas fait avec succès, et qu’ils aient forcé le sens des auteurs qu’ils ont consultés,
eux dont le principal but étoit d’expliquer l’Écriture sainte, et non de faire dès
recherches spécialement sur l’art musical, dont ils n’avoient que des notions très-
superficielles et souvent absolument fausses, si cependant on en excepte S. Am-
broise, S. Athanase et S. Grégoire, qui se livrèrent à l’étude de la pratique du chant.
(1) In poemate cui titulus est, Porta:, apud Athen. a lu vavKeur, au lieu de voSkoj/ qu’a Deipn. lu Athénée. Ces deux lib. iv , p. 175, B. savans grammairiens Grecs étoient contemporains, et tous
gon(2is) GInrtoetri iMetejonaünrindirsi Cfrlaegrimci., græc. et Iat. curn notis Hu- les deux de Naucratis en Egypte; mais l’immense éru- p. 3 10, edit. I700,etapud dition du dernier, que, pour cette raison, on a appelé
Athen. Deipn. lib. IV, c. XXIII, p. 175. lé Varron des Grecs, nous donne une plus grande con-
(3) Julfus Pollux, Onomast. lib. IV, cap. IX, p. 187, fiancé dans l’exactitude de.sacitation.