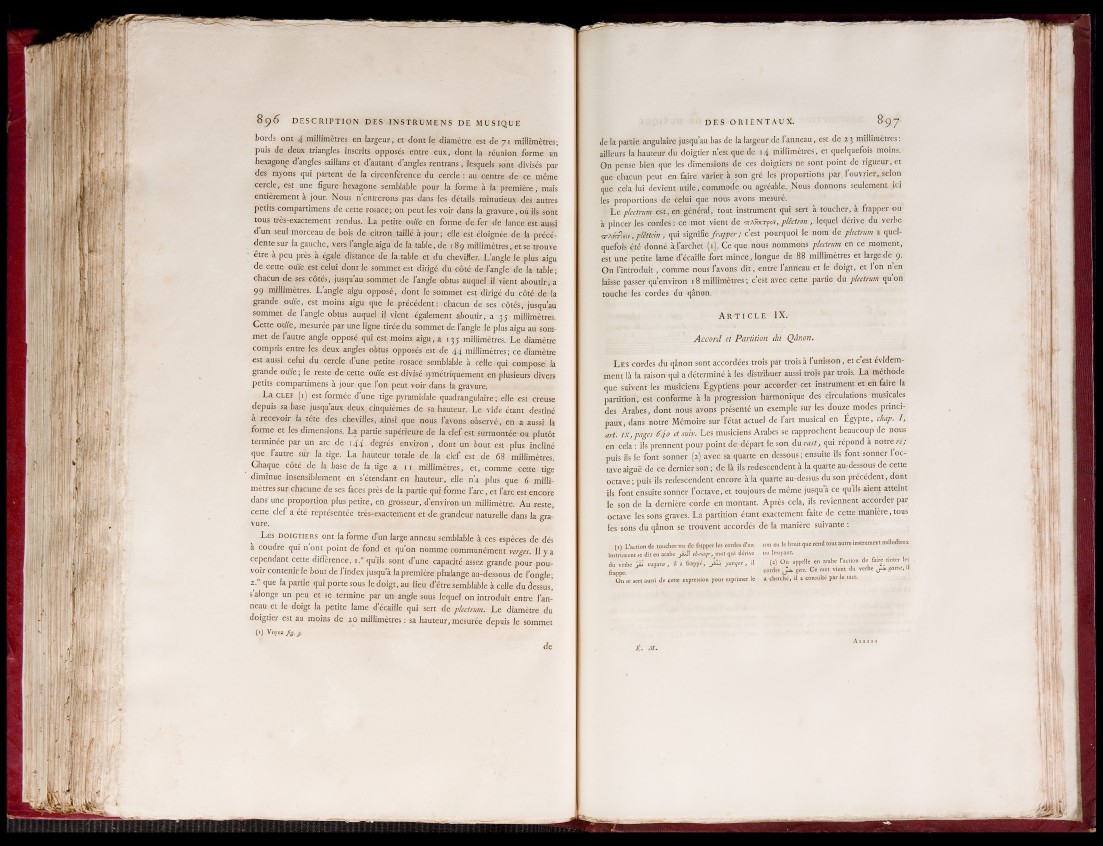
bords ont 4 millimètres en largeur, et dont le diamètre est de 71 millimètres;
puis de deux triangles inscrits opposes entre eux, dont la réunion forme un
hexagone d angles saillans et d’autant d’angles rentrans, lesquels sont divisés par
des rayons qui partent de la circonférence du cercle : au centre de ce même
cercle, est une figure hexagone semblable pour la forme à la première, mais
entièrement a jour. Nous n entrerons pas dans les détails minutieux des autres
petits compartimens de cette rosace; on peut les voir dans la gravure, où ils sont
tous tres-exactement rendus. La petite ouïe en forme de fer de lance est aussi
d un seul morceau de bois de citron taillé à jour ; elle est éloignée de la précédente
sur la gauche, vers l’angle aigu de la table, de 189 millimètres, et se trouve
• être à peu près à égale distance de la table et du cheviller. L’angle le plus aigu
de cette ouïe est celui dont le sommet est dirigé du côté de l’angle de la table ;
chacun de ses côtés, jusqu’au sommet de l’angle obtus auquel il vient aboutir, a
99 millimètres. Langle aigu opposé, dont le sommet est dirigé du côté de la
grande pui'e, est moins aigu que le précédent; chacun de ses côtés, jusqu’au
sommet de l’angle obtus auquel il vient également aboutir, a 35 millimètres.
Cette ouïe, mesurée par une ligne tirée du sommet de l’angle le plus aigu au sommet
de l’autre angle opposé qui est moins aigu, a 135 millimètres. Le diamètre
compiis entre les deux angles obtus opposés est de 44 millimètres; ce diamètre
est aussi celui du cercle, d’une petite rosace semblable à celle qui compose la
grande ouïe ; le reste de cette ouïe est divisé symétriquement en plusieurs divers
petits compartimens a jour que i on peut voir dans la gravure.
La CLEF (1) est formée d’une tige pyramidale quadrangulaire ; elle est creuse
depuis sa base jusqu’aux deux, cinquièmes de sa hauteur. Le vide étant destiné
à recevoir la tête des chevilles, ainsi que nous l’avons observé, en a aussi la
forme et les dimensions. La partie supérieure de la clef est surmontée' ou plutôt
terminée par un arc de 144 degrés environ , dont un bout est plus incliné
que l’autre sur la tige. La hauteur totale de la clef est de 68 millimètres.
Chaque côté de la base de la.tige a 11 millimètres, et, comme cette tige
diminue insensiblement en s’étendant en hauteur, elle n’a plus que 6 millimètres
sur chacune de ses faces près de la partie qui forme l’arc, et l’arc est encore
dans" une proportion plus petite, en grosseur, d’environ un millimètre. Au reste,
cette clef a été représentée très-exactement et de grandeur naturelle dans la gravure.
Les d o i g t i e r s ont la forme d’un large anneau semblable à ces espèces de dés
à coudre qui n ont point de fond et qu’on nomme communément verges. Il y a
cependant cette différence, i.° quils sont d’une capacité assez grande pour pouvoir
contenir le bout de l’index jusqu a la première phalange au-dessous de l’ongle;
2.0 que la partie qui porte sous le doigt, au lieu d’être semblable à celle du dessus’
s alonge un peu et se termine par un angle sous lequel on introduit entre l’anneau
et le doigt la petite lame decaille qui sert de plectrum. Le diamètre du
doigtier est au moins de 20 millimètres ; sa hauteur, mesurée depuis le sommet
(r) Voyez f g. J.
de
de la partie, angulaire jusqu’au bas de la largeur de 1 anneau, est de 23 millimètres ;
ailleurs la hauteur du doigtier n’est que de 14 millimètres, et quelquefois moins. ■
On pense bien que les dimensions de ces doigtiers ne sont point de rigueur, et
que chacun peut en faire varier à son gré les proportions par.1 ouvrier, selon
que cela lui devient utile, commode ou. agrcable. Nous donnons seulement ici
les proportions de celui que nous avons mesure.
Le plectrum est, en général, tout instrument qui sert à toucher, à frapper ou
à pincer les cordes: ce mot vient de vrXrr.Tfa'i ,plêctron, lequel dérivé du yerbe
■srAiifhiv, plêttcin, qui signifie frapper; c’est pourquoi le nom de plectrum a quelquefois
é,té donné à l’archet (i), Ce que nous nommons plectrum en ce moment,
est une petite lame d’écaille fort mince, longue de 88 millimétrés et large de 9*
On l’introduit, comme nous l’avons di t , entre 1 anneau et le doigt, et 1 on n en
laisse passer qu’environ 18 millimètres ; c’est avec cette partie du plectrum qu on
touche les cordes du qânon.
A r t i c l e I X .
Accord et Partition du Qânon.
L e s cordes du qânon sont accordées trois par trois a 1 unisson, et c est évidemment
là la raison qui a déterminé à les distribuer aussi trois par trois. La méthode
que suivent les musiciens Égyptiens pour accorder cet instrument et en faire la
partition, est conforme à la progression harmonique des circulations musicales
des Arabes, dont nous avons présenté un exemple sur les douze modes principaux,
dans notre Mémoire sur l’état actuel de l’art musical en Égypte, chap. I,
art. IX, pages f4o etsuiv. Les musiciens Arabes se rapprochent beaucoup de nous
en cela : ils prennent pour point de départ le son Au rait, qui répond a notre ré;
puis ils le font sonner (2) avec sa quarte en dessous ; ensuite ils font sonner 1 octave
aiguë de ce dernier son ; de là ils redescendent à la quarte au-dessous de cette
octave ; puis ils redescendent encore à la quarte au-dessus du son précédent, dont
ils font ensuite sonner l’octave, et toujours de même jusqu’à ce qu’ils aient atteint
le son de la dernière corde en montant. Après cela, ils reviennent accorder par
octave les sons graves. La partition étant exactement faite de cette manière, tous
les sons du qânon se trouvent accordés de la manière suivante :
(1) L’action de toucher ou de frapper les cordes d’un son ou le bruit que rend toutautre instrument mélodieux
instrument se dit en arabe j&JI el-naqr, mot qui dérive ou bruyant.
du verbe > Ü B il a frappé , J L yangor, il M O n appelle en arabe l’action de faire tinter les
£ra pe cordes gess. Ce mot vient du verbe j» * gassa, n
On se sert aussi de cette expression pour exprimer le a cherché, il a consulté par le tact.
É . M .
A a a a a a