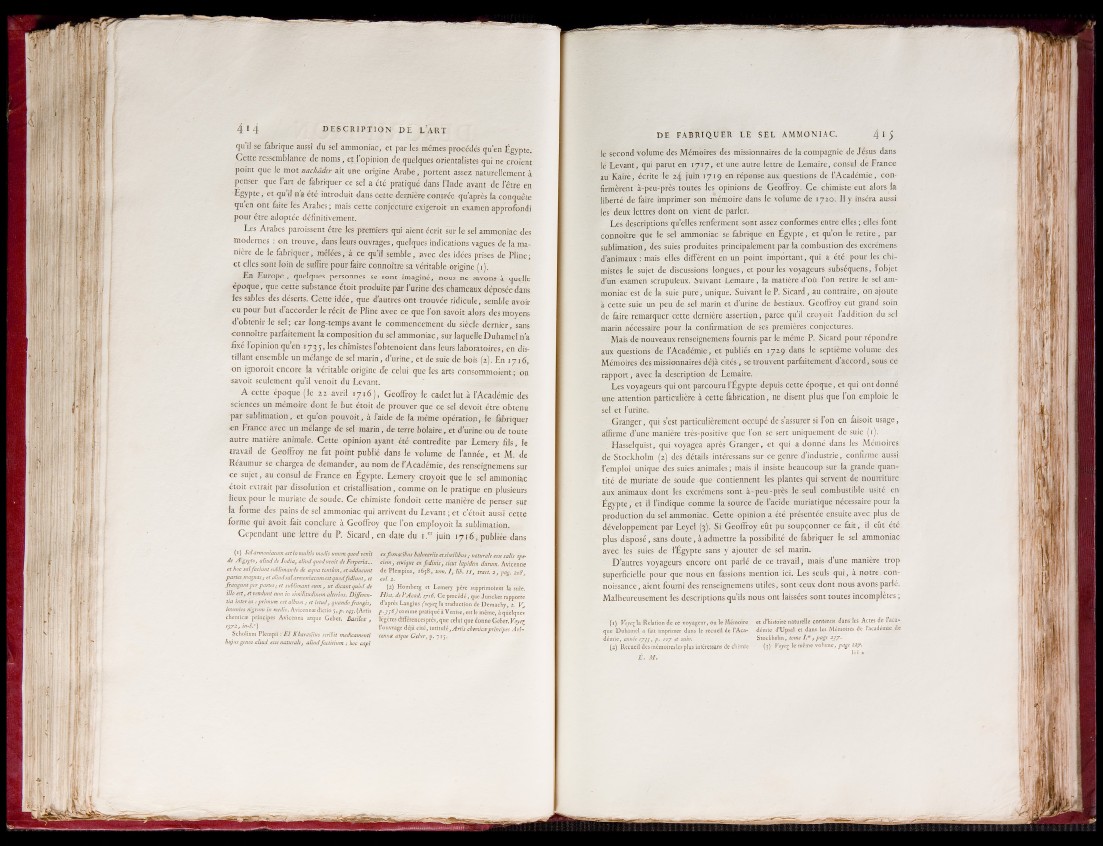
qu’il se fabrique aussi du sel ammoniac, et par les mêmes procédés qu’en Egypte.
Cette ressemblance de noms, et l’opinion de quelques orientalistes qui ne croient
point que le mot nachâder ait une origine Arabe, portent assez naturellement à
penser que l’art de fabriquer ce sel a été pratiqué dans l’Inde avant de l’être en
Egypte, et qu il n a été introduit dans cette dernière contrée qu’après la conquête
quen ont faite les Arabes; mais cette conjecture exigeroit un examen approfondi
pour être adoptée définitivement.
Les Arabes paraissent être les premiers qui aient écrit sur le sel ammoniac des
modernes : on trouve, dans leurs ouvrages, quelques indications vagues de la manière
de le fabriquer, mêlées, à ce qu’il semble, avec des idées prises de Pline;
et elles sont loin de suffire pour faire connoître sa véritable origine (i).
En Europe, quelques personnes se sont imaginé, nous ne savons-à quelle
époque, que cette substance étoit produite par l’urine des chameaux déposée dans
les sables des déserts. Cette idée, que d’autres ont trouvée ridicule, semble avoir
eu pour but d’accorder le récit de Pline avec ce que l’on savoit alors des moyens
d’obtenir le sel; car long-temps avant le commencement du siècle dernier, sans
connoître parfaitement la composition du sel ammoniac, sur laquelle Duhamel n’a
fixé l’opinion qu’en 1735, les chimistes l’obtenoient dans leurs laboratoires, en distillant
ensemble un mélange de sel marin, d’urine, et de suie de bois (2). En 1716,
on ignorait encore la véritable origine de celui que les arts consommoient ; on
savoit seulement qu’il venoit du Levant.
A cette époque (le 22 avril 1716), Geoffroy le cadet lut à l’Académie des
sciences un mémoire dont le but étoit de prouver que ce sel devoit être obtenu
par sublimation, et quon pouvoit, à l’aide de la même opération, Je fabriquer
on France avec un mélangé de sel marin, de terre holaire, et d’urine ou de toute
autre matière animale. Cette opinion ayant été contredite par Lemery fils, le
travail de Geoffroy ne fut point publié dans le volume de l’année, et M. de
Reaumur se chargea de demander, au nom de l’Académie, des renseignemens sur
ce sujet, au consul de France en Égypte. Lemery croyoit que le sel ammoniac
ctoit extrait par dissolution et cristallisation, comme on le pratique en plusieurs
lieux pour le muriate de soude. Ce chimiste fondoit cette manière de penser sur
la forme des pains de sel ammoniac qui arrivent du Levant ; et c’étoit aussi cette
forme qui avoit fait conclure à Geoffroy que l’on employoit la sublimation.
Cependant une lettre du P. Sicard, en date du i.cr juin 1716, publiée dans
( 1 ) Soi annomacum estin muhis médis umim quoi venit exfomacibus balneariis etsimilibus ; naturaie esse salis speie
Ægyplo, aliud de India, aliudquod venit de Forperia... ciem, eruique ex fidinis, sicut lapident durum. Avicenne
et hoc salfaciunt sublimando de aqua tantum, et adducunt de Plem pius, 1658, tom. /, lib. 11, tract. 2, pag. 208 ,
partes magnas ; et aliud salarmoniacum estquodfodiunt, et col. 2.
frangunt per partes ; et sublimant eum, ut dicant quai de (2) Homherg et Lemery père supprimoient la suie.
illo est, et vendunt eum in similitudinem alterius. Differen- Hist. de l'Acad. ,y,6. Ce procédé, que Juncker rapporte
tia inter'ea : primum est album, et istud, quando jrangis, d’après Langius (voye^ fa traduction de D em achy, t. V,
¡manies nigrumin medio. Avicennædictioj.yr. îqq. (Artis p.j;6) comme pratiqué à Venise, est chcmicæ principes Avicenna atque Geber. le même, à quelques Basileoe , légères différencesprès, que celui que donne Geber. Voyr^
1J1.. ' .. ^ onvrage déjà cite, intitulé, Artis cbeinicteprincipes Avi- Scholium Plempir : El Kharasjius scribit medicamenti cenna atque Geber, p. 715.
bujus genus aliud esse naturale, aliud factitium : hoc capi
D E F A B R I Q U E R L E S E L A M M O N I A C . 4 l j
le second volume des Mémoires des missionnaires de la compagnie de Jésus dans
le Levant, qui parut en 1717, et une autre lettre de Lemaire, consul de France
au Kairè, écrite le 24 juin 1719 en réponse aux questions de l’Académie, confirmèrent
à-peu-près toutes les opinions de Geoffroy. Ce chimiste eut alors la
liberté de faire imprimer son mémoire dans le volume de 1720. Il y inséra aussi
lés deux lettres dont on vient de parler.
Les descriptions qu’elles renferment sont assez conformes entre elles ; elles font
connoître que le sel ammoniac se fabrique en Egypte, et qu’on le retire , par
sublimation, des suies produites principalement par la combustion des excrémens
d’animaux : mais elles diffèrent en un point important, qui a été pour les chimistes
le sujet de discussions longues, et pour les voyageurs subséquens, l’objet
d’un examen scrupuleux. Suivant Lemaire , la matière d’où l’on retire le sel ammoniac
est de la suie pure, unique. Suivant le P. Sicard, au contraire, on ajoute
à cette suie un peu de sel marin et d’urine de bestiaux. Geoffroy eut grand soin
de faire remarquer cette dernière assertion, parce qu’il croyoit l’addition du sel
marin nécessaire pour la confirmation de ses premières conjectures.
Mais de nouveaux renseignemens fournis par le même P. Sicard pour répondre
aux questions de l’Académie, et publiés en 172.9 dans le septième volume,des
Mémoires des missionnaires déjà cités, se trouvent parfaitement d’accord, sous ce
rapport, avec la description de Lemaire.
Les voyageurs qui ont parcouru l’Égypte depuis cette époque, et qui ont donne
une attention particulière à cette fabrication, ne disent plus que Ion emploie le
sel et l’urine.
Granger, qui s’est particulièrement occupé de s’assurer si l’on en faisoit usage,
affirme d’une manière très-positive que l’on se sert uniquement de suie (1).
Hasselquist, qui voyagea après Granger, et qui a donné dans les Mémoires
de Stockholm (2) des détails intéressans sur ce genre d’industrie, confirme aussi
l’emploi unique des suies animales ; mais il insiste beaucoup sur la grande quantité
de muriate de soude que contiennent les plantes qui servent de nourriture
aux animaux dont les excrémens sont à-peu-près le seul combustible usité en
Égypte, et il l’indique comme la source de l’acide muriatique nécessaire pour la
production du sel ammoniac. Cette opinion a été présentée ensuite avec plus de
développement par Leyel (3). Si Geoffroy eût pu soupçonner ce fait, il eut ete
plus disposé, sans doute, à admettre la possibilité de fabriquer le sel ammoniac
avec les suies de l’Égypte sans y ajouter de sel marin.
D ’autres voyageurs encore ont parlé de ce travail, mais d une maniéré trop
superficielle pour que nous en fassions mention ici. Les seuls qui, a notre con-
noissance, aient fourni des renseignemens utiles, sont ceux dont nous avons parle.
Malheureusement les descriptions qu’ils nous ont laissées sont toutes incomplètes ;
qu(e1 )D uVhoyaem^\eslL aR efalaitt iiomn pdreim ceer vdoaynasg eleu rr,e ocuue liel dMeé lm’Aociare- , edté md’ihei stdo’iUrep snaalt uerte ldlea ncso nletes nMusé mdaonirse sle sd eA ctes de Iaca- 1 académie de
dém ie, année iyqy, p, loy et suiv. Stockholm, tome I " > paëe 237- (2) Recueil des mémoires les plus intéressans de chimie (3) Voye% le même volum e, page 22y.
É. M.