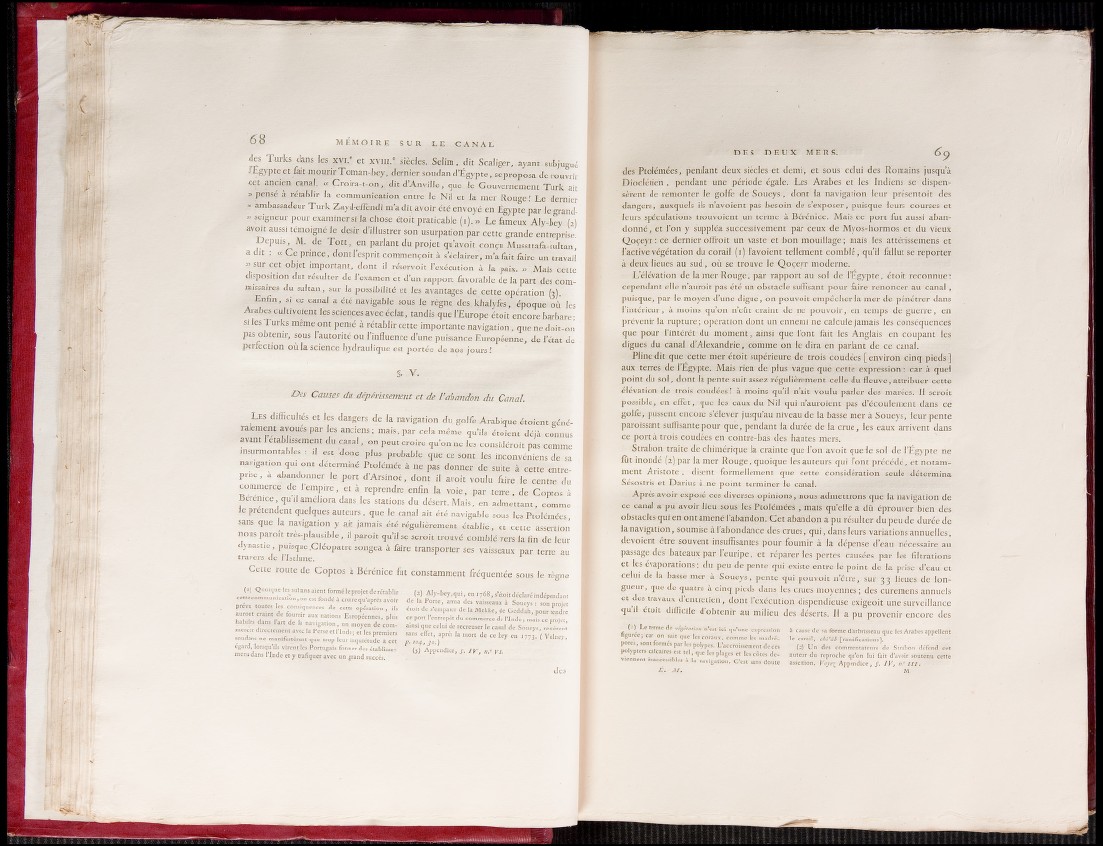
des Turks dans les xvi.« et xvm .' siècles. Selim, dit Scaliger,. ayant subjugué 1 Egypte et fait mourir Toman.-bey, dernier Soudan d’Egypte, se proposa de rouvrir
cet ancien canal. « Croira-t-on, dit d’Anville, que Je Gouvernement Turk ait
» pensé à rétablir la communication entre le Nil et la mer Rouge ! Le dernier
33 ambassadeur Turk Zayd-efFendi m’a dit avoir été envoyé en Egypte par le grand-
33 se‘gneur pour examiner si la chose étoit praticable (i). » Le fameux Aly-bey (2)
avoit aussi témoigné Je désir d’illustrer son usurpation par cette grande entreprise.
Depuis, M. de T o tt, en parlant du projet qu’avoit conçu Mussttafa-sultan,
a dit : « Ce prince, dont l’esprit commençoit à s’éclairer, m’a fait faire un travail
33 sur cet oI)jet important, dont il réservoit l’exécution à la paix. » Mais cette
disposition dut résulter de l’examen et d’un rapport favorable de la part des commissaires
du sultan, sur la possibilité et les avantages de cette opération (3).
Enfin, si ce canal a été navigable sous le règne des.khalyfes, époque où les
Arabes cultivoient les sciences avec éclat, tandis que l’Europe étoit encore barbare ;
si les Turks même ont pensé à rétablir cette importante navigation, que ne doit-on
pas obtenir, sous l’autorité ou l’influence d’une puissance Européenne, de l’état de
perfection ou la science hydraulique est portée de nos jours!
s. v.
Des Causes du dépérissement et de l ’abandon du Canal
L es difficultés et les dangers de la navigation du golfe Arabique étoient généralement
avoués par les anciens; mais, par cela même qu’ils étoient déjà connus
avant 1 etab hssement du canal, on peut croire qu’on ne les considéroit pas comme
insurmontables : il est donc plus- probable que ce sont les inconvéniens de sa
navigation qui ont déterminé Ptolémée à ne pas donner de. suite à cette entreprise,
a abandonner le port d’Arsinoé, dont il avoit voulu fitire le centre du
commerce de l’empire, et à reprendre enfin la voie, par terre, de Coptos à
Beremce quil améliora dans les stations du désert. Mais, en admettant, comme
le prétendent quelques auteurs, que le canal ait été navigable sous les Ptolémées,
sans que la navigation y ait jamais été régulièrement établie, et cette assertion
nous paroi t tres-plausible, il paraît qu’il se seroit trouvé comblé vers la fin de leur
dynastie, puisque.Cléopatresongea à faire transporter ses vaisseaux par terre au
travers de l’Isthme.
Cette route de Coptos à Bérénice fut constamment fréquentée sous le règne
c e u , « ^ ‘ûnicaüVn"1! " 5 " 7 d" étab,ir M A ly -be y ,. q ui, en .7 6 8 , s'é, oit déclaré indépendant
cette communication, on est fonde a croirequ aptes avoir de la Porte, arma des vaisseaux à Soueys • son proiet
p evu tou es les conséquences de cette opération , ils étoit de s’emparer de la M e t t e , de Geddah pour rendre
auront cram. de fournir aux nations Européennes, plus ce porc l’entrepôt du commerce de l’Inde maSTc“ L i t
2 1 dans art de Ia navigation, un moyen de corn- ainsi que celui de recreuser le canal de Soueys restèrent
mercer directement avec la Perse et l’ Inde; e, les premiers sans effet, après la mort de ce bey en , 773 ’( VoTney
soudans ne manifestèrent que trop leur inquiétude à cet p. , H , j o ) VoJney,
égard, lorsqu’ils virent les Portugais former des établisse- (3) Appendice, f. I V n.° VI.
mens dans 1 Inde et y trafiquer avec un grand succès.
des
des Ptolémées, pendant deux siècles et demi, et sous celui des Romains jusqu’à
Dioclétien, pendant une période égale. Les Arabes et les Indiens se dispensèrent
de remonter le golfe de Soueys, dont la navigation leur présentoir des
dangers, auxquels ils n’avoient pas besoin de s’exposer, puisque leurs courses et
leurs spéculations trouvoient un terme à Bérénice. Mais ce port fut aussi abandonné,
et l’on y suppléa successivement par ceux de Myos-hormos et du vieux
Qoçeyr : ce dernier offroit un vaste et bon mouillage ; mais les attérissemens et
l’active végétation du corail (i) l’avoient tellement comblé, qu’il fallut se reporter
à deux lieues au sud, où se trouve le Qoçeyr moderne.
L’élévation de la mer Rouge, par rapport au sol de l’Egypte, étoit reconnue;
cependant elle n’auroit pas été un obstacle suffisant pour faire renoncer au canal,
puisque, par le moyen d’une digue, on pouvoit empêcher la mer de pénétrer dans
l’intérieur, à moins qu’on n’eût craint de ne pouvoir, en temps de guerre, en
prévenir la rupture; opération dont un ennemi ne calcule jamais les conséquences
que pour l’intérêt du moment, ainsi que l’ont fait les Anglais en coupant les
digues du canal d’Alexandrie, comme on le dira en parlant de ce canal.
Pline dit que cette mer étoit supérieure de trois coudées [environ cinq pieds]
aux terres de l’Egypte. Mais rien de plus vague que cette expression : car à quel
point du sol, dont la pente suit assez régulièrement celle du fleuve, attribuer cette
élévation de trois coudées! à moins qu’il n’ait voulu parler des marées. Il seroit
possible, en effet, que les eaux du Nil qui n’auroient pas d’écoulement dans ce
golfe, pussent encore s’élever jusqu’au niveau de la basse mer à Soueys, leur pente
paraissant suffisante pour que, pendant la durée de la crue, les eaux arrivent dans
ce port à trois coudées en contre-bas des hautes mers.
Strabon traite de chimérique la crainte que l’on avoit que le sol de l’Egypte ne
fut inondé (2) par la mer Rouge, quoique les auteurs qui l’ont précédé, et notamment
Aristote, disent formellement que cette considération seule détermina
Sesostris et Darius à ne point terminer le canal.
Après avoir exposé ces diverses opinions, nous admettrons que la navigation de
ce canal a pu avoir lieu sous les Ptolémées , mais qu’elle a dû éprouver bien des
obstacles qui en ont amené l’abandon. Cet abandon a pu résulter du peu de durée de
la navigation, soumise a 1 abondance des crues, qui, dans leurs variations annuelles,
devoient etre souvent insuffisantes pour fournir a la dépense d’eau nécessaire au
passage des bateaux par leuripe, et réparer les pertes causées par les filtrations
et les évaporations; du peu de pente qui existe entre le point de la prise d’eau et
celui de la basse mer à Soueys, pente qui pouvoit n’être, sur 33 lieues de longueur,
que de quatre à cinq pieds dans les crues moyennes; des curemens annuels
et des travaux d’entretien, dont l’exécution dispendieuse exigeoit une surveillance
quil etoit difficile d obtenir au milieu des déserts. Il a pu provenir encore des
r ^ \ me dc veë*tat'ton n est ici qu une expression a cause de sa forme d'arbrisseau que les Arabes appellent
guree; car on sait que les coraux, comme les madré- le corail, chïâb [ramifications],
p , ormes par les polypes. L accroissement de ces (2) Un des commentateurs de Strabon défend cet
yp ca caires est te l, que les plages et les cotes de- auteur du reproche qu’on lui fait d’avoir soutenu cette
nnent inaccessi es a la navigation. C ’est sans doute assertion. Voyr^ Appendice, / , I V , n,° m .
É . M . M