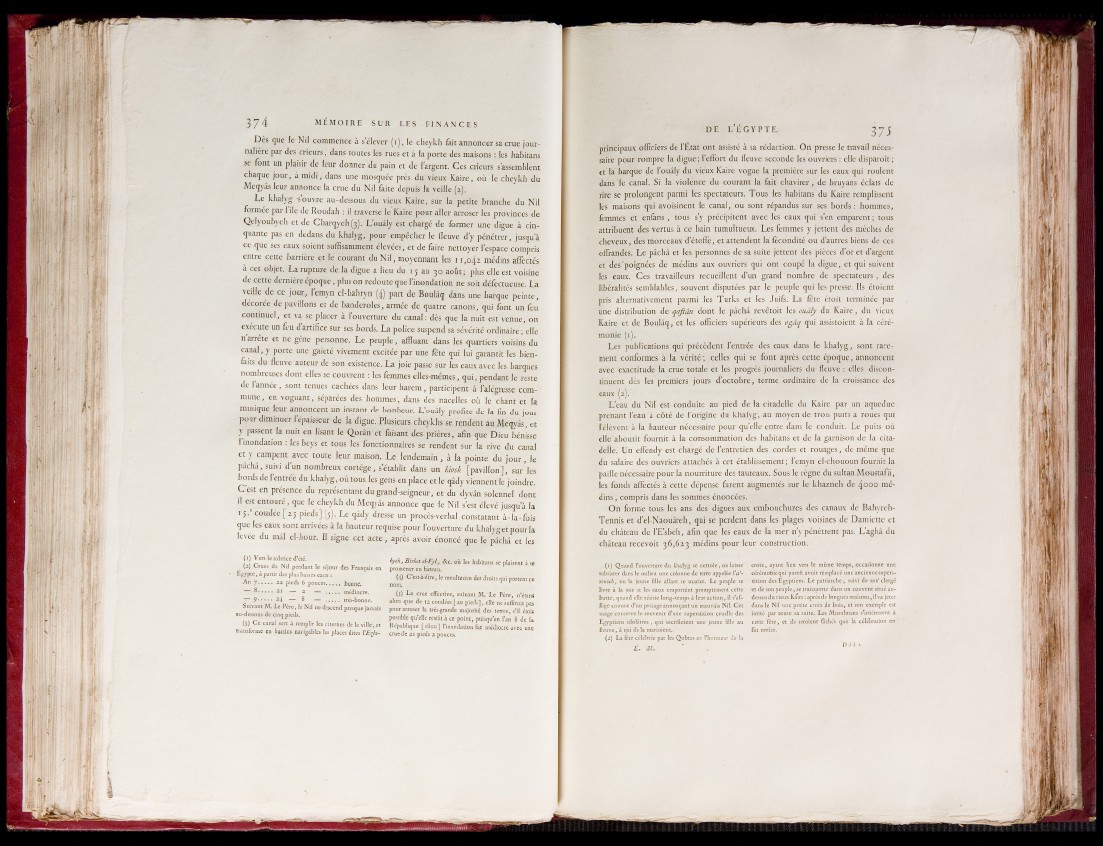
3 7 4 M É M O I R E S U R L E S F I N A N C E S
Des que Je Nil commence à s élever (1), le cheykh fait annoncer sa crue journalière
par des crieurs, dans toutes les rues et à la porte des maisons : les habitans
se font un plaisir de leur donner du pain et de l’argent. Ces crieurs s’assemblent
chaque jour, à midi, dans une mosquée près du vieux Kaire, où le cheykh du
Meqyâs leur annonce la crue du Nil faite depuis la veille (2).
Le khalyg -s’ouvxe au-dessous du vieux Kaire, sur la petite branche du Nil
formée par 1 île de Roudah : il traverse le Kaire pour aller arroser les provinces de
Qelyoubyeh et de Charqyeh (3). L'ouâiy est chargé de former une digue à cinquante
pas en dedans du khalyg, pour empêcher le fleuve d’y pénétrer, jusqu’à
ce que ses eaux soient suffisamment élevées, et de faire nettoyer l’espace compris
entre cette barrière et le courant du Nil, moyennant les 11,042 médins affectés
à cet objet La rupture de la digue a lieu du 15 au 30 août; plus elle est voisine
de cette dernière époque, plus on redoute que l’inondation ne soit défectueuse. La
veille de ce jour, lemyn el-bahryn (4) part de Boulâq dans une barque peinte,
décoree de pavillons et de banderoles, armée de quatre carions, qui font un feu
continuel, et va se placer à 1 ouverture du canal : dès que la nuit est venue, on
exécute un feu d artifice sur ses bords. La police suspend sa sévérité ordinaire ; elle
n arrête et ne gêne personne. Le peuple, affluant dans les quartiers voisins du
canal, y porte urie gaieté vivement excitée par une fête qui lui garantit les bienfaits
du fleuve auteur de son existence. La joie passe sur les eaux avec les barques
nombreuses dont elles se couvrent : les femmes elles-mêmes, qui, pendant le reste
de 1 année, sont tenues cachées dans leur harem, participent à l’alégresse commune,
en voguant, séparées des hommes, dans des nacelles où le chant et la
musique leur annoncent un instant de bonheur. L’ouâiy profite de la fin du jour
pour diminuer l’épaisseur de la digue. Plusieurs cheykhs se rendent au Meqyâs, et
y passent la nuit en lisant le Qorân et faisant des prières, afin que Dieu bénisse
1 inondation : les beys et tous les fonctionnaires se rendent sur la rive du canal
et y campent avec toute leur maison. Le lendemain, à la pointe du jo u r, le
Pâchâ, suivi d’un nombreux cortège, s’établit dans un kiosk [pavillon], sur'les
bords de 1 entrée du khalyg, où tous les gens en place et le qâdy viennent le joindre.
C ’est en présence du représentant du grand-seigneur, et du dyvân solennel dont
d est entouré, que le cheykh du Meqyâs annonce que le Nil s’est élevé jusqu’à la
15. coudée [zy pieds] (y). Le qâdy dresse un procès-verbal constatant à-la-fois
que les eaux sont arrivées à la hauteur requise pour l’ouverture du khalyg et pour la
levée du mil cl-hour. Il signe cet acte, après avoir énoncé que le pâchâ et les
V*; vers ie solstice a ete.
, (2) Crues du N il pendant le séjour Egypte, a partir des plus basses eaux : des Français en
■An 7 ......... 22 pieds 6 pouces....... bonne.
8......... 21 — 2. — ....... médiocre.
Suiv a9n..t. .M..... .L2e4 P èr—e, le8 N il —ne de..s.c..e.n. dtr èpsr-ebsoqnunee j.amais au-dessous de cinq pieds.
Í3) C e canal sert a remplir les citernes de la ville, et
transforme en bassins navigables les places dites YEtfepkyroemh,
e Bnierrk eent ebl-aFteyalu, .&c. où les habitans se plaisent à s
nom(4.) C’est-à-dire, le moultezim des droits qui portent c
(5) Ea crue effective, suivant M . Le Père, n’étan
alors que de 12 coudées [20 pieds], elle ne suffirait pa
ppoosusri balrer oqsue’re lllae rteresstâ-gt ràa ncdee pmoianjot,r iptéu idsqesu ’etenr rle’asn, s8’i l déet o1i
cRréupeu dbel i2q1u ep i[e1d8s 020 p]o lu’icneosn, dation fut médiocre avec un.
principaux officiers de l'Etat ont assisté à sa rédaction. On presse le travail nécessaire
pour rompre la digue ; l’effort du fleuve seconde les ouvriers : elle disparoît ;
et la barque de l’ouâiy du vieux Kaire vogue la première sur les eaux qui roulent
dans le canal. Si la violence du courant la fait chavirer, de bruyans éclats de
rire se prolongent parmi les spectateurs. Tous les habitans du Kaire remplissent
les maisons qui avoisinent le canal, ou sont répandus sur ses bords : hommes,
femmes et enfàns, tous s’y précipitent avec les eaux qui s’en emparent; tous
attribuent des vertus à ce bain tumultueux. Les femmes y jettent des mèches de
cheveux, des morceaux d’étoffe, et attendent la fécondité ou d’autres biens de ces
offrandes. Le pâchâ et les personnes de sa suite jettent des pièces d’or et d’argent
et des’poignées de médins aux ouvriers qui ont coupé la digue, et qui suivent
les eaux. Ces travailleurs recueillent d’un grand nombre de spectateurs, des
libéralités semblables, souvent disputées par le peuple qui les presse. Ils étoient
pris alternativement parmi les Turks et les Juifs. La fête étoit terminée par
une distribution de qaftân dont le pâchâ revêtoit les ouâly du Kaire, du vieux
Kaire et de Boulâq, et les officiers supérieurs des ogâq qui assistoient à la céré- .
monie (i).
Les publications qui précèdent l’entrée des eaux dans le khalyg, sont rarement
conformes à la vérité ; celles qui se font après cette époque, annoncent
avec exactitude la crue totale et les progrès journaliers du fleuve : elles discontinuent
dès les premiers jours d’octobre, terme ordinaire de la croissance des
eaux (2).'
L’eau du Nil est conduite au pied de la citadelle du Kaire par un aqueduc
prenant l’eau à côté de l’origine du khalyg, au moyen de trois puits à roues qui
l’élèvent à la hauteur nécessaire pour qu’elle entre dans le conduit. Le puits où
elle aboutit fournit à la consommation des habitans et de la garnison de la citadelle.
Un effendy est chargé de l’entretien des cordes et rouages, de même que
du salaire des ouvriers attachés à cet établissement ; l’emyn ei-chououn fournit la
paille nécessaire pour la nourriture des taureaux. Sous le règne du sultan Moustafa,
les fonds affectés à cette dépense furent augmentés sur le khazneh de 4ooo médins
, compris dans les sommes énoncées.
On forme tous les ans des digues aux embouchures des canaux dé Bahyreh*
Tennis et d’el-Naouâreh, qui se perdent dans les plages voisines de Damiette et
du château de l’E’sbeh, afin que les eaux de la mer n’y pénètrent pas. L’aghâ du
château recevoit 36,623 médins pour leur construction.
(1) Quand l’ouverture du khalyg se nettoie, on laisse
subsister dans le milieu une colonne de terre appelée Va’-
rouseh, ou la jeune fille allant se marier. Le peuple se
livre à la joie si les eaux emportent promptement cette
butte ; quand elle résiste long-temps à leur action, il s’affulsigaeg
ec ocmonmseer vde’u lne psoréusvaegnei ar ndn’uonneç asnut puenr smtitaiuovna cisr uNeilll.e Cdeest
Egyptiens idolâtres, qui sacrifioient une jeune fille au
fleuve, à qui ils la marioient.
(2) La fête célébrée par les Qobtes en l’honneur de la
Ê. M.
croix, ayant lieu vers le même tem ps, occasionne une
cérémohie qui paroît avoir remplacé une ancienne superstition
des Egyptiens. Le patriarche, suivi de son' clergé
et de son peuple, se transporte dans un couvent situé au-
dessus du vieux Kaire : après de longues oraisons, il va jeter
dans le Nil une petite croix de bois, et son exemple est
imité par toute sa suite. Les Musulmans s’intéressent à
cette fete, et ils seroient fâchés que la célébration e n '-
fut omise.