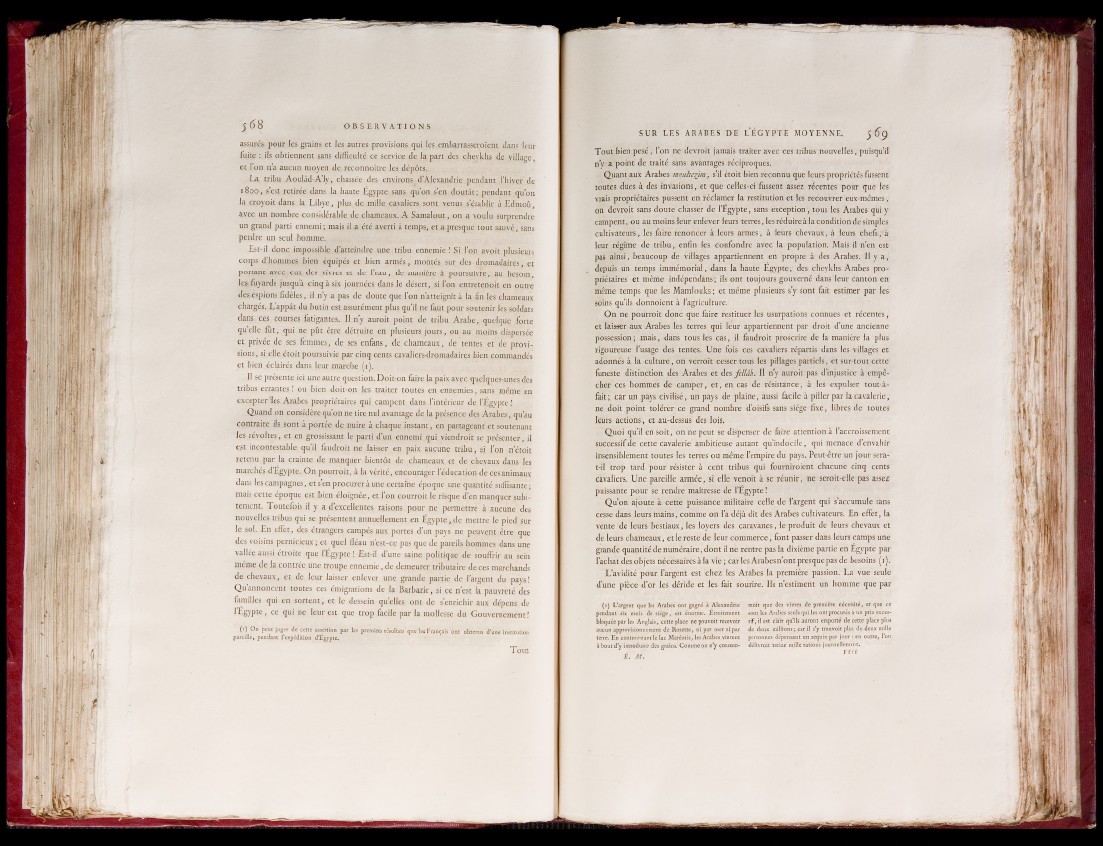
J 6 8 O B S E R V A T I O N S
assurés pour les grains et les autres provisions qui les .embarrasseraient dans leur
fuite : ils obtiennent sans difficulté ce service de la part des cbeyklis de village,
et l’on n’a aucun moyen de reconnoître les dépôts.
La tribu Aoulâd-A’ly, chassée des environs d’Alexandrie pendant l’hiver de
1800, s’est retirée dans la haute Egypte sans qu’on s’en doutât; pendant qu’on
la croyoit dans la Libye, plus de mille cavaliers sont venus s’établir à Edmoâ,
avec un nombre-considérable de chameaux. A Samalout, on a voulu surprendre
un grand parti ennemi ; mais il a été averti à temps, et a. presque tout sauvé, sans
perdre un seul homme.
Est-il donc impossible d’atteindre une tribu ennemie ! Si l’on avoit plusieurs
corps d’hommes bien équipés et bien armés, montés sur des dromadaires, et
portant avec eux des vivres et de l’eau, de manière à poursuivre, au besoin,
les fuyards jusqua cinq à six journées dans le désert, si l’on entretenoit en outre
des espions fidèles, il n’y a pas de doute que l’on n’atteignît à la fin les chameaux
chargés. L’appât du butin est assurément plus qu’il ne faut pour soutenir les soldats
dans ces courses fatigantes. Il n’y auroit point de tribu Arabe, quelque forte
qu’elle fût, qui ne pût être détruire en plusieurs jours, ou au moins dispersée
et privée de ses femmes, de ses enfàns, de chameaux, de tentes et de provisions,
si elle étoit poursuivie par cinq cents cavaliers-dromadaires bien commandés
et bien éclairés dans leur marche (1).
Il se présente ici une autre question. Dojt-on faire la paix avec quelques-unes des
tribus errantes ! ou bien doit-on les traiter toutes en ennemies, sans même en
excepter'les Arabes propriétaires qui campent dans l’intérieur de l’Egypte f
Quand on considère qu’on ne tire nul avantage de la présence des Arabes, qu’au
contraire ils sont à portée de nuire à chaque instant, en partageant et soutenant
les révoltes, et en grossissant le parti d’un ennemi qui viendrait se présenter, il
est incontestable qu’il faudroit ne laisser en paix aucune tribu, si l’on n’étoit
retenu par la crainte de manquer bientôt de chameaux et de chevaux dans les
marchés d Egypte. On pourroit, à la vérité, encourager l’éducation de ces animaux
dans les campagnes, et s’en procurer à une certaine époque une quantité suffisante;
mais cette époque est bien éloignée, et l’on courroit le risque d’en manquer subitement.
Toutefois il y a d’excellentes raisons pour ne permettre à aucune des
nouvelles tribus qui se présentent annuellement en Egypte ^de mettre le pied sur
le sol. En effet, des étrangers campés aux portes d’un pays ne peuvent être que
des voisins pernicieux ; et quel fléau n’est-ce pas que de pareils hommes dans une
vallee aussi étroite que l’Egypte ! Est-il d’une saine politique de souffrir au sein
meme de la contrée une troupe ennemie, de demeurer tributaire de ces marchands
de chevaux, et de leur laisser enlever une grande partie de l’argent du pays [
Quannoncent toutes ces émigrations de la Barbarie, si.ee n’est la pauvreté des
familles qui en sortent, et le dessein qu’elles ont de s’enrichir aux dépens de
l’Egypte, ce qui ne leur est que trop facile par la mollesse du Gouvernement 1
fi) O n peur juger de certe assertion par les premiers résultats que les Français ont obtenus pareille, pendant l’expédition d’.Égypte. d'une instituiion
Tout
*
S U R L E S A R A B E S D E l ’ É G Y P T E M O Y E N N E . j 6 ç
Tout bien pesé, l’on ne devrait jamais traiter avec ces tribus nouvelles, puisqu’il
n’y a point de traité sans avantages réciproques.
Quant aux Arabes moidtciim, s’il étoit bien reconnu que leurs propriétés fussent
toutes dues à des invasions, et que Celles-ci fussent assez récentes pour que les
vrais propriétaires pussent en réclamer la restitution et les recouvrer eux-mêmes,
on devroit sans doute chasser de l’Egypte, sans exception, tous les Arabes qui y
campent, ou au moins leur enlever leurs terres, les réduire à la condition de simples
cultivateurs, les faire renoncer à leurs armes, à leurs chevaux, à leurs chefs, à
leur régime de tribu, enfin les confondre avec la population. Mais il n’en est
pas ainsi, beaucoup de villages appartiennent en propre à des Arabes. Il y a,
depuis un temps immémorial, dans la haute Egypte, des cheykhs Arabes propriétaires
et même indépendans', ils ont toujours gouverné dans leur canton en
même temps que les Mamlouks ; et même plusieurs s’y sont fait estimer par les
soins qu’ils donnoient à l’agriculture.
On ne pourroit donc que faire restituer les usurpations connues et récentes,
et laisser aux Arabes les terres qui leur appartiennent par droit d’une ancienne
possession ; mais, dans tous les cas, il faudroit proscrire de la manière la plus
rigoureuse l’usage des tentes. Une fois ces cavaliers répartis dans les villages et
adonnés à la culture, on verrait cesser tous les pillages partiels, et sur-tout cette
funeste distinction des Arabes et des fcllâh. Il n’y auroit pas d’injustice à empêcher
ces hommes de camper, et, en cas de résistance, à les expulser tout-à-
fait; car un pays civilisé, un pays de plaine, aussi facile à piller par la cavalerie,
ne doit point tolérer ce grand nombre d’oisifs sans siège fixe, libres de toutes
leurs actions, et au-dessus des lois.
Quoi qu’il en soit, on ne peut se dispenser de faire attention à l’accroissement
successif de cette cavalerie ambitieuse autant qu’indocile, qui menace d’envahir
insensiblement toutes les terres ou même l’empire du pays. Peut-être un jour sera-
t-il trop tard pour résister à cent tribus qui fourniroient chacune cinq cents
cavaliers. Une pareille armée, si elle venoit à se réunir, ne seroit-elle pas assez
puissante pour se rendre maîtresse de l’Egypte !
Qu’on ajoute à cette puissance militaire celle de l’argent qui s’accumule sans
cesse dans leurs mains,!comme on l’a déjà dit des Arabes cultivateurs. En effet, la
vente de leurs bestiaux, les loyers des caravanes, le produit de leurs chevaux et
de leurs chameaux, et le reste de leur commerce, font passer dans leurs camps une
grande quantité de numéraire, dont il ne rentre pas la dixième partie en Egypte par
l’achat des objets nécessaires à la vie ; car les Arabes n’ont presque pas de besoins (1).
L’avidité pour l’argent est chez les Arabes la première passion. La vue seule
d’une pièce d’or les déride et les fait sourire. Ils n’estiment un homme que par
pen(1d)a nLt’ asrigxe nmt oqius e dlees sAièrgaeb,e s esotn té ngoargmnée . àÉ Atrloeixtaenmderniet msoonitt leqsu Ae radbees s vsievurless qudie l epsr eomnti èprreo cnuércées sàs iutén, perti xq euxec ecse-
bloquée par les Anglais, cette place ne pouvoit recevoir sif, il est clair qu’ils auront emporté de cette place plus
ateurcreu.n E anp pcroonvtiosiuornnnaenmt leen lta dc eM Raorésoetttise,, lnesi Aparar bmese vr innir epnart pdeer sdoenunxe s mdiélplieonnssa;n cta ur nil sse’yqu tirno upvaor ijto pulru s: edne odueutrxe ,m l’iollne
à bout d’y introduire des grains. Comme on n’y consom- délivroit treize mille rations journellement.