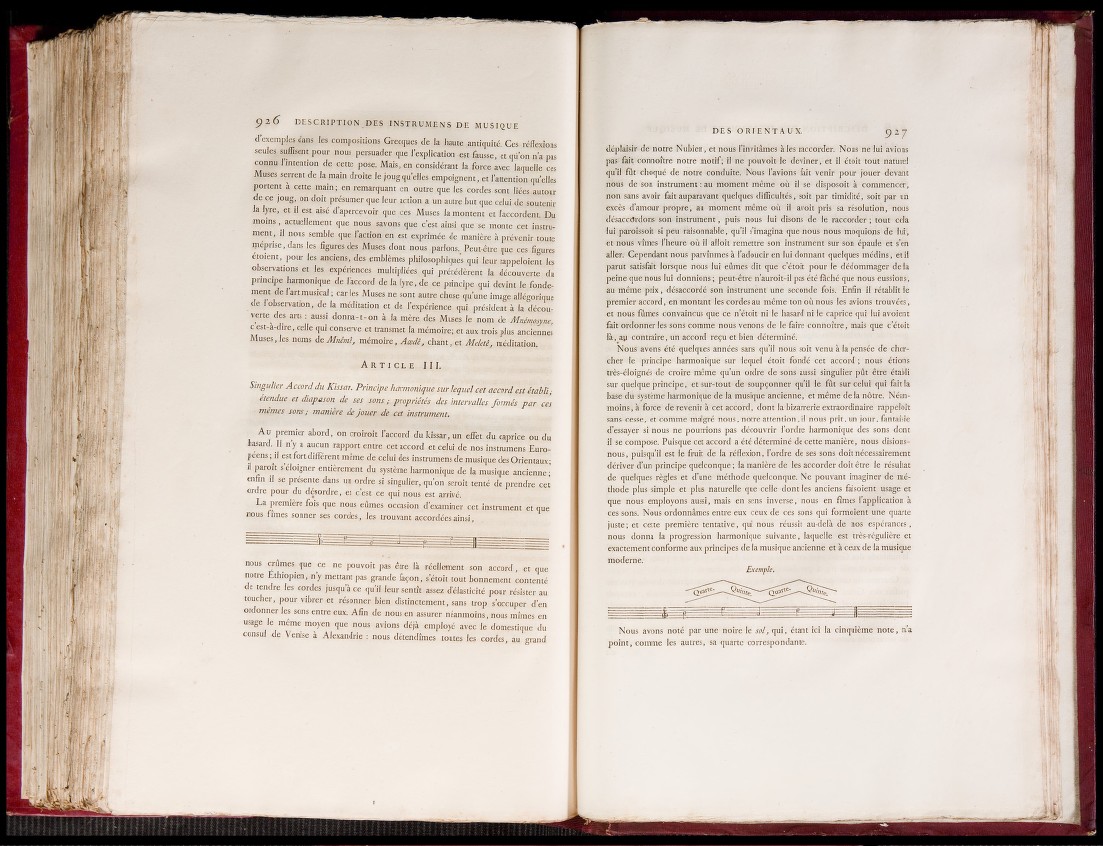
Ç } 2 ( ) D E S C R I P T I O N D E S I N S T R U M E N S D E M U S I Q U E
d’exemples dans les compositions Grecques de la haute antiquité. Ces réflexions
seules suffisent pour nous persuader que l’explication est fausse, et qu on n’a pas
connu 1 intention de cette pose. Mais, en considérant la force avec laquelle ces
Muses serrent de la main droite le joug qu’elles empoignent, et l’attention quelles
portent à cette main; en remarquant en outre que les cordes sont liées autour
de ce joug, on doit présumer que leur action a un autre but que celui de soutenir
la lyre, et il est aisé ¿apercevoir que ces Muses la montent et l’accordent. Du
moins, actuellement que nous savons que c’est ainsi que se monte cet instrument,
il nous semble que l’action en est exprimée de manière à prévenir toute
ijiépnse, dans les figures des Muses dont nous parlons^ Peut-être que ces figures
e.toient, pour les anciens, des emblèmes philosophiques qui leur rappeloient les
observations et les expériences multipliées qui précédèrent la découverte du
principe harmonique de l’accord de la lyre, de ce principe qui devint le fondement
de l’art musical ; car les Muses ne sont autre chose qu’une image allégorique
de 1 observation, de la méditation et de l’expérience qui président à la découverte
des arts : aussi donna-t-on à Ja mère des Muses le nom de Mnemosyne,
c est-à-dire, celle qui conserve et transmet la mémoire ; et aux trois plus anciennes
Muses, les noms de Mnémê, mémoire, Acedê, chant, et Meletê, méditation.
A r t i c l e I I I .
Singulier Accord du Kissar. Principe harmonique sur lequel cet accord est établi;
étendue et diapason de ses sons; propriétés des intervalles formés p a r ces
mew.es sons ; maniéré de jouer de cet instrument,
A u premier abord, on croirait l’accord du kissar, un effet du caprice ou du
hasard. II n y a aucun rapport entre cet accord et celui de nos instrumens Européens
H1 est fort différent même de celui des instrumens de musique des Orientaux;
il paraît s’éloigner entièrement du système harmonique de la musique ancienne;
enfin il se présente dans un ordre si singulier, qu’on seroit tenté de prendre cet
ordre pour du désordre, et c ’est ce qui nous est arrivé.
La première fois que nous eûmes occasion d’examiner cet instrument et que
nous fîmes sonner ses cordes, les trouvant accordées ainsi.
nous crûmes que ce ne pouvoit pas être là réellement son accord, et que
notre Ethiopien, n y mettant pas grande façon, s’étoit tout bonnement contenté
de tendre les cordes jusqu’à ce qu’il leur sentît assez d’élasticité pour résister au
toucher, pour vibrer et résonner bien distinctement, sans trop s’occuper d’en
ordonner les sons entre eux. Afin de nous en assurer néanmoins, nous mîmes en
usage le même moyen que nous avions déjà employé avec le domestique du
consul de Venise à Alexandrie : nous détendîmes toutes les cordes, au grand
déplaisir de notre Nubien, et nous l’invitâmes à les raccorder. Nous ne lui avions
pas fait connoître notre motif; il ne pouvoit le deviner, et il étoit tout naturel
qu’il fût choqué de notre conduite. Nous l’avions fait venir pour jouer devant
nous de son instrument : au moment même où il se disposoit à commencer,
non sans avoir fait auparavant quelques difficultés, soit par timidité, soit par un
excès d’amour propre, au moment même où il avoit pris sa résolution, nous
désaccordons son instrument, puis nous lui disons de le raccorder ; tout cela
lui paroissoit si peu raisonnable, qu’il s’imagina que nous nous moquions de lui,
et nous vîmes l’heure où il alloit remettre son instrument sur son épaule et s’en
aller: Cependant nous parvînmes à l’adoucir en lui donnant quelques médins, et il
parut satisfait lorsque nous lui eûmes dit que c’étoit pour le dédommager de la
peine que nous lui donnions ; peut-être n’auroit-il pas été fâché que nous eussions ,
au même prix, désaccordé son instrument une seconde fois. Enfin il rétablit le
premier accord, en montant les cordes au même ton où nous les avions trouvées,
et nous fûmes convaincus que ce n’étoit ni le hasard ni le caprice qui lui avoient
fait ordonner les sons comme nous venons de le faire connoître, mais que c’étoit
là, ap contraire, un accord reçu et bien déterminé.
Nous avons été quelques années sans qu’il nous soit venu à la pensée de chercher
le principe harmonique sur lequel étoit fondé cet accord ; nous étions
très-éloignés de croire même qu’un ordre de sons aussi singulier pût être établi
sur quelque principe, et sur-tout de soupçonner qu’il le fût sur celui qui fait la
base du système harmonique de la musique ancienne, et même de la nôtre. Néanmoins,
à force de revenir à cet accord, dont la bizarrerie extraordinaire rappelbit
sans cesse, et comme malgré nous, notre attention, il nous prit, un jour, fantaisie
d’essayer si nous ne pourrions pas découvrir l’ordre harmonique des sons dont
il se compose. Puisque cet accord a été déterminé de cette manière, nous disions-
nous, puisqu’il est le fruit de la réflexion, l’ordre de ses sons doit nécessairement
dériver d’un principe quelconque ; la manière de les accorder doit être le résultat
de quelques règles et d’une méthode quelconque. Ne pouvant imaginer de méthode
plus simple et plus naturelle que celle dont les anciens faisoient usage et
que nous employons aussi, mais en sens inverse, nous en fîmes l’application à
ces sons. Nous ordonnâmes entre eux ceux de ces sons qui formoient une quarte
juste ; et cette première tentative, qui nous réussit au-delà de nos espérances,
nous donna la progression harmonique suivante, laquelle est très-régulière et
exactement conforme aux principes de la musique ancienne et à ceux de la musique
moderne.
Exemple.
Nous avons noté par une noire le sol, qui, étant ici la cinquième note , ira
point, comme les autres, sa quarte correspondante.