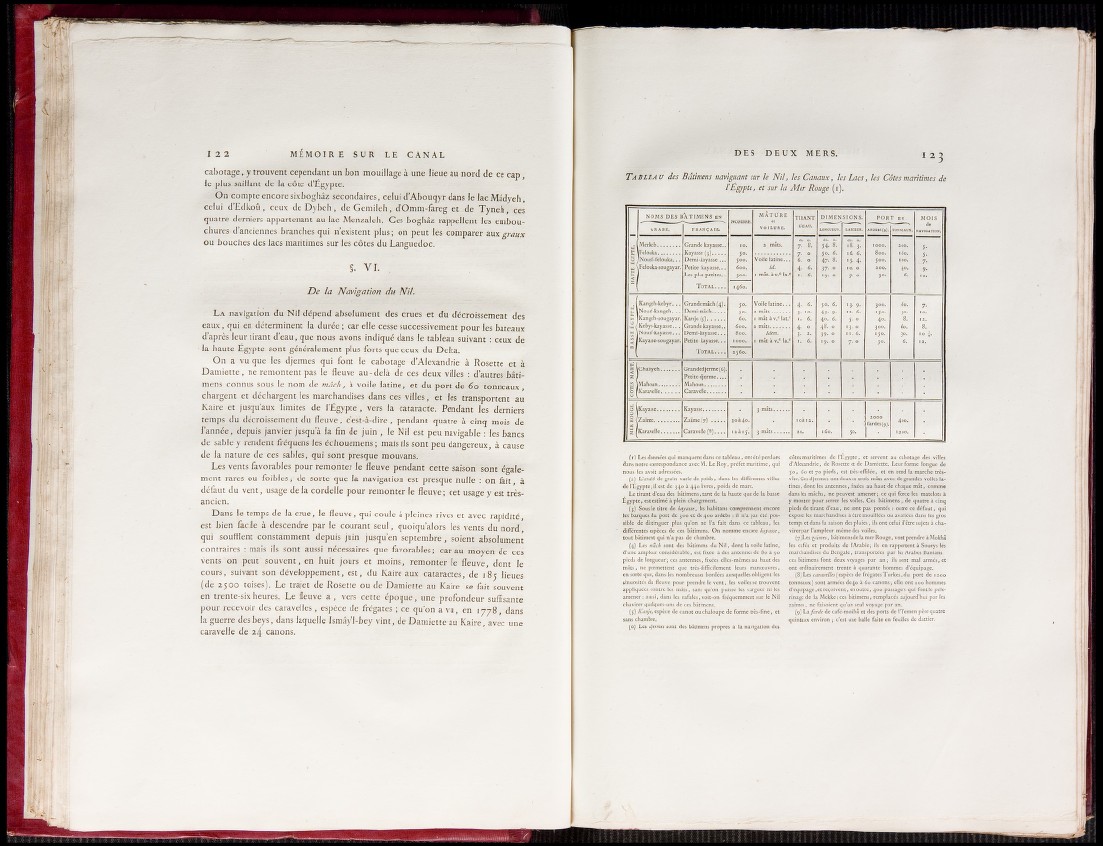
cabotage, y trouvent cependant un bon mouillage à une lieue au nord de ce cap,
le plus saillant de la côte d’Egypte.
On compte encore six boghâz secondaires, celui d’Abouqyr dans le JaeMâdyeh,
celui dEdkoû, ceux de Dybeh, de Gemileh, d’Omm-fàreg et de Tyneh, ces
quatre derniers appartenant au lac Menzaleh. Ces boghâz rappellent les embouchures
d’anciennes branches qui n’existent plus; on peut les comparer aux graux
ou bouches des lacs maritimes sur les côtes du Languedoc.
s. V I .
De la Navigation du N il•
1 1 I L a navigation du Nil dépend absolument des crues et du décroissement des
eaux, qui en déterminent la durée ; car elle cesse successivement pour les bateaux
d’après leur tirant d’eau, que nous avons indiqué dans le tableau suivant : ceux de
| Ü! | j la haute Egypte sont généralement plus forts que ceux du Delta.
' ' ' 0 ° a vu que les djermes qui font le cabotage d’Alexandrie à Rosette et à
Damiette, ne remontent pas le fleuve au-delà de ces deux villes : d’autres bâti-
mens connus sous le nom de mâch, à voile latine, et du port de 60 tonneaux,
chargent et déchargent les marchandises dans ces villes, et les transportent au
Kaire et jusqu’aux limites de l’Égypte, vers la cataracte. Pendant les derniers
temps du décroissement du fleuve, c’est-à-dire , pendant quatre à cinq mois de
l’année, depuis janvier jusqu’à la fin de juin , le Nil est peu navigable : les bancs
1 de sable y rendent fréquens les échouemens; mais ils sont peu dangereux, à cause
de la nature de ces sables, qui sont presque mouvans.
Les vents favorables pour rem onter le fleuve pendant cette saison sont également
rares ou foibles; de sorte que la navigation est presque nulle : on fait, à
défaut du vent, usage de la cordelie pour rem onter le fleuve; cet usage y est très-
ancien.
| j M j Dans le temps de la crue, le fleuve, qui coule à pleines rives et avec rapidité,
est bien facile à descendre par le courant seul, quoiqu’alors les vents du nord
qui soufflent constamment depuis juin jusqu’en septembre, soient absolument
contraires : mais ils sont aussi nécessaires que favorables; car au moyen de ces
vents on peut souvent, en huit jours et moins, remonter le fleuve, dont le
cours, suivant son développement, est, du Kaire aux cataractes, de 185 lieues
(de 2500 toises). Le trajet de Rosette ou de Damiette au Kaire se fait souvent
en trente-six heures. Le fleuve a , vers cette époque, une profondeur suffisante
pour recevoir des caravelles, espèce de frégates ; ce qu’on a vu, en 1778, dans
la guerre des beys, dans laquelle Ismây’i-bey vint, de Damiette au Kaire, avec une
caravelle de 24 canons.
ËJfc ¡V 1
T a b l e a u des Bâtimens naviguant sur le Nil, les Canaux, les Lacs, les Côtes maritimes de
l’Egypte, et sur la Mer Rouge (i).
N OM S D E S B A T IM E N S en
NOMBRE.
M Â T U R E TIRANT D IM E N S IO N S . P O R T en M O IS
ARABE. FRANÇAIS» VOILURE. d ’kau.
LONGUEUR. LARGEUR. ARDEBS (a). TONNEAUX.
de
NAVIGATION.
Grande kayasse.. 2 mâts.
ils. 0.
7 . 8.
ds. 0.
54. 8.50. 6.
4 7 . 8.
37. 0
19. 0
ds. 0.
u $•
£ s»
0
•M
H
s
<
- 5°-
500. 6 00.
300.
Nousf-feloufca.. .
Fclouka-sougayar.
Demi-kayasse . . .
Petite kayasse.. .
Les plus p e tite s ..
V o ile la t in e ... id.
1 mât. à v .c la.c
6. 0
4. 6.
1. 6.
15. 4.
IO. O
7 . O
• Joo.
200.
3° .
100.
40. 6.
7-
9 •
12.
T o t a l . . . . 1460.
H
Kangeh-kebyr, . .
Nousf-kangeh, . .
Kangeh-sougayar.
Kcbyr-kayasse.. .
Nousf-kayasse.. .
Kayasse-sougayar.
Grande mâch (4).
Demi-mâch..........
50.
5° .
Vo ile la t in e .. .
2 m â ts . . . . . . .
4. 6.
3. 10.
50. 6.
4). 9.
13. 9.12. 6.
3. 0
13. 0
I I . 6.
7 . 0
300.
150.
60.
3°* 8.
7-
10.
O
w
< 1
Grande kayasse..
D em i-k a ya s se .. .
Petite ka yasse.. .
6 00.
800.
1000.
2 m â ts .............. Idem.
1 mât à v .c la.0
4. 0
3. 2.
1 . 6.
48. O
39. O
I9. O
300.
130.
3° .
60.
3° . 6.
8.
IO 7.
12.
T o t a l . . . . 2560.
H 1
Grandedjerme (6).
P etite-dje rme.. . .
<S
*
H
p
° 30340.
12 a 15,
.2000
400.
S I (8 ).... l6o. fardes (9).
Caravelle 20. 50.
1200. - 3
( f ) Les données qui manquent dans ce tableau, ont été perdues
dans notre correspondance avec M. Le Roy, préfet maritime, qui
nous les avoit adressées.
(2) L'ardel de grain varie de poids, dans les différentes villes
de l’Egypte; il est de 340 à 440 livres, poids de marc.
Le tirant d’eau des bâtimens-, tant de la haute que de la basse
Egypte, est estimé à plein chargement.
(3) Sous le titre de kayasst, les habitans comprennent encore
les barques du port de 3 00 et de 400 ardebs : il n’a pas été possible
de distinguer plus qu’on ne l’a fait dans ce tableau, les
différentes espèces de ces bâtimens. On nomme encore Rayasse,
tout bâtiment qui n’a pas de chambre.
(4) Les mâch sont des bâtimens du Nil, dont la voile latine,
d’une ampleur considérable, est fixée à des antennes de 80 à 90
pieds de longueur*; ces antennes , fixées elles-mêmes au haut des
mâts, ne permettent que très-difficilement leurs manoeuvres,
en sorte que, dansd.es nombreuses bordées auxquelles obligent les
sinuosités du fleuve pour prendre le vent i les voiles se trouvent
appliquées contre les mâts, sans qu’on puisse les carguer ni les
amener : aussi, dans les rafales, voit-on fréquemment sur le Nil
chavirer quelques-uns de ces bâtimens.
(5) Kanje, espèce de canot ou chaloupe de forme très-fine, et
san(6s )chambre. Les djermes sont des bâtimens propres à la navigation des
côtes maritimes de l’Egypte, et servent au cabotage des villes
d’Alexandrie, de Rosette et de Damiette. Leur forme longue de
50, 60 et 70 pieds, est très-effilée, et en rend la marche très-
vîte. Ces djermes ont deux et trois mâts avec de grandes voiles latines,
dont les antennes, fixées au haut de chaque mât, comme
dans les mâchs, ne peuvent amener; ce qui force les matelots à
y monter pour serrer les voiles. Ces bâtimens , de quatre à cinq
pieds de tirant d’eau, ne sont pas pontés : outre ce défaut, qui
expose les marchandises à être mouillées ou avariées dans les gros
temps et dans la saison des pluies, ils ont celui d’être sujets à chavirer
par l’ampleur même des voiles.
(7) Les idimes, bâtimens de la mer Rouge, vont prendre à Mokhâ
les cafés et produits de l’Arabie; ils en rapportent à Soueys les
marchandises du Bengale, transportées par les Arabes Banians
ces bâtimens font deux voyages par an; ils sont mal armés, et
ont ordinairement trente à quarante hommes d’équipage.
(8) Les caravelles (espèce de frégates Turkes, du port de 1200
tonneaux) sont armées de 40 à 60 canons; elles ont 200 hommes
d’équipage, et reçoivent, en outre, 400 passagers qui fontle pèlerinage
de la Mckkc: ces bâtimens, remplacés aujourd’hui par les
zaïmes, ne faisoient qu’un seul voyage par an.
(9) ha farde de café-mokhâ et des ports de l’Yemcn pèse quatre
quintaux environ ; c’est une balle faite en feuilles de dattier.
\