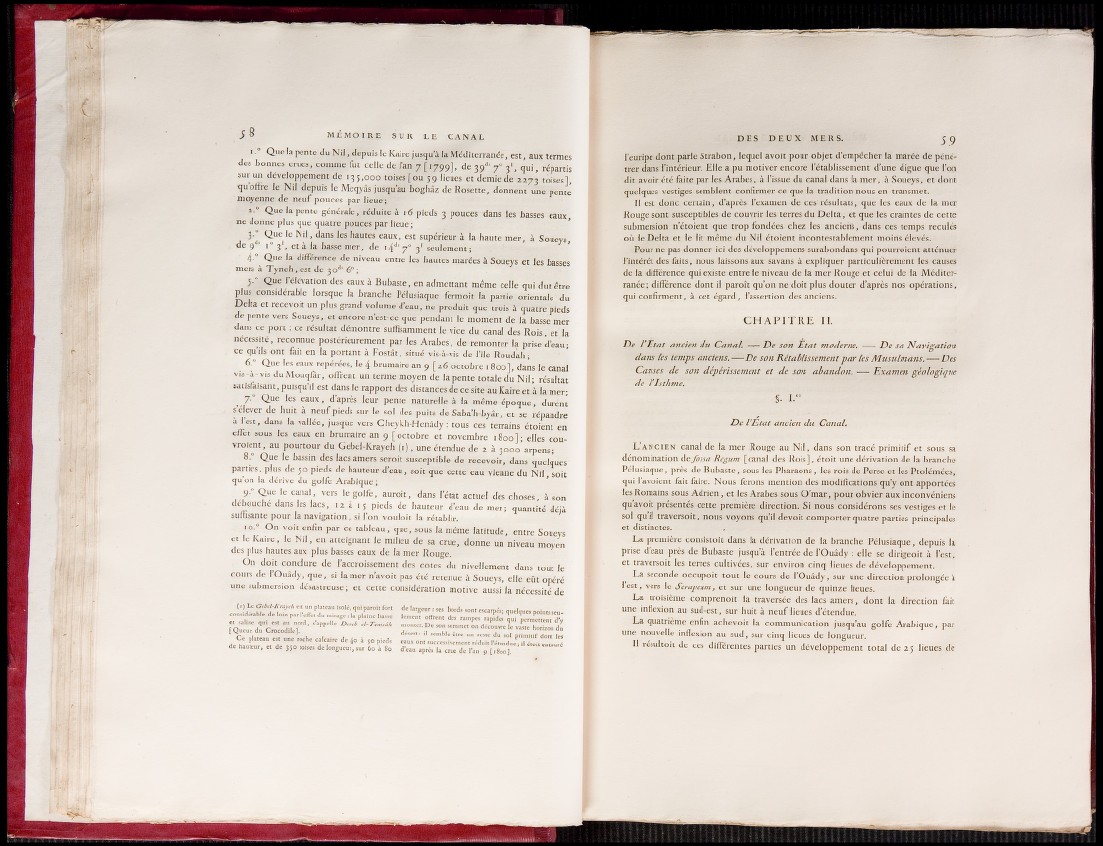
1. Que la pente du Nil, depuis le Kaire jusqu’à la Méditerranée, est, aux termes
des bonnes crues, comme fût celle de l’an 7 [1799], de 39* 7° ¡ g qui, répartis
sur un développement de 135,000 toises [ou 59-lieues et demie de 2273 toises],
qu offre le Nil depuis le Meqyâs jusqu’au boghâz de Rosette, donnent une pente
moyenne de neuf pouces par lieue ;
2. Que la pente générale, réduite à 16 pieds 3 pouces dans les basses eaux,
ne donne plus que quatre pouces par lieue ;
3.° Que le Nil, dans les hautes eaux, est supérieur à la haute mer, à Soueys
de 9 i 3 , et a la basse mer, de i4 ds 7 0 31 seulement;
4- Que la différence de niveau entre les hautes marées à Soueys et les basses
mers à Tyneh, est de 3ods 6° ;
5. Que 1 élévation des eaux à Bubaste, en admettant même celle qui dut être
plus considérable lorsque la branche Pélusiaque fermoit la partie orientale du
Delta et recevoit un plus grand volume d’eau, ne produit que trois à quatre pieds
de pente vers Soueys, et encore n’est-ce que pendant le moment de la basse mer
dans ce port : ce résultat démontre suffisamment le vice du canal des Rois, et la
nécessité, reconnue postérieurement par les Arabes, de remonter la prise d ’eau;
ce qu’ils ont fait en la portant à Fostât, situé vis-à-vis de l’île Roudah;
6.° Que les eaux repérées, le 4 brumaire an 9 [26 octobre 1800], dans le canal
vis-à-vis duMouqfar, offient un terme moyen de la pente totale du Nil; résultat
satisfaisant, puisqu’il est dans le rapport des distances de ce site au Kaire et à la mer;
Que les eaux, d’après leur pente naturelle à la même époque, durent
s élever de huit à neuf pieds sur le sol des puits de Saba’h-byâr, et se répandre
à l’est, dans la vallée, jusqùe vers Cheykh-Henâdy : tous ces terrains étoient en
effet sous les eaux en brumaire an 9 [octobre et novembre 1800]; elles couvraient,
au pourtour du Gebel-Krayeh (1), une étendue de 2 à 3ooo’ arpens;
8. Que le bassin des lacs amers seroit susceptible de recevoir, dans quelques
parties, plus de 50 pieds de hauteur d’eau, soit que cette eau vienne du Nil, soit
quon la dérivé du golfe Arabique;
9.0 Que le canal, vers le golfe, auroit, dans l’état actuel des choses, à son
débouché dans les lacs, 12 à 15 pieds de hauteur d’eau de mer; quantité déjà
suffisante pour la navigation, si l’on vouloit la rétablir.
10. On voit enfin par ce tableau, que, sous la même latitude, entre Soueys
et le Kaire, le N il, en atteignant le milieu de sa crue, donne un niveau moyen
des plus hautes aux plus basses eaux de la mer Rouge.
On doit conclure de l’accroissement des cotes du nivellement dans tout le
cours de l’Ouady, que, si la mer n avoit pas été retenue à Soueys, elle eût opéré
une submersion désastreuse; et cette considération motive aussi la nécessité de
(1) Le Gebel-Krayeh est un plateau isolé, qui parole fort
considérable de loin par l'effet du mirage : la plaine basse
et saline qui est au nord, s’appelle Deneb el-Temsâh
[Q u e u e du Crocodile],
C e plateau est une roche calcaire de 40 à 50 pieds
de hauteur, et de 3J0 toises de longueur, sur 60 à 80
,arSeur : ses bor<ls sont escarpés; quelques points seulement
offrent des rampes rapides qui permettent d’y
monter. D e son sommet on découvre le vaste horizon du
désert: il semble être un reste du sol primitif dont les
eaux ont successivement réduit l’étendue; il étoit entouré
d’eau après la crue de l ’an ÿ [1800].
l’euripe dont parle Strabon, lequel avoit pour objet d’empêcher la marée de pénétrer
dans l’intérieur. Elle a pu motiver encore l’établissement d’une digue que l’on
dit avoir été faite par les Arabes, à l’issue du canal dans la mer, à Soueys, et dont
quelques vestiges semblent confirmer ce que la tradition nous en transmet.
Il est donc certain, d’après l’examen de ces'résultats, que les eaux de la mer
Rouge sont susceptibles de couvrir les terres du Delta, et que les craintes de cette
submersion netoient que trop fondées chez les anciens, dans ces temps reculés
où le Delta et le dit même du Nil étoient incontestablement moins élevés.
Pour ne pas donner ici des développemens surabondans qui pourraient atténuer
l’intérêt des faits, nous laissons aux savans à expliquer particulièrement les causes
de la différence qui existe entre le niveau de la mer Rouge et celui de la Méditerranée;
différence dont il paraît qu’on ne doit plus douter d’après nos opérations,
qui confirment, à cet égard, l’assertion des anciens.
CHAP I TRE II.
De l ’Etat ancien du Canal. —— De son E tat moderne. — De sa Navigation O
dans les temps anciens. •— De son Rétablissement par les Musulmans. — Des
Causes de son dépérissement et de son abandon. — Examen géologique
de l ’Isthme.
%. I "
D e l ’É tat ancien du Canal.
L a n c i e n canal de la mer Rouge au Nil, dans son tracé primitif et sous sa
dénomination defossa Regum [canal des Rois], étoit une dérivation de la branche
Pélusiaque, près de Bubaste, sous les Pharaons, les rois de Perse et les Ptolémées,
qui lavoient fait faire. Nous ferons mention des modifications qu’y ont apportées
les Romains sous Adrien, et les Arabes sous O ’mar, pour obvier aux inconvéniens
qu avoit présentés cette première direction. Si nous considérons ses vestiges et le
sol qu’il traversoit, nous voyons qu’il devoit comporter quatre parties principales
et distinctes.
La première consistoit dans la dérivation de la branche Pélusiaque, depuis la
prise deau près de Bubaste jusqua lentree de lOuâdy : elle se dirigeoit à l’est,
et traversoit les terres cultivées, sur environ cinq lieues de développement.
La seconde occupoit tout le cours de lOuady, sur une direction prolongée à
lest, vers le Serapeum, et sur une longueur de quinze lieues.
La troisième comprenoit la traversée des lacs amers, dont la direction fait
une inflexion au sud-est, sur huit à neuf lieues d’étendue.
La quatrième enfin achevoit la communication jusqu’au golfe Arabique, par
une nouvelle inflexion au sud, sur cinq lieues de longueur.
Il resultoit de ces différentes parties un développement total de 25 lieues de