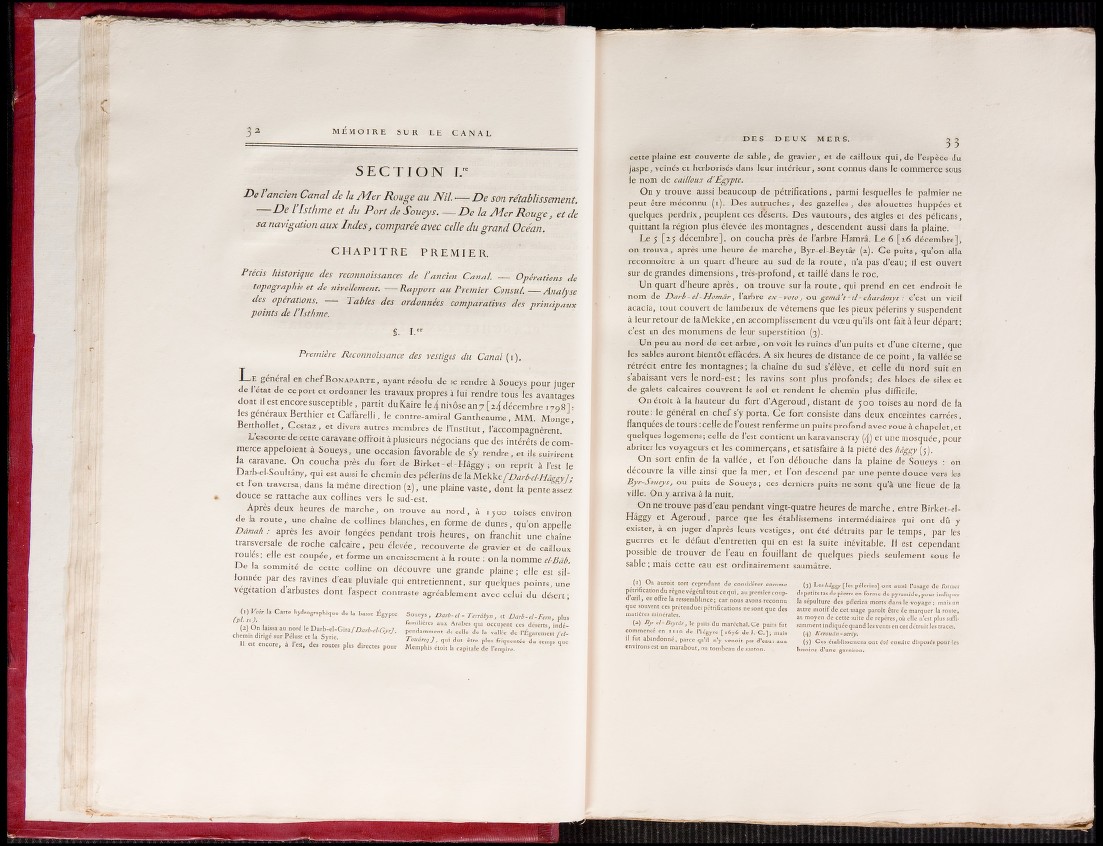
S E C T IO N I.re
D e l ancien Canal de la /lier Rouge au Nil. — — • De son rétablissement.
— De l Isthme et du Port de Soueys. — D e la IVler Rouge, et de
sa navigation aux Indes, comparée avec celle du grand Océan.
C H A P I T R E PREMIER.
Précis historique des reconnaissances de l ’ancien Canal. — Opérations de
topographie et de nivellement. — Rapport au Premier Consul. — Analyse
des opérations. — Tables des ordonnées comparatives des principaux
points de l ’Isthme.
§. I."
Première Reconnaissance des vestiges du Canal (i).
L e général en chef B o n a p a r t e , -ayant résolu de se rendre à Soueys pour juger
de 1 état de ce port et ordonner les travaux propres à lui rendre tous les avantages
dont il est encore susceptible, partit duKaire le 4 nivôse an 7 [24 décembre 179 81:
les générauxBerthier et Caffarelli, le contre-amiral Gantheaume, MM. Monge,
Berthollet, Costaz, et divers autres membres de l’Institut, l’accompagnèrent.
L escorte de cette caravane offrait à plusieurs négocians que des intérêts de commerce
appeloient à Soueys, une occasion favorable de s’y rendre, et ils suivirent
la caravane. On coucha près du fort de Birket-el-Hâggy ; on reprit à l’est le
Darb-el-Soultâny, qui est aussi le chemin des pèlerins de la Nitkkc [Darb-el-HâggyJ;
et 1 on traversa, dans la même direction (2), une plaine vaste, dont la pente assez
douce se rattache aux collines vers le sud-est.
Apres deux heures de marche, on trouve au nord, à 1500 toises environ
de la route, une chaîne de collines blanches, en forme de dunes, qu’on appelle
Damah : après les avoir longées pendant trois heures, on franchit une chaîne
transversale de roche calcaire, peu élevée, recouverte de gravier et de cailloux
roulés; elle est coupée, et forme un encaissement à la route : on la nomme el-Bâb.
De la sommité de cette colline on découvre une grande plaine ; elle est sillonnée
par des ravines d’eau pluviale qui entretiennent, sur quelques points, une
végétation darbustes dont l’aspect contraste agréablement avec celui du désert;
( \ ' I T h Carte hydr0?raphique de Ia basse É O T te Soueys . C)art - i l - Tcrràbyn, et D a r b -e l-F e rn , plus
, , „ . , „ familières aux Arabes qui occupent ces déserts, indé-
(a) On la. sa au nord le Darb-el-G.ra [Darb-cl-Gyr], pendamment de celle de la vallée de l’Égarement h l -
chemrn dirigé sur Péluse et la Syrie. 7W ™ 7 • j » . r . ‘ éga rem en t/<■(-
n oe, . . p . , J onareqj, qui dut etre plus frequentee du temps que
est encore, a le s t , des routes plus directes pour Memphis étoit la capitale de l’empire.
D E S D E U X M E R S . 2 2
2 5
cette plaine est couverte de sable, de gravier, et de cailloux qui, de l’espèce du
jaspe, veinés et herborisés dans leur intérieur, sont connus dans le commerce sous
le nom de cailloux d ’Egypte.
On y trouve aussi beaucoup de pétrifications, parmi lesquelles le palmier ne
peut être méconnu (i). Des autruches, des gazelles, des alouettes huppées et
quelques perdrix, peuplent ces déserts. Des vautours, des aigles et des pélicans,
quittant la région plus élevée des montagnes, descendent aussi dans la plaine.
Le y [25 décembre], on coucha près de l’arbre Hamrâ. Le 6 [26 décembre],
on trouva, après une heure de marche, Byr-el-Beytâr (2). Ce puits, qu’on alla
reconnoître à un quart d’heure au sud de la route, n’a pas d’eau ; il est ouvert
sur de grandes dimensions, très-profond, et taillé dans le roc.
Un quart d’heure après, on trouve sur la route, qui prend en cet endroit le
nom de Darb-el-Homâr, 1 arbre ex-voto, ou gemâ‘t-el-charâmyt : c’est un vieil
acacia, tout couvert de lambeaux de vêtemens que les pieux pèlerins y suspendent
à leur retour de laMekke, en accomplissement du voeu qu’ils ont lait à leur départ;
c’est un des monumens de leur superstition (3).
Un peu au nord de cet arbre, on voit les ruines d’un puits et d’une citerne, que
les sables auront bientôt effacées. A six heures de distance de ce point, la vallée se
rétrécit entre les montagnes; la chaîne du sud s’élève, et celle du hord suit en
s’abaissant vers le nord-est; les ravins sont plus profonds; des blocs de silex et
de galets calcaires couvrent le sol et rendent le chemin plus difficile.
On etoit a la hauteur du fort d Ageroud, distant de y 00 toises au nord de la
route, le général en chef syporta. Ce fort consiste dans deux enceintes carrées,
flanquées de tours : celle de l’ouest renferme un puits profond avec roue à chapelet, et
quelques logemens ; celle de l’est contient un karavanseray (4) et une mosquée, pour
abriter les voyageurs et les commerçans, et satisfaire à la piété des hâggy (y).
On sort enfin de la vallée, et l’on débouche dans la plaine de Soueys : on
découvre la ville ainsi que la mer, et l’on descend par une pente douce vers les
Byr-Soueys, ou puits de Soueys ; ces derniers puits ne sont qu’à une lieue de la
ville. On y arriva à la nuit.
On ne trouve pas d’eau pendant vingt-quatre heures de marche, entre Birket-el-
Hâggy et Ageroud, parce que les établissemens intermédiaires qui ont dû y
exister, a en juger d après leurs vestiges, ont été détruits par le temps, par les
guerres et le défaut d entretien qui en est la suite inévitable. Il est cependant
possible de trouver de 1 eau en fouillant de quelques pieds seulement sous le
sable ; mais cette eau est ordinairement saumâtre.
( .) On aurait tort cependant de considérer comme (3) Les hâggy [les pèlerins] ont aussi I’nsage de former
petn cationdu regnevegetaltout c eq ui, au premier coup- de petits tas de pierre en forme de pyramide,pour indiquer
d oeil, en offre la ressemblance; car nous avons reconnu la sépulture des pèlerins morts dans le v o y a g e ; mais un
que souvent ces prétendues pétrifications ne sont que des autre motif de cet usage paroît être de marquer la route,
matières minérales - j î « , „
• t au moyen de cette suite de reperes, ou elle n est plus suffiy
r * eytâr, le puits du maréchal. C e puits fut samment indiquée quand les vents en ont détruit les traces,
commence en m o de l’hégyre [16 76 de J. C . ] ; mais (4) Kmuân-serây.
ut abandonne, parce qu il n y venoit pas d eau : aux (5) Ces établissemens ont été ensuite disposés pour les
environs est un marabout, ou tombeau de santon. besoins d’une garnison.