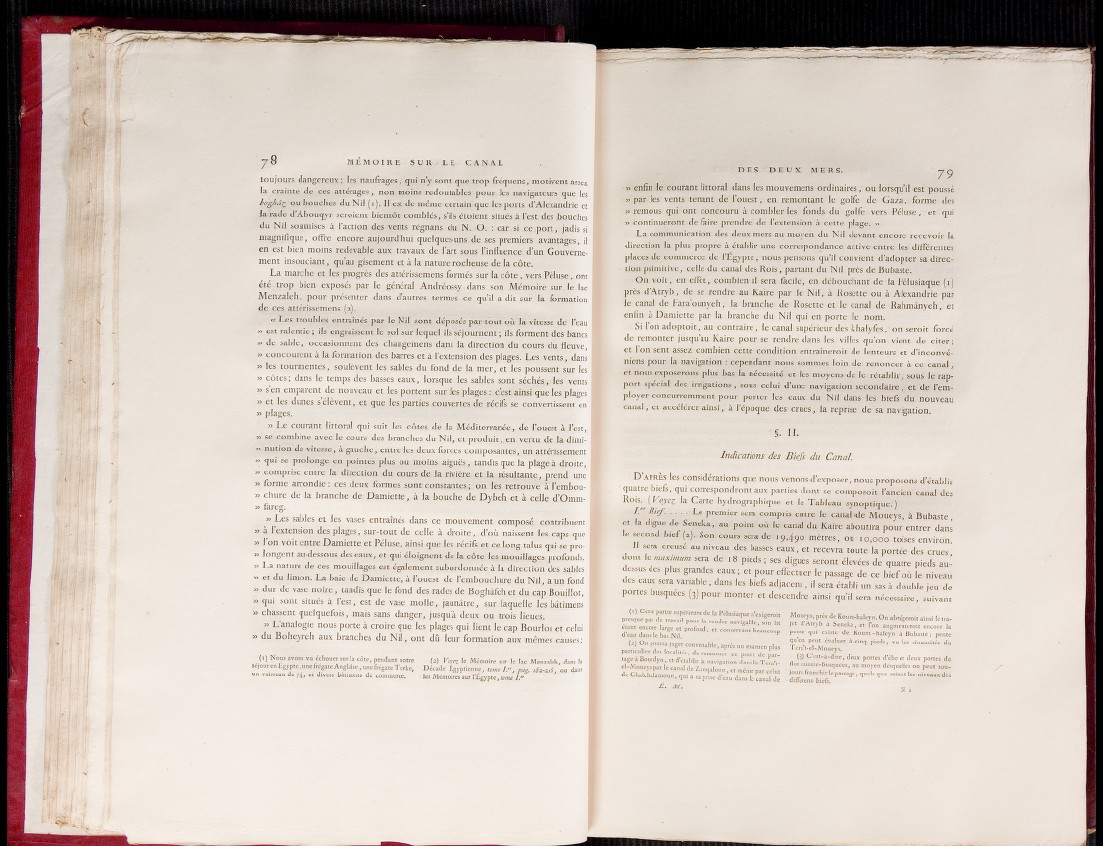
toujours dangereux; les naufrages, qui n’y sont que trop fréquens, motivent assez
la crainte de ces atterages, non moins redoutables pour les navigateurs que les
boghâz ou bouches du Nil (i). Il est de même certain que les ports d’Alexandrie et
la rade d’Abouqyr seroient bientôt comblés, s’ils étoient situés à l’est des bouches
du Nil soumises à l’action des vents régnans du N. O. : car si ce port, jadis si
magnifique, offre encore aujourd’hui quelques-uns de ses premiers avantages, il
en est bien moins redevable aux travaux de l’art sous l’influence d’un Gouvernement
insouciant, quau gisement et à la nature rocheuse de la côte.
La marche et les progrès des attérissemens formés sur la côte, vers Péluse, ont
ete trop bien exposés par le général Andréossy dans son Mémoire sur le lac
Menzaleh, pour présenter dans d autres termes ce qu’il a dit sur la formation
de ces attérissemens (2).
« Les troubles entraînés par le Nil sont déposés par-tout où la vitesse de l’eau
y> est ralentie ; ils engraissent le sol sur lequel ils séjournent ; ils forment des bancs
» de sable, occasionnent des changemens dans la direction du cours du fleuve,
» concourent a la formation des barres et à l’extension des plages. Les vents, dans
» les tourmentes, soulèvent les sables du fond de la mer, et les poussent sur les
» côtes; dans le temps des basses eaux, lorsque les sables sont séchés, les vents
» sen emparent de nouveau et les portent sur les plages : c’est ainsi que les plages
» et les dunes s’élèvent, et que les parties couvertes de récifs se convertissent en
» plages.
» Le courant littoral qui suit les côtes de la Méditerranée, de l’ouest à l’est,
» se combine avec le cours des branches du Nil, et produit, en vertu de la dimi-
» nution de vitesse, à gauche, entre les deux forces composantes, Un attérissement
qui se prolonge en pointes plus ou moins aiguës, tandis que la plage à droite,
» comprise entre la direction du cours de la rivière et la résultante, prend une
y> forme arrondie: ces deux formes sont constantes; on les retrouve à l’embou-
55 chure de la branche de Damiette, à la bouche de Dybeh et à celle d’Omm-
» fareg.
» Les sables et les vases entraînés dans ce mouvement composé contribuent
» a I extension des plages, sur-tout de celle à droite, d’où naissent les caps que
» l’on voit entre Damiette et Péluse, ainsi que les récifs et ce long talus qui se pro
» longent au-dessous des eaux, et qui éloignent de la côte les mouillages profonds.
55 La nature de ces mouillages est également subordonnée a la direction des sables
» et du limon. La baie de Damiette, à l’ouest de l’embouchure du Nil, a un fond
55 dur de vase noire, tandis que le fond des rades de Boghâfehet du cap Bouillot,
qui sont situés à l’est, est de vase molle, jaunâtre, sur laquelle les bâtimens
» chassent quelquefois, mais sans danger, jusqua deux ou trois lieues.
» L ’analogie nous porte à croire que les plages qui lient le cap Bourlos et celui
>3 du Boheyreh aux branches du Nil, ont dû leur formation aux mêmes causes;
(1) Nous avons vu échouer sur la côte, pendant notre (a) Voyez le Mémoire sur le tac Menzaleh, dans la
séjour en Egypte, une frégate Anglaise, une frégate Turke, Décade Égyptienne, tome t . " , pag. ,8 2 -2,6, ou dans
un vaisseau de 7 4 , et divers bâtimens de commerce. les Mémoires sur l’Égypte, tome I . "
33 enfin le courant littoral dans les mouvemens ordinaires, ou lorsqu’il est poussé
>3 par les vents tenant de l’ouest, en remontant le golfe de Gaza, forme des
33 remous qui ont concouru à combler les fonds du golfe vers Péluse, et qui
33 continueront de faire prendre de l’extension à cette plage. 33
La communication des deux mers au moyen du Nil devant encore recevoir la
direction la plus propre à établir une correspondance active entre les différentes
places de commerce de l’Égypte, nous pensons qu’il convient d’adopter sa direction
primitive, celle du canal des Rois, partant du Nil près de Bubaste.
On voit, en effet, combien il sera facile, en débouchant de la Pélusiaque (1)
près d A tryb, de se rendre au Kaire par le Nil, a Rosette ou à Alexandrie par
le canal de Faraounyeh, la branche de Rosette et le canal de Rahmânyeh, et
enfin à Damiette par la branche du Nil qui en porte le nom.
■ Si 1 on adoptoit, au contraire, le canal supérieur des khalyfes, on seroit forcé
de remonter jusqu’au Kaire pour se rendre dans les villes qu'on vient de citer ;
et 1 on sent assez combien cette condition entraîneroit de lenteurs et d’inconvé-
niens pour la navigation : cependant nous sommes loin de renoncer à ce canal,
et nous exposerons plus bas la nécessité et les moyens de le rétablir, sous le rapport
spécial des irrigations, sous celui d’une navigation secondaire, et de l’employer
concurremment pour porter les eaux du Nil dans les biefs du nouveau
canal, et accelerer ainsi, à 1 époque des crues, la reprise de sa navigation.
Ҥ. II.
Indications des Biefs du Canal.
D a p r è s les considérations que nous venons d’exposer, nous proposons d’établir
quatre biefs, qui correspondront aux parties dont se composoit l’ancien canal dés
Rois. ( Voyez la Carte hydrographique et le Tableau synoptique. )
I " Bief : . . . . Le premier sera compris entre le canal «de Moueys, à Bubaste,
et la digue de Seneka, au point où le canal du Kaire aboutira pour entrer dans
le second bief (2).-Son cours sera de 19,490 mètres, ou 10,000 toises environ.
Il sera creusé au niveau des basses eaux, et recevra toute la portée des crues
dont le maximum sera de . 8 pieds ; ses digues seront élevées de quatre pieds au-
dessus des plus grandes eaux; et pour effectuer le passage de ce bief où le niveâu
tes eaux sera variable, dans les bieff adjacens, il sera établi un sas à double jeu de
portes busquees (3) pour monter et descendre ainsi qu’il sera nécessaire, suivant
(1) Cette partie supérieure de la Pélusiaque n'exigerait
presque pas de travail pour la rendre navigable, son lit
étant encore large et profond, et conservant beaucoup
d eau dans le bas Nil.
(2) On pourra juger convenable, après un examen plus
particulier des localités, de remonter ce point de partage
a Bourdyn, et d établir la navigation dans le Tera’t-
el-Moueys par le canal de Zanqaloun, et même par celui
de Chalcbalamoun, qui a sa prise d’eau dans le canal de
É . M .
Moueys, près de Koum-haleyn. On abrégerait ainsi le trajet
d A tryb à Seneka, et l’on augmenterait encore la
pente qui existe de Koum -haleyn .à Bubaste; pente
quon peut évaluer à* cinq pieds, vu les sinuosités-du
T era’t-el-Moueys.
(3) C ’est-à-dire, deux portes d’èbe et deux portes de
flot contre-busquées, au moyen desquelles on peut toujours
franchir le passage, quels que soient les niveaux dés
différens biefs.
N |