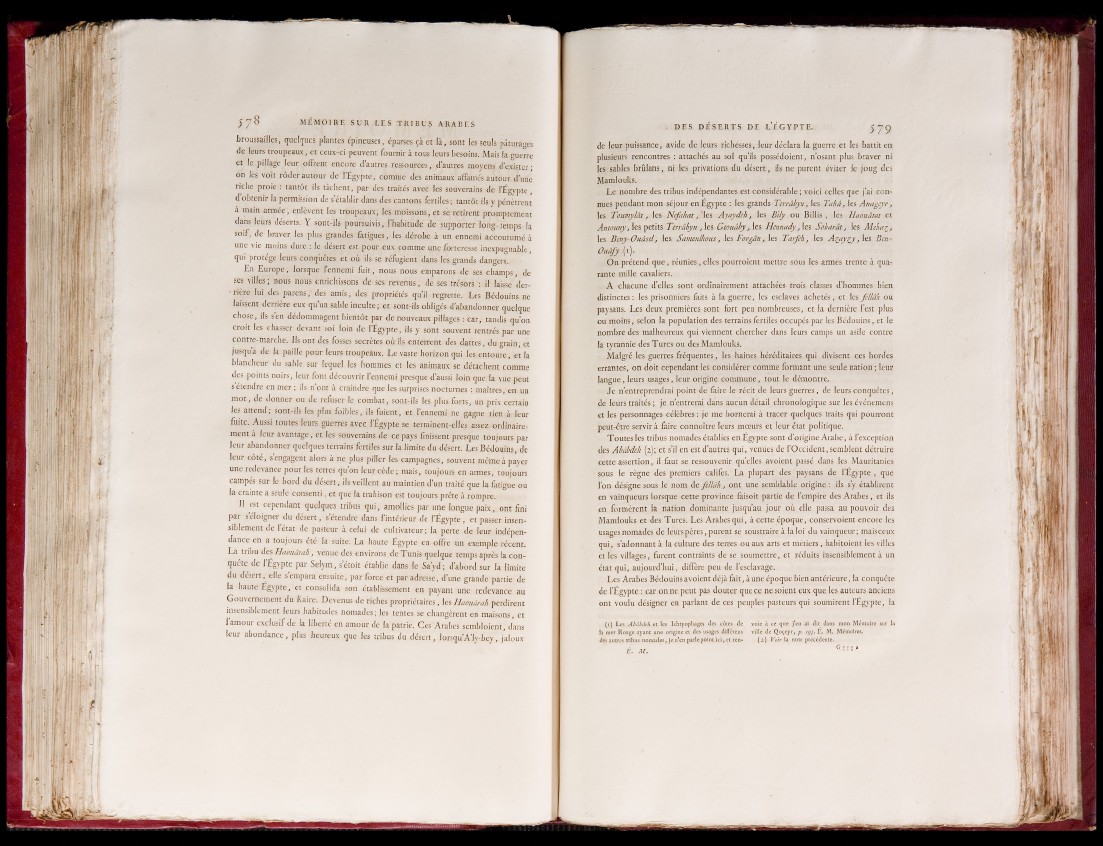
JF
I
broussailles, quelques plantes épineuses, éparses çà et là, sont les seuls pâturage:
de leurs troupeaux, et ceux-ci peuvent fournir à tous leurs besoins. Mais la guerri
et le pillage leur offrent encore d’autres ressources, d’autres moyens d’exister
on lès voit roder autour de l’Égypte, comme des animaux affalés autour d’une
riche proie : tantôt ils tâchent, par des traités avec les souverains de l’Égyptej
dobtenir la permission de s’établir dans des cantons fertiles; tantôt ils y pénètrent
à main armée, enlèvent les troupeaux, les moissons, et sè retirent promptement
dans leurs deserts. Y sont-ils poursuivis, l’habitude de supporter long-temps la
soif, de braver les plus grandes fatigues, les dérobe à un ennemi accoutumé à
une vie moins dure : le désert est pour eux comme une forteresse inexpugnable,
qui protège leurs conquêtes et où ils se réfugient dans les grands dangers.
En Euiope, lorsque 1 ennemi fuit, nous nous emparons de ses champs, de
ses Villes; nous nous enrichissons de ses revenus, :de ses trésors : il laisse derrière
lui des parens, des amis, des propriétés qu’il regrette. Les Bédouins ne
laissent derrière eux qu’un sable inculte ; et sont-ils obligés d’abandonner quelque
chose, ils s’en dédommagent bientôt par de nouveaux pillages : car, tandis qu’on
croit les chasser devant soi loin de l’Égypte, ils y sont souvent rentrés par une
contre-marche. Ils ont des fosses secrètes où ils enterrent des dattes, du grain, e
jusquà de la paille pour leurs troupeaux. Le vaste horizon qui les entoure, et I;
blancheur du sable sur lequel les hommes et les animaux se détachent commi
des points noirs, leur font découvrir l’ennemi presque d’aussi loin que la vue peu
s étendre en mer ; ils n’ont à craindre que les surprises nocturnes : maîtres, en ur
m ot, de donner ou de refuser le combat, sont-ils les plus forts, un prix certait
les attend; sont-ils les plus foibles, ils fuient, et l’ennemi ne gagne rien à, leui
fuite. Aussi toutes leurs guerres avec l’Égypte se terminent-elles assez ordinairement
à leur avantage, et les souverains de ce pays finissent presque toujours pai
leur abandonner quelques terrains fertiles sur la limite du désert. Les Bédouins, de
4 ' *eur c° t®> s engagent alors à ne plus piller les campagnes, souvent même à payei
une redevance pour les terres qu on leur cède; mais, toujours en armes, toujours
campés sur le bord du désert, ils veillent au maintien d’un traité que la fatigue ou
la crainte a seule consenti, et que la trahison est toujours prête à rompre.
Il est cependant quelques tribus qui, amollies par une longue paix, ont fini
par s’éloigner du désert, s’étendre dans l’intérieur de l’Égypte, et passer insensiblement
de létat de pasteur à celui de cultivateur; la perte de leur indépendance
en a toujours été la suite. La haute Égypte en offre un exemple récent.
La tribu des Haouârah, venue des environs de Tunis quelque temps après la conquête
de l’Égypte par Selym, s’étoit établie dans le Sa’yd; d’abord sur la limite
du désert, elle sempara ensuite, par force et par adresse, d’une grande partie de
la haute Égypte, et consolida son établissement en payant une redevance au
Gouvernement du Kaire. Devenus de riches propriétaires, les Haouârah perdirent
insensiblement leurs habitudes nomades; les tentes se changèrent en maisons, et
l’amour exclusif de la liberté en amour de la patrie. Ces Arabes sembloient, dans
leur abondance, plus heureux que les tribus du désert, lorsqu’A’ly-bey, jaloux
de leur puissance, avide de leurs richesses, leur déclara la guerre et les battit en
plusieurs rencontres : attachés au sol qu’ils possédoient, n’osant plus braver ni
les sables brûlans, ni les privations du désert, ils ne purent éviter le joug des
Mamlouks.
Le nombre des tribus indépendantes est considérable ; voici celles que j’ai connues
pendant mon séjour en Égypte : les grands Tcrrâbyn, les Tahâ, les Anageyr,
les Toumylâi, les Nefahat, 'les Ayaydch, les B'tly ou Billis , les Haouâtat et
Antotmy, les petits Terrâbyn , les Ccotiâby, les Hcnnady, les Soharât, les Me bai,
les Beny-Ouâsel, les Samenlhous, les Forgân, les Tarfeh, les Azayiy, les Bcu-
Ouâfy (t) .
On prétend que, réunies, elles pourroient mettre sous les armes trente à quarante
mille cavaliers.
A chacune d’elles sont ordinairement attachées trois classes d’hommes bien
distinctes : les prisonniers faits à la guerre, les esclaves achetés, et les fellah ou
paysans. Les deux premières sont fort peu nombreuses, et la dernière l’est plus
ou moins, selon la population des terrains fertiles occupés par les Bédouins, et le
nombre des malheureux qui viennent chercher dans leurs camps un asile contre
la tyrannie des Turcs ou des Mamlouks.
Malgré les guerres fréquentes, les haines héréditaires qui divisent ces hordes
errantes, on doit cependant les considérer comme formant une seule nation ; leur
langue, leurs usages, leur origine commune, tout le démontre.
Je n’entreprendrai point de faire le récit de leurs guerres, de leurs conquêtes,
de leurs traités ; je n’entrerai dans aucun détail chronologique sur les événemens
et les personnages célèbres : je me bornerai à tracer quelques traits qui pourront
peut-être servir à faire connoître leurs moeurs et leur état politique.
Toutes les tribus nomades établies en Égypte sont d’origine Arabe, à l’exception
des Abâbdeh (2); et s’il en est d’autres qui, venues de l’Occident, semblent détruire
cette assertion, il faut se ressouvenir qu’elles avoient passé dans les Mauritanies
sous le règne des premiers califes. La plupart des paysans de l’Égypte , que
l’on désigne sous le nom de fellâh, ont une semblable origine | ils s’y établirent
en vainqueurs lorsque cette province faisoit partie de l’empire des Arabes, et ils
en formèrent la nation dominante jusqu’au jour où elle passa au pouvoir des
Mamlouks et des Turcs. Les Arabes qui, à cette époque, conservoient encore les
usages nomades de leurs pères, purent se soustraire à la loi du vainqueur; mais ceux
qui, s’adonnant à la culture des terres ou aux arts et métiers, habitoient les villes
et les villages, furent contraints de se soumettre, et réduits insensiblement à un
état qui, aujourd’hui, diffère peu de l’esclavage.
Les Arabes Bédouins avoient déjà fait, à une époque bien antérieure, la conquête
de l’Égypte : car on ne peut pas douter que ce ne soient eux que les auteurs anciens
ont voulu désigner en parlant de ces peuples pasteurs qui soumirent l’Égypte, la
(1) Les Abâbdeh et les Ichtyophages des côtes de yoie à ce que j’en ai dit dans mon Mémoire sur la
la mer Rouge ayant une origine et des usages différens ville de Qoçeyr, p. jpj. E. M . Mémoires,
des autres tribus nomades, je n’en parle point ici, et ren- (2 ) Voir la note précédente.