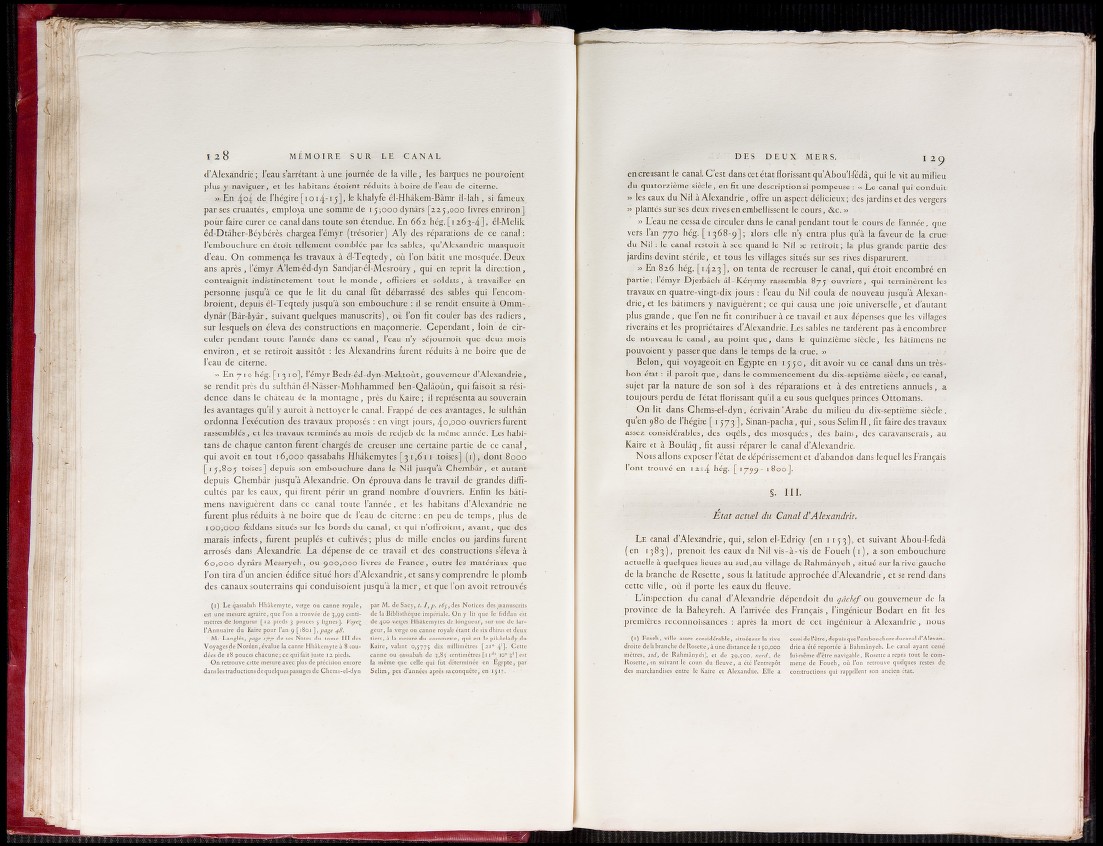
d’Alexandrie ; l’eau s’arrêtant à une journée de la ville, les barques ne pouvoient
plus y naviguer, et les habitans étoient réduits à boire de l’eau de citerne.
»■ En 4°4 de l’hégire [1014-1.5], Ie khalyfe êl-Hhâkem-Bàmr îl-lah, si fameux
par ses cruautés, employa une somme de ijjo o o dynârs [225,000 livres environ]
pour faire curer ce canal dans toute son étendue. En 662 hég. [1263-4], êl-Melik
êd-Dtâher-Béybérès chargea lemyr (trésorier) A’iy des réparations de ce canal:
l’embouchure en étoit tellement comblée par les sables, qu’Alexandrie manquoit
d’eau. On commença les travaux à êl-Teqtedy, où l’on bâtit une mosquée. Deux
ans après , lemyr A’iem-êd-dyn Sandjar-êl-Mesroùry, qui en reprit la direction,
contraignit indistinctement tout le monde, officiers et soldats, à travailler en
personne jusqu’à ce que le lit du canal fût débarrassé des sables qui l’encom-
broient, depuis êl-Teqtedy jusqu’à son embouchure : il se rendit ensuite à Omni- .
dynâr (Bâr-byâr, suivant quelques manuscrits), où l’on fit couler bas des radiers,
sur lesquels on éleva des constructions en maçonnerie. Cependant, loin de circuler
pendant toute l’année dans ce canal, l’eau n’y séjournoit que deux mois
environ, et se retiroit aussitôt : les Alexandrins furent réduits à ne boire que de
l’eau de citerne.
» En 71 o hég. [ 1 3 1 o], l’émyr Bedr-êd-dyn-Mektoùt, gouverneur d’Alexandrie,
se rendit près du sulthân êl-Nâsser-Mohhammed ben-Qalâoùn, qui faisoit sa résidence
dans le château de la montagne , près du Kaire ; il représenta au souverain
les avantages qu’il y auroit à nettoyer le canal. Frappé de ces avantages, le sulthân
ordonna l’exécution des travaux proposés : en vingt jours, 4o,ooo ouvriers furent
rassemblés, et les travaux terminés au mois de redjeb de la même année. Les habitans
de chaque canton furent chargés de creuser une certaine partie de ce canal,
qui avoit en tout 16,000 qassabahs Hhâkemytes [31,611 toises] (1), dont 8000
[ 1 5,805 toises] depuis son embouchure dans le Nil jusqu’à Chembâr, et autant
depuis Chembâr jusqu’à Alexandrie. On éprouva dans le travail de grandes difficultés
par les eaux, qui firent périr un grand nombre d’ouvriers. Enfin les bâti-
mens naviguèrent dans ce canal toute l’année, et les habitans d’Alexandrie ne
furent plus réduits à ne boire que de l’eau de citerne: en peu de temps, plus de
100.000 fèddans situés sur les bords du canal, et qui n’offroient, avant, que des
marais infects, furent peuplés et cultivés ; plus de mille enclos ou jardins furent
arrosés dans Alexandrie. La dépense de ce travail et des constructions s’éleva à
60.000 dynârs Mêssiyeh, ou 900,000 livres de France , outre les matériaux que
l’on tira d’un ancien édifice situé hors d’Alexandrie, et sans y comprendre le plomb
des canaux souterrains qui conduisoient jusqu’à la mer, et que l’on avoit retrouvés
(j) Le qassabah H hâkem yte, verge ou canne royale, par M . de Sacy, t . I ,p. i 6j , des N otices des m anuscrits
est une m esure agraire, que l’on a trouvée de 3,99 centi- de la Bibliothèque impériale. O n y lit que le feddan est
m ètres de longueur [ 12 pieds 3 pouces 5 lignes]. Voye^ de 400 verges H hâkem ytes de longueur, sur une de Iar-
l’A nnuaire du Kaire pour l’an 9 [ 1801 ], page 48. geur, la verge ou canne royale étant de six dhiras et deux
M . Langlès, page 177 de ses N otes du tom e III des tiers, à la m esure du com m erce, qui est le pik-belady du
V oyages de N o rd en , évalue la canne H hâkem yte à 8 cou- K aire, valant 0,5775 dix m illim ètres [2 1 0 41 ]• C ette
dées de 18 pouces chacune; ce qui fait juste 12 pieds. canne ou qassabah de 3,85 centim ètres [1 i ds io° 31 ] est
O n retrouve cette m esure avec plus de précision encojre la m êm e que celle qui fut déterm inée en E gypte, par
dans les traductions de quelques passages de C hem s-el-dyn S elim , peu d’années après sa conquête, en 1517.
en creusant le canal. C ’est dans cet état florissant qu’Abou’l-fédâ, qui le vit au milieu
du quatorzième siècle, en fit une description si pompeuse : « Le canal qui conduit
y> les eaux du Nil à Alexandrie, offre un aspect délicieux; des jardins et des vergers
33 plantés sur ses deux rives en embellissent le cours, &c.»
si L’eau ne cessa de circuler dans le canal pendant tout le cours de l’année, que
vers l’an 770 hég. [ 1368-9]; alors elle n’y entra plus qu’à la faveur de la crue
du Nil : le canal restoit à sec quand le Nil se retiroit; la plus grande partie des'
jardins devint stérile, et tous les villages situés sur ses rives disparurent.
33 En 826 hég. [ 142.3], on tenta de recreuser le canal, qui étoit encombré en
partie; l’émyr Djerbâch âl-Kérymy rassembla 875 ouvriers, qui terminèrent les
travaux en quatre-vingt-dix jours : l’eau du Nil coula de nouveau jusqu’à Alexandrie,
et les bâtimens y naviguèrent; ce qui causa une joie universelle, et d’autant
plus grande, que l’on ne fit contribuer à ce travail et aux dépenses que les villages:
riverains et les propriétaires d’Alexandrie. Les sables ne tardèrent pas à encombrer
de nouveau le canal, au point que, dans le quinzième siècle, les bâtimens iie
pouvoient y passer que dans le temps de la crue. 33
Belon, qui voyageoit en Egypte en 1550, dit avoir vu ce canal dans un très-
bon état : il paroît que, dans le commencement du dix-septième siècle, ce canal;
sujet par la nature de son sol à dès réparations et à des entretiens annuels, a
toujours perdu de l’état florissant qu’il a eu sous quelques princes Ottomans.
On lit dans Chems-el-dyn, écrivain Arabe du milieu du dix-septième siècle,
qu’en 980 de l’hégire [1573], Sinan-pacha, qui, sous Selim II, fit faire des travaux
assez considérables, des oqêls, des mosquées, des bains, des caravanserais, au
Kaire et à Boulâq, fit aussi réparer le canal d’Alexandrie.
Nous allons exposer l’état de dépérissement et d’abandon dans lequel les Français
l’ont trouvé en 1214 hég. [ 1799- 1800].
§. m
Etat actuel du Canal d’Alexandrie.
Le canal d’Alexandrie, qui, selon el-Edriçy (en 1153), et suivant Abou-l-fedâ
(en 1383), prenoit les eaux du Nil vis-à-vis de Foueh (1), a son embouchure
actuelle à quelques lieues au sud, au village de Rahmânyeh , situé sur la rive gauche
de la branche de Rosette, sous la latitude approchée d’Alexandrie, et se rend dans
cette ville, où il porte les eaux du fleuve.
L’inspection du canal d’Alexandrie dépendoit du qâchef ou gouverneur de la
province de la Baheyreh. A l’arrivée des Français, l’ingénieur Bodart en fit les
premières reconnoissances : après la mort de cet ingénieur à Alexandrie, nous
(1) Foueh, ville assez considérable, située sur la rive cessé d el’être, depuis que l’em bouchure du canal d’AIexandroite
delà branche de R osette, a u n e distance de 150,000 drie a été reportée à R ahm ânyeh. Le canal ayant cessé
m ètres, sud, de R ahm ânyeh], et de 39,500, nord, de lui-m êm e d’être navigable, R osette a repris tout le com -
R osette, en suivant le cours du fleuve, a été l’entrepôt m erce de Foueh, où l’on retrouve quelques restes de
des m archandises entre le Kaire et A lexandrie. E lle a constructions qui rappellent son ancien état.