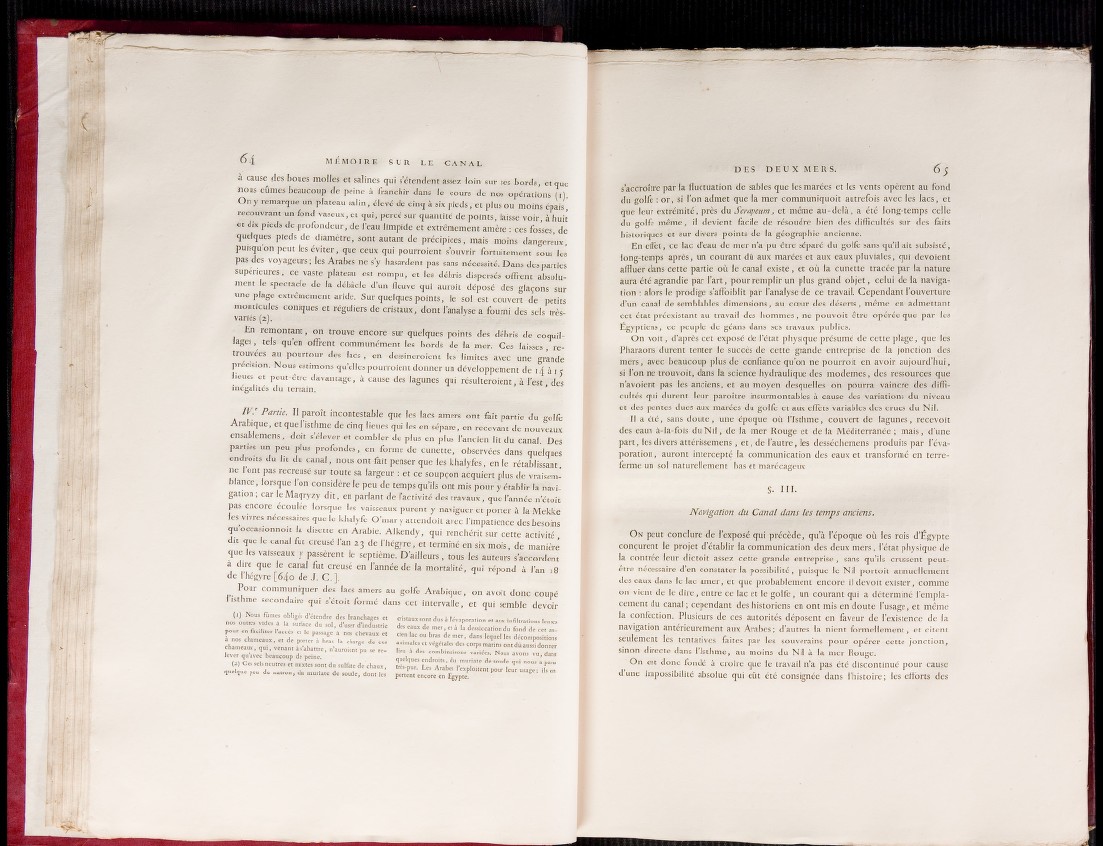
à cause des boues molles et salines qui s’étendent assez loin sur ses bords, et que
nous eûmes beaucoup de peine à franchir dans le cours de nos opérations (i)
On y remarque un plateau salin, élevé de cinq à six pieds, et plus ou moins épais ’
recouvrant un fond vaseux, et qui, percé sur quantité de points, laisse voir, à huit
et dix pieds de profondeur, de l’eau limpide et extrêmement amère : ces fosses, de
quelques pieds de diamètre, sont autant de précipices, mais moins dangereux,
puisquon peut les éviter, que ceux qui pourroient s’ouvrir fortuitement sous les
pas des voyageurs; les Arabes ne s’y hasardent pas sans nécessité. Dans des parties
supérieures, ce vaste plateau est rompu, et les débris dispersés offrent absolument
le spectacle de la débâcle d’un fleuve qui auroit déposé des glaçons sur
une plage extrêmement aride. Sur quelques points, le sol est couvert de petits
monticules coniques et réguliers de cristaux, dont l’analyse a fourni des sels très-
variés (2).
En remontant, on trouve encore sur quelques points des débris de coquillages
tels qu’en offrent communément les bords de la mer. Ces laisses, retrouvées
au pourtour des lacs, en dessineroient les limites avec une grande
précision. Nous estimons quelles pourroient donner un développement cle 14 à 15
lieues et peut-être davantage, à cause des lagunes qui résulteraient, à l’est des
inégalités du terrain.
É P Partie- 11 Paroît incontestable que les lacs amers ont fait partie du golfe
Arabique, et que l’isthme de cinq lieues qui les en sépare, en recevant de nouveaux
ensablemens, doit s’élever et combler de plus en plus l’ancien lit du canal. Des
parties un peu plus profondes, en forme de cunette, observées dans quelques
endroits du lit du canal, nous ont fait penser que les khalyfes, en le rétablissant,
ne 1 ont pas recreusé sur toute sa largeur : et ce soupçon acquiert plus de vraisemblance,
lorsque 1 on considère le peu de temps qu’ils ont mis pour y établir la navigation
; car le Maqryzy dit, en parlant de l’activité des travaux, que l’année n’étoit
pas encore ecoulee lorsque les vaisseaux purent y naviguer et porter à laMekke
les vivres nécessaires que le khalyfe O’mar y attendoit avec l’impatience des besoins
quoccasionnoit la disette en Arabie. Alkendy, qui renchérit sur cette activité,
dit que le canal fut creusé l’an 23 de i’hégyre, et terminé en six mois, de manière
que les vaisseaux y passèrent le septième. D’ailleurs, tous les auteurs s’accordent
a dire que le canal fut creusé en l’année de la mortalité, qui répond à l’an 18
de l’hégyre [640 de J. C. ].
Pour communiquer des lacs amers au golfe Arabique, on avoit donc coupé
1 isthme secondaire qui serait formé dans cet intervalle, et qui semble devoir
B B l I i É B S P 8 d“ tran; har et p t e ® ¡1 * r*™?«..«»« a„ * ¡ „ f i n « .™ ,B
» n i beaUC° UP ^ PCine‘ qud<IUeS endroits> du rounate^de s o n * q uinouTa p r u
(2) Ces sels neutres et mixtes sont du sulfate de chaux très nnr f ^ a m t i» , - , 1 p
r t « p - < • f i ^
D E S D E U X ME R S . 6 C
s’accroître par la fluctuation de sables que les marées et les vents opèrent au fond
du golfe : or, si l’on admet que la mer communiquoit autrefois avec les lacs, et
que leur extrémité, près du Serapeum, et même au-delà, a été long-temps celle
du golfe même, il devient facile de résoudre bien des difficultés sur des faits
historiques et sur divers points de la géographie ancienne.
En effet, ce lac d’eau de mer n’a pu être séparé du golfe sans qu’il ait subsisté,
long-temps après, un courant dû aux marées et aux eaux pluviales, qui devoient
affluer dans cette partie où le canal existe, et où la cunette tracée par la nature
aura été agrandie par l’art, pour remplir un plus grand objet, celui de la navigation
: alors le prodige s’affoiblit par l’analyse de ce travail. Cependant l’ouverture
d’un canal de semblables dimensions, au coeur des déserts, même en admettant
cet état préexistant au travail des hommes, ne pouvoit être opérée que par les
Égyptiens, ce peuple de géans dans ses travaux publics.
On voit, d’après cet exposé de letat physique présumé de cette plage, que les
Pharaons durent tenter le succès de cette grande entreprise de la jonction des
mers, avec beaucoup plus de confiance qu’on ne pourrait en avoir aujourd’hui,
si l’on ne trouvoit, dans la science hydraulique des modernes, des ressources que
n’avoient pas les anciens, et au moyen desquelles on pourra vaincre des difficultés
qui durent leur paraître insurmontables à cause des variations du niveau
et des pentes dues aux marées du golfe et aux effets variables des crues du Nil.
Il a été, sans doute, une époque où l’Isthme, couvert de lagunes, recevoit
des eaux à-Ia-fois du Nil, de la mer Rouge et delà Méditerranée; mais, d’une
part, les divers attérissemens, et, de l’autre, les desséchemens produits par l’évaporation,
auront intercepté la communication des eaux et transformé en terre-
ferme un sol naturellement bas et marécageux O
§. III.
Navigation du Canal dans les temps anciens.
O n peut conclure de l’exposé qui précède, qu’à l’époque où les rois d’Égypte
conçurent le projet d’établir la communication des deux mers, l’état physique de
la contrée leur dictoit assez cette grande entreprise, sans qu’ils crussent peut-
etre nécessaire den constater la possibilité, puisque le Nil portoit annuellement
des eaux dans le lac amer, et que probablement encore il devoit exister , comme
on vient de le dire, entre ce lac et le golfe, un courant qui a déterminé l’emplacement
du canal ; cependant des historiens en ont mis en doute l’usage, et même
la confection. Plusieurs de ces autorités déposent en laveur de l’existence de la
navigation antérieurement aux Arabes ; d’autres la nient formellement, et citent
seulement les tentatives faites par les souverains pour opérer cette jonction,
sinon directe dans l’Isthme, au moins du Nil à la mer Rouge.
On est donc fondé à croire que le travail n’a pas été discontinué pour cause
dune impossibilité absolue qui eût été consignée dans l’histoire; les efforts des