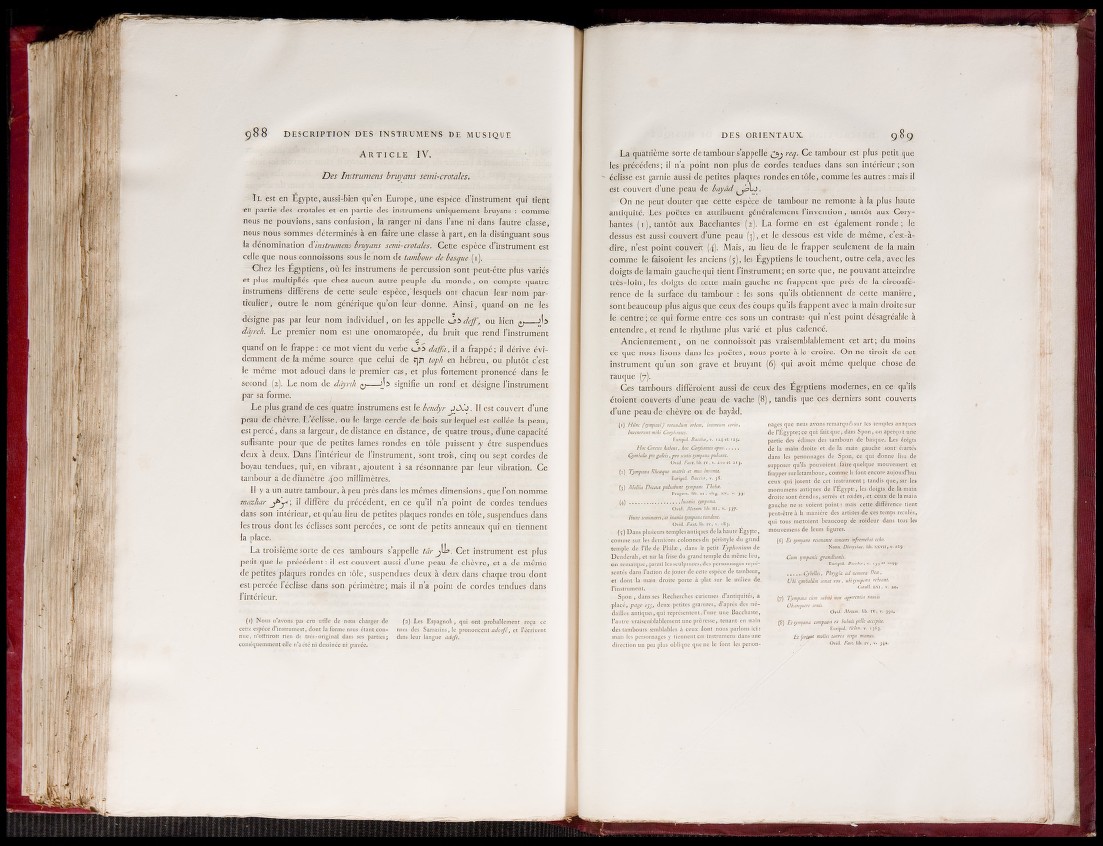
A r t i c l e I V .
D es Instrumens bruyans semi-crotales.
I l est en Egypte, aussi-tien qu’en Europe, une espèce d’instrument qui tient
en partie des crotales et en partie des instrumens uniquement bruyans : comme
nous ne pouvions, sans confusion, la ranger ni dans l’une ni dans l’autre classe,
nous nous sommes déterminés à en faire une classe à part, en la distinguant sous
la dénomination d’instrumens bruyans senti-crotales. Cette espèce d’instrument est
celle que nous connoissons sous le nom de tambour de basque (1).
Chez les Egyptiens, où les instrumens de percussion sont peut-être plus variés
et plus multipliés que chez aucun autre peuple du monde, on compte quatre
instrumens différens de cette seule espèce,'lesquels ont chacun leur nom particulier,
outre le nom générique qu’on leur donne. Ainsi , quand on ne les
désigne pas par leur nom individuel, on les appelle <Jsïdeff, ou bien y >l>
dâyre/i. Le premier nom est une onomatopée, du bruit que rend l’instrument
quand on le frappe : ce mot vient du verbe <J»S daffh, il a frappé ; il dérive évidemment
de la même source que celui de t]n toph en hébreu, ou plutôt c’est
le même mot adouçi dans le premier cas, et plus fortement prononcé dans le
second (2). Le nom de dâyreh ^ ils signifie un rond et désigne l’instrument
par sa forme.
Le plus grand de ces quatre instrumens est le bendyr -JcX.'J. II est couvert d’une
peau de chèvre. L ’éclisse, ou le large cercle de bois sur lequel est collée la peau,
est percé, dans sa largeur, de distance en distance, de quatre trous, d’une capacité
suffisante pour que de petites lames rondes en tôle puissent y être suspendues
deux à deux. Dans l’intérieur de l’instrument, sont trois, cinq ou sept cordes de
boyau tendues, qui, en vibrant, ajoutent à sa résonnance par leur vibration. Ce
tambour a de diamètre 4 °o millimètres.
II y a un autre tambour, à peu près dans les mêmes dimensions, que l’on nomme
mazhar ; il diffère du précédent, en ce qu’il n’a point de cordes tendues
dans son intérieur, et qu’au lieu de petites plaques rondes en tôle, suspendues dans
les trous dont les éclisses sont percées, ce sont de petits anneaux qui en tiennent
la place.
La troisième sorte de ces tambours s’appelle târ j l l s . Cet instrument est plus
petit que le précédent : il est couvert aussi d’une peau de chèvre, et a de même
de petites plaques rondes en tôle, suspendues deux à deux dans chaque trou dont
est percée l’éclisse dans son périmètre; mais il n’a point de cordes tendues dans
l’intérieur.
(1) Nous n’avons pas cru utile de nous charger de (2) Les Espagnols, qui ont probablem ent reçu ce
cette espèce d’instrum ent, dont la forme nous étant con- nom des Sarrasins, le prononcent adoufé, et l’écrivent
nu e, n’offriroit rien de très-original dans ses parties; dans leur langue adufe, conséquemm ent elle n’a été ni dessinée ni gravée.
La quatrième sorte de tambour s’appelle ¿ jy req. Ce tambour est plus petit que
les précédens; il n’a point non plus de cordes tendues dans son intérieur ; son
éclisse est garnie aussi de petites plaques rondes en tôle, comme les autres : mais il
est couvert d’une peau de bayâd ^ ¿ L o .
On ne peut douter que cette espèce de tambour ne remonte à la plus haute
antiquité. Les poètes en attribuent généralement l’invention, tantôt aux Cory-
bantes ( i) , tantôt aux Bacchantes (2). La forme en est également ronde; le
dessus est aussi couvert d’une peau (3), et le dessous est vide de même, c’est-à-
dire, n’est point couvert (4). Mais, au lieu de le frapper seulement de la main
comme le faisoient les anciens (y), les Égyptiens le touchent, outre cela, avec les
doigts de la main gauche qui tient l’instrument; en sorte que, ne pouvant atteindre
très-loin, les doigts de cette main gauche ne frappent que près de la circonférence
de la surface du tambour : les sons qu’ils obtiennent de cette manière,
sont beaucoup plus aigus que ceux des coups qu’ils frappent avec la main droite sur
le centre ; ce qui forme entre ces sons un contraste qui n’est point désagréable à
entendre, et rend le rhythme plus varié et plus cadencé.
Anciennement, on ne connoissoit pas vraisemblablement cet art ; du moins
ce que nous lisons dans les poètes, nous porte à le croire. On ne tiroit de cet
instrument qu’un son grave et bruyant (6) qui avoit même quelque chose de
rauque (7).
Ces tambours différoient aussi de ceux des Égyptiens modernes, en ce quils
étoient couverts d’une peau de vache (8), tandis que ces derniers sont couverts
d’une peau de chèvre ou de bayad.
(1} Ttùnc (tympanij munditm 'orhem, inuntum corio, nages que nous avons remarqués sur Invenerunt mili Corylantes. les temples antiques de l’Egypte; ce qui fait que, dans Spon, on aperçoit une
Euripid. Baccha, Hoc Curetes habent, hoc Corybantevs. o1p2u4s et ny. partie des éclisses des tambours de basque. Les doigts Cymbala pro galeis, pro sentis tympana puisan.t..........
Ovid. Fast. lib. iv, v. a 10 et 213.
(2) Tympana Rheoequc matris et mea inventa. Euripid. Baccha, v. 38.
(3) Mollia Dircaa pulsabunt tympana Thebee. Propert. lib. Ill, eleg. xv, v. 33.
(4) ................ huinia tympana. '
Ovid. Mctavi. lib. in, v. 537. Ibunt semimares, et mania tympana tundent. Ovid. Fast. lib. iv, v. 183. ^
(5) Dans plusieurs temples antiques de la haute Egypte,
' comme sur les dernières colonnes du péristyle du grand
temple de l’île de Philæ , dans le petit Typhonium de
Denderah, et sur la frise du grand temple du même lieu,
on remarque, parmi les sculptures, des personnages représentés
dans l’action de jouer de cette espèce de tambour,
et dont la main droite porte à plat sur le milieu de^
l’instrument.
Spon , dans ses Recherches curieuses d’antiquités, a
placé, page 1j j , deux petites gravures, d’après des médailles
antiques, qui représentent, l’une une Bacchante,
l’autre vraisemblablement une prêtresse, tenant en main
des tambours semblables à ceux dont nous parlons ici :
mais les personnages y tiennent ces instrumens dans une
direction un peu plus oblique que ne le font les person-
UC la malli UIU11C Cl uc la main gauciic ovin c ia i ici dans les personnages de Spon, ce qui donne lieu de
supposer qu’ils pouvoient faire quelque mouvement, et
frapper sur le tam bour, comme le font encore aujourd’hui
ceux qui jouent de cet instrum ent; tandis q u e,su r les
monumens antiques de l’Egypte, les doigts de la main
droite sont étendus, serrés et roides, et ceux de la main
gauche ne se voient point : mais cette différence tient
peut-être à la m anière des artistes de ces temps reculés,
qui tous m ettoient beaucoup de roideur dans tous les
mouvemens de leurs figures.
(6) Et tympano resonante concors infremebat ccho.
Nonn. Dionysiac. lib. XXVII, v. 229.
Cum tympanis grandisonis.
Euripid. Baccha, v. i ; j et se<14-
Cybelles, Phrygìa a d nemora Pece,
U b i çymbalûtn sonai v o x , ubi tynipm a reboant.
¿ululi; LXI, V. 20.
(7) Tympana cimi subito non aprarentia rauets
Obstrepuere sonis. -,
O v ‘>I. Metani, lib. IV , v . 391.
(8) E t tympana compaca ex bubula pelle occipite.
Euripid. Be liti, v. 1363.
E t firm a i molles marea terga manus.
Ovid. Fasi. lib. IV, V. 342.