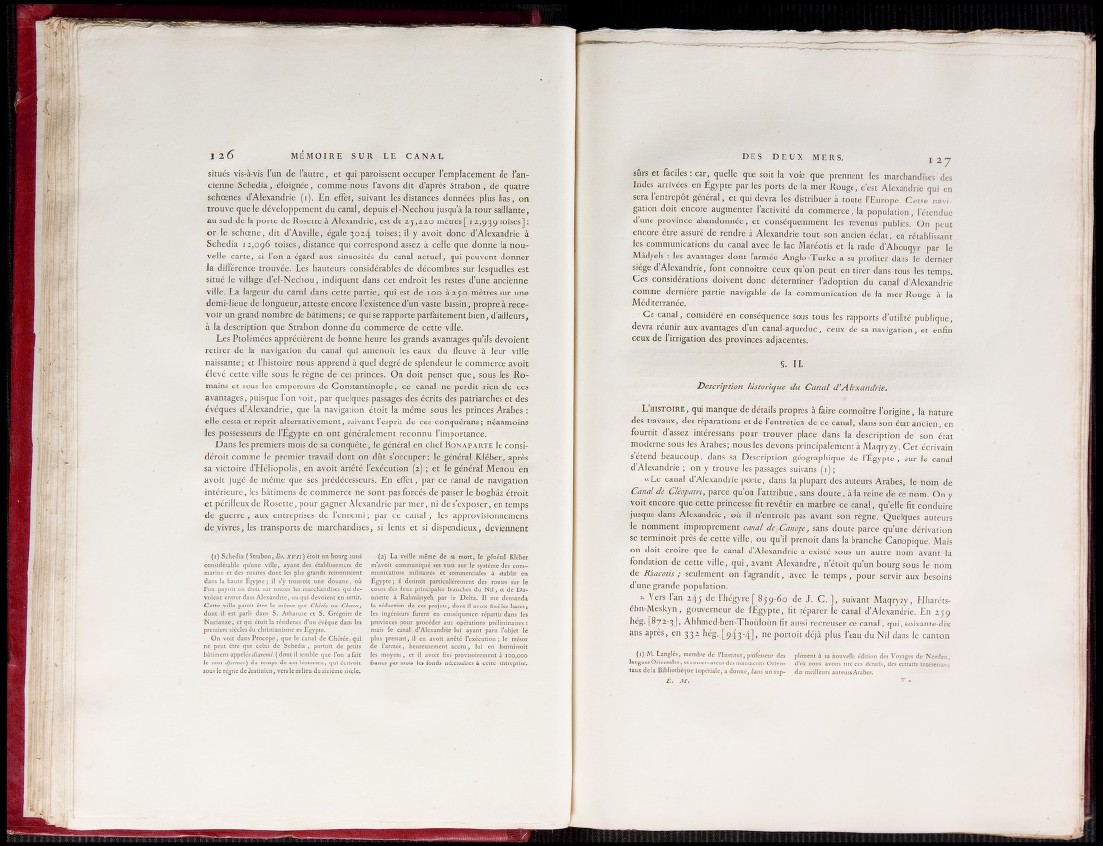
situés vis-à-vis l’un de l’autre, et qui paraissent occuper l’emplacement de l’ancienne
Schedia, éloignée, comme nous l’avons dit d’après Strabon, de quatre
schoenes d’Alexandrie (i). En effet, suivant les distances données plus bas, on
trouve que le développement du canal, depuis el-Nechou jusqu’à la tour saillante,
au sud de la porte de Rosette à Alexandrie, est de 25,220 mètres [ 12,939 toises] :
or le schoene, dit d’Anville, égale 3024 toises; il y avoit donc d’Alexandrie à
Schedia 12,096 toises, distance qui correspond assez à celle que donne la nouvelle
carte, si l’on a égard aux sinuosités du canal actuel, qui peuvent donner
la différence trouvée. Les hauteurs considérables de décombres sur lesquelles est
situé le village d’el-Nechou, indiquent dans cet endroit les restes d’une ancienne
ville. La largeur du canal dans cette partie, qui est de 100 à 250 mètres sur une
demi-lieue de longueur, atteste encore l’existence d’un vaste bassin, propre à recevoir
un grand nombre de bâtimens; ce qui se rapporte parfaitement bien, d’ailleurs,
à la description que Strabon donne du commerce de cette ville.
Les Ptolémées apprécièrent de bonne heure les grands avantages qu’ils devoient
retirer de la navigation du canal qui amenoit les eaux du fleuve à leur ville
naissante ; et l’histoire nous apprend à quel degré de splendeur le commerce avoit
élevé cette ville sous le règne de ces princes. On doit penser que, sous les Romains
et sous les empereurs de Constantinople, ce canal ne perdit rien de ces
avantages, puisque l’on voit, par quelques passages des écrits des patriarches et des
évêques d’Alexandrie, que la navigation étoit la même sous les princes Arabes :
elle cessa et reprit alternativement, suivant l’esprit de ces conquérans; néanmoins
les possesseurs de l’Egypte en ont généralement reconnu l’importance.
Dans les premiers mois de sa conquête, le général en chef B o n a p a r t e le considérait
comme le premier travail dont on dût s’occuper; le général Kléber, après
sa victoire d’Héliopolis, en avoit arrêté l’exécution (2) ; et le général Menou en
avoit jugé de même que ses prédécesseurs. En effet, par ce canal de navigation
intérieure, les bâtimens de commerce ne sont pas forcés de passer le boghâz étroit
et périlleux de Rosette, pour gagner Alexandrie par mer, ni de s’exposer, en temps
de guerre, aux entreprises de l’ennemi ; par ce canal, les approvisionnemens
de vivres, les transports de marchandises, si lents et si dispendieux, deviennent
(1) Schedia ( Strabon, liv, XVIJ) étoit un bourg aussi
considérable qu'une v ille, ayant des établissem ens de
m arine et des navires dont les plus grands rem ontoient
dans la haute E gypte ; il s'y trouvoit une d o u an e, où
l’on payoit un droit sur toutes les m archandises qui devoient
entrer dans A lexandrie, ou qui devoient en sortir.
C ette ville paroît être la m êm e que Chérée ou Chereu,
dont il est parlé dans S. A thanase et S. G régoire de
N azian ze, et qui étoit la résidence d’un évêque dans les
prem iers siècles du christianism e en Egypte.
O n voit dans P rocope, que le canal de C hérée, qui
ne peut être que celui de Schedia , portoit de petits
bâtim ens appelés diaremi ( dont il sem ble que l’on a fait
le m ot djermes) du tem ps de cet historien, qui écrivoit
sous le règne de Justinien, vers le m ilieu du sixièm e siècle.
(2) L a veille m êm e de sa m ort, le général Kléber
m 'avoit com m uniqué ses vues sur le systèm e des com m
unications m ilitaires et com m erciales à établir en
E gypte ; il desiroit particulièrem ent des routes sur le
cours des deux principales branches du N il, et de D a-
m iette à R ahm ânyeh par le D elta. II m e dem anda
la rédaction de ces projets, dont il avoit fixé les bases;
les ingénieurs furent en conséquence répartis dans les
provinces pour procéder aux opérations prélim inaires :
mais le canal d’A lexandrie lui ayant paru l’objet le
plus pressant, il en avoit arrêté l’exécution; le trésor
de l’arm ée, heureusem ent a cc ru , lui en iournissoit
les m oyens, et il avoit fixé provisoirem ent à 100,000
francs par m ois les fonds nécessaires à cette entreprise.
D E S D E U X M E R S . I 2 y
surs et faciles. car, quelle que soit la voie que prennent les marchandises des
Indes ai rivées en Égypte par les ports de la mer Rouge, c’est Alexandrie qui en
sera 1 entrepôt général, et qui devra les distribuer à toute l’Europe. Cette navigation
doit encore augmenter l’activité du commerce, la population, l'étendue
dune province abandonnée, et conséquemment les revenus publics. On peut
encore etre assuré de rendre à Alexandrie tout son ancien éclat, en rétablissant
les communications du canal avec le lac Maréotis et la rade d’Abouqyr par le
Mâdyeh : les avantages dont l’armée Anglo-Turke a su profiter dans le dernier
siège d’Alexandrie, font connoitre ceux qu’on peut en tirer dans tous les temps.
Ces considérations doivent donc déterminer l’adoption du Canal d’Alexandrie
comme dernière partie navigable de la communication de la mer Rouge à la
Méditerranée.
Ce canal, considéré en conséquence sous tous les rapports d’utilité publique,
devra reunir aux avantages dun canal-aqueduc, ceux de sa navigation, et enfin
ceux de l’irrigation des provinces adjacentes.
§. II.
Description historique du Canal d’Alexandrie.
L h i s t o i r e , qui manque de détails propres à faire connoître l’origine, la nature
des travaux, des réparations et de l’entretien de ce canal, dans son état ancien, en
fournit d’assez intéressans pour trouver place dans la description de son état
moderne sous les Arabes; nous les devons principalement à Maqryzy. Cet écrivain
s étend beaucoup, dans sa Description géographique de l’Égypte, sur le canal
d’Alexandrie ; on y trouve les passages suivans (i) ;
«Le canal d’Alexandrie porte, dans la plupart des auteurs Arabes, le nom de
Canal de Cléopatre, parce qu’on l’attribue, sans doute, à la reine de ce nom. On y
voit encore que cette princesse fit revêtir en marbre ce canal, qu’elle fit conduire
jusque dans Alexandrie, où il n’entroit pas avant son règne. Quelques auteurs
le nomment improprement canal de.Canope, sans doute parce qu’une dérivation
se terminoit près de cette ville, ou qu’il prenoit dans la branche Canopique. Mais
on doit croire que le canal d’Alexandrie a existé sous un autre nom avant la
fondation de cette ville, qui, avant Alexandre, n’étoit qu’un bourg sous le nom
de Rhacotis ; seulement on l’agrandit, avec le temps, pour servir aux besoins
d’une grande population.
» Vers lan 245 de Ihégyre [ 859-60 de J. C. ], suivant Maqryzy, Hharéts-
êbn-Meskyn, gouverneur de l’Égypte, fit réparer le canal d’Alexandrie. En 259
hég. [872-3J, Ahh med-ben-Thoùloùn fit aussi recreuser ce canal, qui, soixante-dix
ans après, en 332 heg. [943-4], ne portoit déjà plus l’eau du Nil dans le canton
(1) M . Langlès, m em bre de l'In stitu t, professeur des plém ent à sa nouvelle édition des Voyages de N orden,
langues O rientales, et conservateur des m anuscrits O rien- d’où nous avons tiré ces détails, des extraits intéressans
taux de la Bibliothèque im périale, a donné, dans un sup- des m eilleurs auteurs Arabes.
Ê.M. Ta