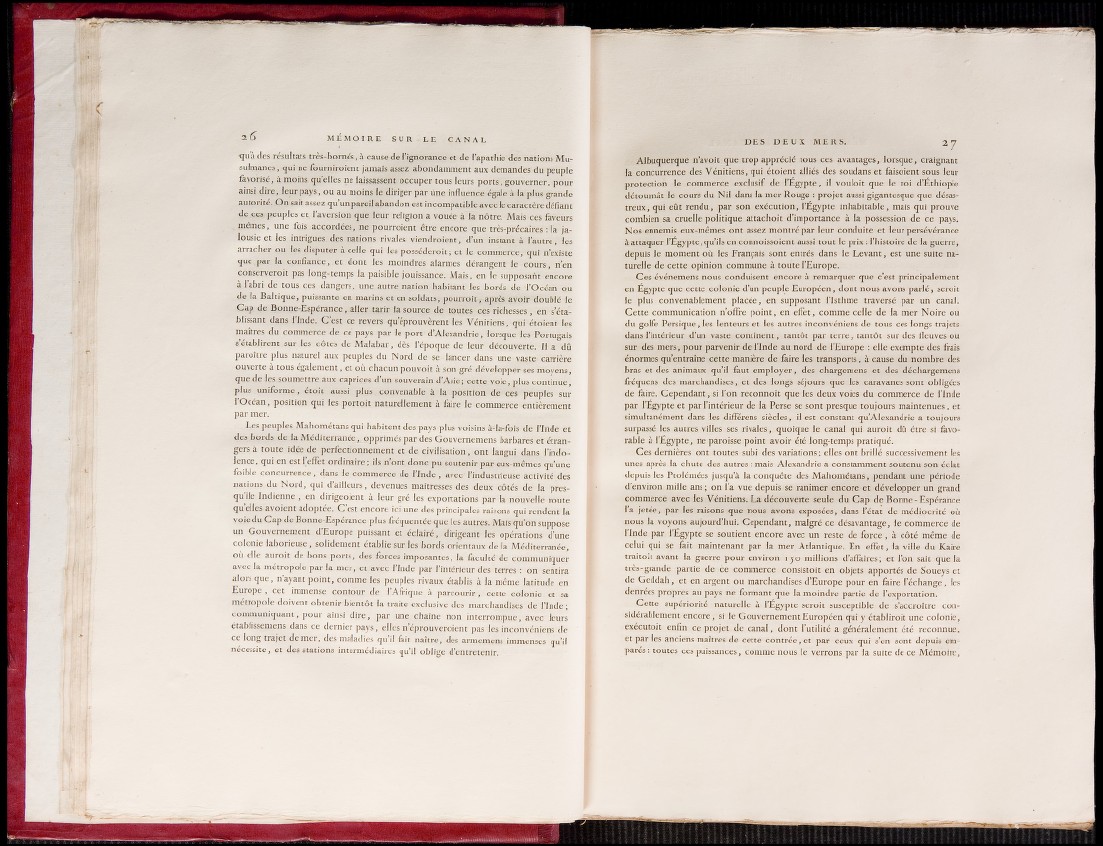
■qu à des résultats très-bornés, à cause de l’ignorance et de l’apathie des nations Musulmanes,
qui ne fourniraient jamais assez abondamment aux demandes du peuple
favorisé, à moins qu’elles ne laissassent occuper tous leurs ports, gouverner, pour
ainsi dire, leur pays, ou au moins le diriger par une influence égale à la plus grande
autorité. On sait assez qu’un pareil abandon est incompatible avec le caractère défiant
de ces peuples et l’aversion que leur religion a vouée à la nôtre. Mais ces faveurs
mêmes, une fois accordées, ne pourroient être encore que très-précaires : la jalousie
et les intrigues des nations rivales viendroient, d’un instant à l’autre, les
airacher ou les disputer a celle qui les posséderoit; et le commerce, qui n’existe
que par la confiance, et dont les moindres alarmes dérangent le cours, n’en
conserverait pas long-temps la paisible jouissance. Mais, en le supposant encore
à labri de tous ces dangers, une autre nation habitant les bords de l’Océan ou
de la Baltique, puissante en marins et en soldats, pourroit, après avoir doublé le
Cap de Bonne-Esperance, aller tarir la source de toutes ces richesses , en s’établissant
dans 1 Inde. C est ce revers qu éprouvèrent les Vénitiens, qui étoient les
maîtres du commerce de ce pays par le port d’Alexandrie, lorsque les Portugais
s établirent sur les cotes de Malabar, dès l’époque de leur découverte. Il a dû
paroitre plus naturel aux peuples du Nord de se lancer dans une vaste carrière
ouveite a tous également, et ou chacun pouvoit à son gré développer ses moyens,
que de les soumettre aux caprices d un souverain d’Asie; cette voie, plus continue,
plus uniforme, etoit aussi plus convenable à la position de ces peuples sur 1 Océan, position qui les portoit naturellement à faire le commerce entièrement
par mer.
Les peuples Mahométans qui habitent des pays plus voisins à-la-fois de l’Inde et
des bords de la Mediterranee, opprimés par des Gouvernemens barbares et étrangers
à toute idée de perfectionnement et de civilisation, ont langui dans l’indolence,
qui en est 1 effet ordinaire ; ils n ont donc pu soutenir par eux-mêmes qu’une
foible çoncuirence, dans le commerce de iln d e , avec l’industrieuse activité des
nations du Nord, qui d’ailleurs, devenues maîtresses des deux côtés de la presqu’île
Indienne , en dirigeoient à leur gré les exportations par la nouvelle route
qu elles avoient adoptée. C est encore ici une des principales raisons qui rendent la
voie du Cap de Bonne-Espérance plus fréquentée que les autres. Mais qu’on suppose
un Gouvernement d’Europe puissant et éclairé, dirigeant les opérations d’une
colonie laborieuse, solidement établie sur les bords orientaux de la Méditerranée,
où elle aurait de bons ports, des forces imposantes, la faculté de communiquer
avec la métropole par la mer, et avec l’Inde par l’intérieur des terres : on sentira
alors que, n’ayant point, comme les peuples rivaux établis à la même latitude en
Eut o p e , cet immense contour de l’Afrique à parcourir, cette colonie et sa
métropole doivent obtenir bientôt la traite exclusive des marchandises de l’Inde;
communiquant, pour ainsi dire, par une chaîne non interrompue, avec leurs
etablissemens dans ce dernier pays, elles n’éprouveraient pas les inconvéniens de
ce long trajet de mer, des maladies qu il fait naître, des armemens immenses qu’il
nécessite, et des stations intermédiaires quil oblige d’entretenir.
Albuquerque n’avoit que trop apprécié tous ces avantages, lorsque, craignant
la concurrence des Vénitiens, qui étoient alliés des soudans et faisoient sous leur
protection le commerce exclusif de l’Egypte, il youloit que le roi d’Ethiopie
détournât le cours du Nil dans la mer Rouge : projet aussi gigantesque que désastreux,
qui eût rendu, par son exécution, l’Egypte inhabitable, mais qui prouve
combien sa cruelle politique attachoit d’importance à la possession de ce pays.
Nos ennemis eux-mêmes ont assez montré par leur conduite et leur persévérance
à attaquer l’Egypte, qu’ils en connoissoient aussi tout le prix : l’histoire de la guerre,
depuis le moment où les Français sont entrés dans le Levant, est une suite naturelle
de cette opinion commune à toute l’Europe.
Ces événemens nous conduisent encore à remarquer que c’est principalement
en Egypte que cette colonie d’un peuple Européen, dont nous avons parlé, serait
le plus convenablement placée, en supposant l’Isthme traversé par un canal.
Cette communication n’offre point, en effet, comme celle de la mer Noire ou
du golfe Persique, les lenteurs et les autres inconvéniens de tous ces longs trajets
dans l’intérieur d’un vaste continent, tantôt par terre, tantôt sur des fleuves ou
sur des mers, pour parvenir de l’Inde au nord de l’Europe : elle exempte des frais
énormes qu’entraîne cette manière de faire les transports, à cause du nombre des
bras et des animaux qu’il faut employer, des chargemens et des déchargemens
fféquens des marchandises, et des longs séjours que les caravanes sont obligées
de faire. Cependant, si l’on reconnoît que les deux voies du commerce de l’Inde
par l’Egypte et par l’intérieur de la Perse se sont presque toujours maintenues, et
simultanément dans les differens siècles, il est constant qu’Alexandrie a toujours
surpassé les autres villes ses rivales, quoique le canal qui aurait dû être si favorable
à l’Egypte, ne paroisse point avoir été long-temps pratiqué.
Ces dernières ont toutes subi des variations; elles ont brillé successivement les
unes après la chute des autres : mais Alexandrie a constamment soutenu son éclat
depuis les Ptolémées jusqu’à la conquête des Mahométans, pendant une période
d’environ mille ans ; on l’a vue depuis se ranimer encore et développer un grand
commerce avec les Vénitiens. La découverte seule du Cap de Bonne - Espérance
l’a jetée, par les raisons que nous avons exposées, dans l’état de médiocrité où
nous la voyons aujourdhui. Cependant, malgré ce désavantage, le commerce de 1 Inde par 1 Egypte se soutient encore avec un reste de force, à côté même de
celui qui se fait maintenant par la mer Atlantique. En effet, la ville du Kaire
trairait avant la guerre pour environ iy o millions d’affaires; et l’on sait que. la
très-grande partie de ce commerce consistoit en objets apportés de Soueys et
de Geddah, et en argent ou marchandises d’Europe pour en faire l’échange, les
denrees propres au pays ne formant que la moindre partie de l’exportation.
Cette supériorité naturelle à l’Egypte serait susceptible de s’accroître considérablement
encore, si le Gouvernement Européen qui y établirait une colonie,
executoit enfin ce projet de canal, dont l’utilité a généralement été reconnue,
et par les anciens maîtres de cette contrée, et par ceux qui s’en sont depuis empares:
toutes ces puissances, comme nous le verrons par la suite de ce Mémoire,