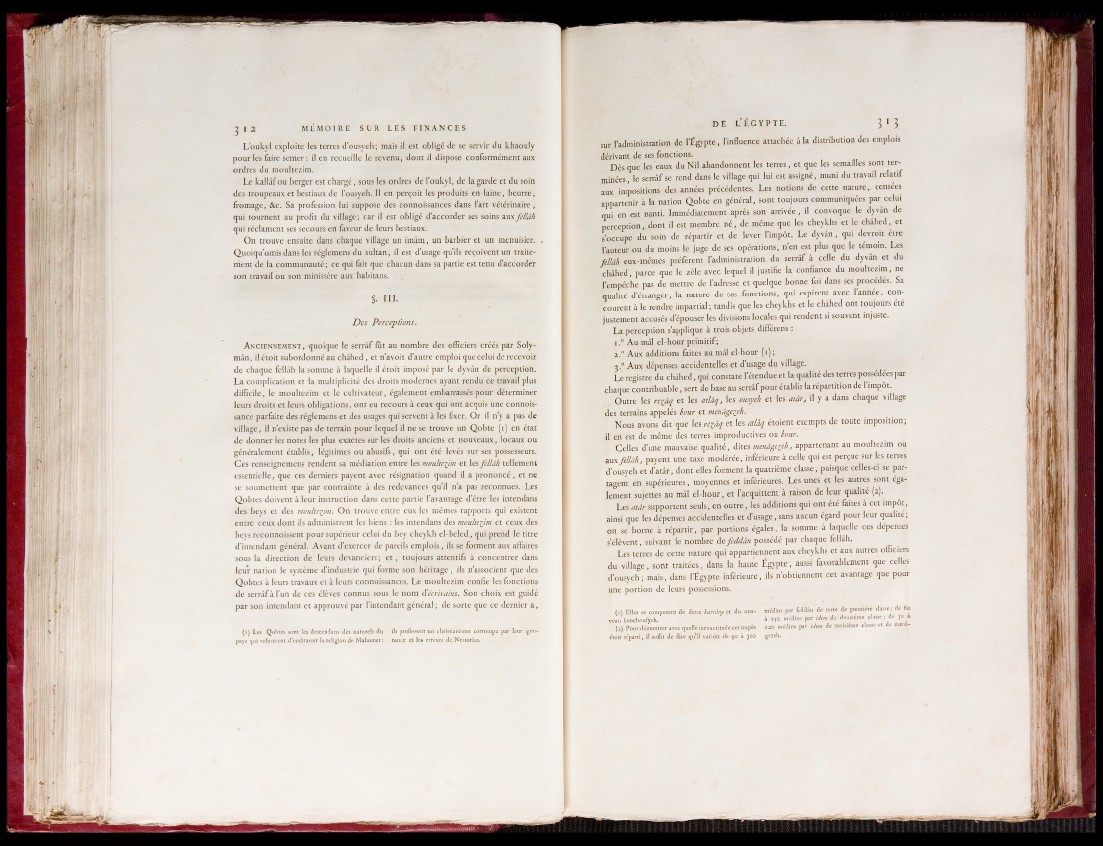
L’oukyl exploite les terres d’ousyeh; mais il est obligé de se servir du khaouly
pour les faire semer : il en recueille le revenu, dont il dispose conformément aux
ordres du moultezim.
Le kallâf ou berger est chargé, sous les ordres de l’oukyl, de la garde et du soin
des troupeaux et bestiaux de l’ousyeh. Il en perçoit les produits en laine, beurre,
fromage, &c. Sa profession lui suppose des connoissances dans l’art vétérinaire ,
qui tournent au profit du village; car il est obligé d’accorder ses soins auxfellâh
qui réclament ses secours en' faveur de leurs bestiaux.
On trouve ensuite dans chaque village un imâm, un barbier et un menuisier. .
Quoiqu’omis dans les réglemens du sultan, il est d’usage qu’ils reçoivent un traitement
de la communauté ; ce qui fait que chacun dans sa partie est tenu d’accorder
son travail ou son ministère aux habitans.
§. II I.
Des Perceptions.
A n c i e n n e m e n t , quoique le serrâf fut au nombre des officiers créés par Solymân,
il étoit subordonné au châhed, et n’avoit d’autre emploi que celui de recevoir
de chaque fellâh la somme à laquelle il étoit imposé par le dyvân de perception.
La complication et la multiplicité des droits modernes ayant rendu ce travail plus
difficile, le moultezim et le cultivateur, également embarrassés pour déterminer
leurs droits et leurs obligations, ont eu recours à ceux qui ont acquis une connois-
sance parfaite des réglemens et des usages qui servent à les fixer. Or il n’y a pas de
village, il n’existe pas de terrain pour lequel il ne se trouve un Qobte (i) en état
de donner les notes les plus exactes sur les droits anciens et nouveaux, locaux ou
généralement établis, légitimes ou abusifs, qui ont été levés sur ses possesseurs.
Ces renseignemens rendent sa médiation entre les moultefim et les fellâh tellement
essentielle, que ces derniers payent avec résignation quand il a prononcé, et ne
se soumettent que par contrainte à des redevances qu’il n’a pas reconnues. Les
Qobtes doivent à leur instruction dans cette partie'l’avantage d’être les intendans
des beys et des moulteftm. On trouve entre eux les mêmes rapports qui existent
entre ceux dont ils administrent les biens : les intendans des moulteftm et ceux des
beys reconnoissent pour supérieur celui du bey cheykh el-beled, qui prend le titre
d’intendant général. Avant d’exercer de pareils emplois, ils se forment aux affaires
sous la direction de leurs devanciers ; e t , toujours attentifs à concentrer dans
leur nation le système d’industrie qui forme son héritage , ils n’associent que des
Qobtes à leurs travaux et à leurs connoissances. Le moultezim confie les fonctions
de serrâf à l’un de ces élèves connus sous le nom d’Écrivains. Son choix est gu idé
par son intendant et approuvé par l’intendant général ; de sorte que ce dernier a,
(i) Les Qobtes sont les descendans des naturels du ils professent un christianisme corrompu par leur igno-
pays qui refusèrent d’embrasser la religion de M ahomet : rance et les erreurs de Nestorius.
sur l’administration de l’Égypte, l’influence attachée à la distribution des emplois
dérivant de ses fonctions.
Dès que les eaux du Nil abandonnent les terres, et que les semailles sont terminées,
le serrâf se rend dans le village qui lui est assigné, muni du travail relatif
aux impositions des années précédentes. Les notions de cette nature, . censées
appartenir à la nation Qobte en général, sont toujours communiquées par celui
qui en est nanti. Immédiatement après son arrivée , il convoque le dyvân de
perception, dont il est membre n é, de même que les cheykhs et le châhed et
s’occupe du soin de répartir et de lever l’impôt. Le dyvân , qui devroit etre
fauteur ou du moins le juge de ses opérations, n’en est plus que le témoin. Les
fellâh eux-mêmes préfèrent l’administration du serrâf à celle du dyvân et du
châhed, parce que le zèle avec lequel il justifie la confiance du moultezim, ne
l’empêche pas de mettre de l’adresse et quelque bonne foi dans ses procédés. Sa
qualité d’étranger, la nature de ses fonctions, qui expirent avec lannee, concourent
à le rendre impartial ; tandis que les cheykhs et le châhed ont toujours été
justement accusés d’épouser les divisions locales qui rendent si souvent injuste.
La perception s’applique à trois objets différens :
1.° Au mâl el-hour primitif;
2.° Aux additions faites au mâl el-hour (i);
q.“ Aux dépenses accidentelles et d’usage du village.
Le registre du châhed, qui constate l’étendue et la qualité des terres possédées par
chaque contribuable, sert de base au serrâf pour établir la répartition de 1 impôt.
Outre les reiâq et les atlâq, les ousyeh et les aiâr, il y a dans chaque village
des terrains appelés bour et menâgeieh.
Nous avons dit que les re^âq et les atlâq étoient exempts de toute imposition,
il en est de même des terres improductives ou bour.
Celles d’une mauvaise qualité, dites menâgeieh, appartenant au moultezim ou
aux fellâh, payent une taxe modérée, inférieure à celle qui est perçue sur les teries
d’ousyeh et d’atâr, dont elles forment la quatrième classe, puisque celles-ci se partagent
en supérieures, moyennes et inférieures. Les unes et les autres sont également
sujettes au mâl el-hour, et l’acquittent à raison de leur qualité (z).
Les atâr supportent seuls, en outre, les additions qui ont ete faites à cet impôt,
ainsi que les dépenses accidentelles et d’usage, sans aucun égard pour leur qualité,
on se borne à répartir, par portions égales, la somme à laquelle ces dépenses
s’élèvent, suivant le nombre defeddân possédé par chaque fellâh.
Les terres de cette nature qui appartiennent aux cheykhs et aux autres officiers
du village, sont traitées, dans la haute Égypte, aussi favorablement que celles
d’ousyeh; mais, dans l’Égypte inférieure, ils n’obtiennent cet avantage que pour
une portion de leurs possessions.
I l ) E lle s se composent d e d eu x barrâny e t du n o u - médins par feddân d e terre d e première clas se, d e 60
v e a u ko uch ou fy eh . à 150 médins par idem de d eu xièm e classe ; d e 30 a
(a ) P o u r d émontrer a v e c q u e lle in e x a c titu d e cet im pô t 120 médins pa r idem d e troisième c a s s e et e mena
é to it rep a r ti, il suffit d e dire qu’ il v a r io ir d e 90 à 300 gezeh.