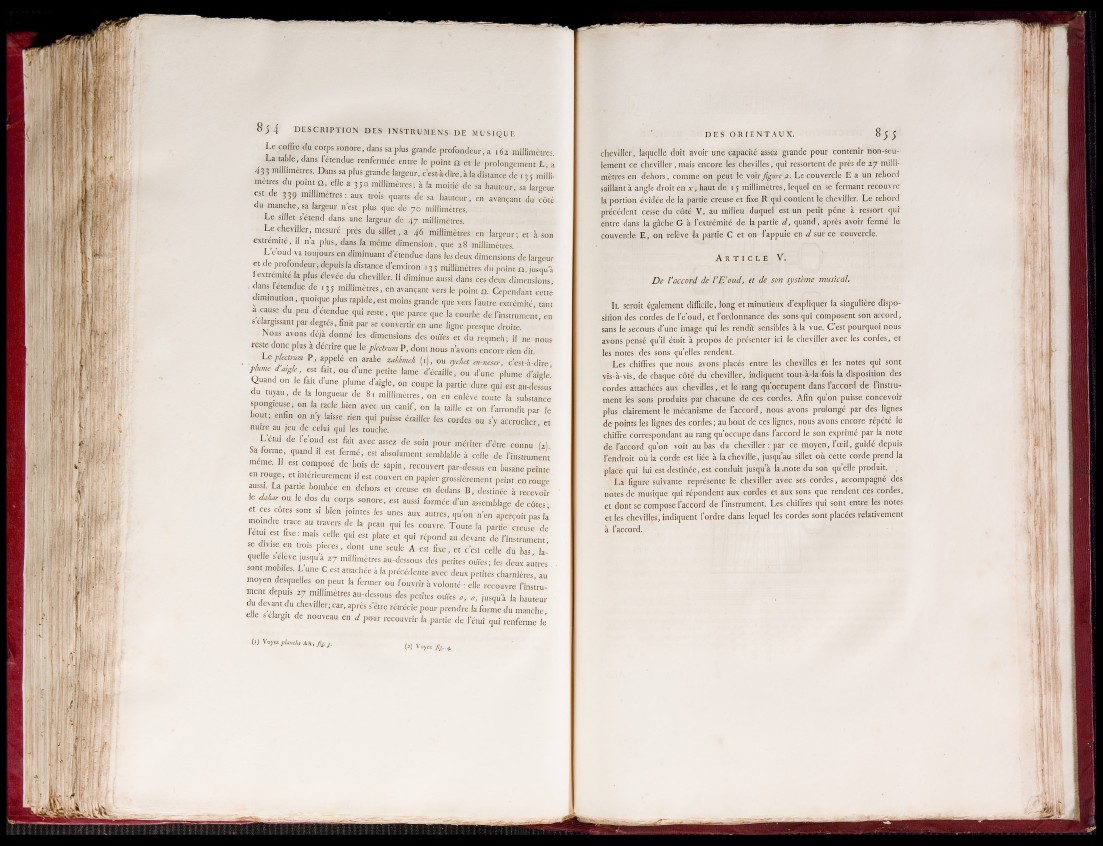
Le coffre du corps sonore, dans sa plus grande profondeur, a 162 millimètres.
La table, dans l’étendue renfermée entre Je point a et le prolongement L, a
43 3 millimétrés. Dans sa plus grande largeur, c’est-à-dire, à la distance de 13 5 millimétrés
du point a , elle a 350 millimètres; à la moitié de sa hauteur, sa largeur
est de 339 millimètres: aux trois quarts de sa hauteur, en avançant du côté
du manche, sa largeur n’est plus que de 70 millimètres.
Le sillet s etend dans une largeur de 47 millimètres.
Le cheviller, mesuré près du sillet, a 46 millimètres en largeur ; et à son
extrémité, il n a plus, dans la même dimension, que 28 millimètres.
L ’e’oud va toujours en diminuant d’étendue dans les deux dimensions de largeur
et de profondeur, depuis la distance d’environ 13 y millimètres du point a , jusqu'à
I extrémité la plus élevée du cheviller. Il diminue aussi dans ces deux dimensions,
. dans 1 étendue de 135 millimètres, en avançant vers le point a. Cependant cette’
diminution, quoique plus rapide, est moins grande que vers l’autre extrémité tant
a cause du peu d’étendue qui reste, que parce que la courbe de l’instrument, en
s élargissant par degrés, finit par se convertir en une ligne presque droite.
Nous avons déjà donné les dhnensions des ouïes et du reqmeh; il ne nous
reste donc plus à décrire que le plectrnm P, dont nous n’avons encore rien dit
L e plectrum P, appelé en arabe zakhmeh (.), ou rycliet en-neser, c’est-à-dire
ftone dagfe est fait, ou d’une petite lame d’écaille, ou d’une plume d’aigle’
Quand on le fait d une plume d’aigle, on coupe la partie dure qui est au-dessus
du tuyau, de la longueur de 81 millimètres, on en enlève toute la substance
spongieuse, on la racle bien avec un canif, on la taille et on l’arrondit par le
bout; enfin on ny laisse rien qui puisse érailler les cordes ou s’y accrocher et
nuire au jeu de celui cjuî les touche.
Letui de leo ud est fait avec assez de soin pour mériter d’étre connu (2).
a forme, quand il est fermé, est absolument semblable à celle de l’instrument
meme. est composé de bois de sapin, recouvert par-dessus en basane peinte
en rouge, et intérieurement il est couvert en papier grossièrement peint en rouge
aussi La partie bombée en dehors et creuse en dedans B, destinée à recevoir
le dakar ou le dos du corps sonore, est aussi formée d’un assemblage de côtes-
« ces cotes sont si bien jointes les unes aux autres, qu’on n’en aperçoit pas la’
moindre trace au travers de la peau qui les couvre. Toute la partie creuse de
etui est fixe: mais celle qui est plate et qui répond au devant de l’instrument
se Avise en trois preces, dont une seule A est fixe, et c’est celle du bas, laquelle
s eleve jusqua 27 millimètres au-dessous des petites ouïes; les deux autres
sont mobiles. L une C est attachée à la précédente avec deux petites charnières, au
moyen desquelles on peut la fermer ou l’ouvrir à volonté : elle recouvre l’mstrududevam
T Y Y ' “ des Petites ° uïes du devant du cheviller; car, après s’être réxrécie pour prend^re la fjoursmque’ àd ula m haanuctehuer,
elle s élargit de nouveau en d pour recouvrir la partie de l’étui qui renferme le
0 ) Voyez planche AA, J!g. j . ( 4 Voyez J%. *
cheviller, laquelle doit avoir une capacité assez grande pour contenir non-seulement
ce cheviller , mais encore les chevilles, qui ressortent de près de 27 millimètres
en dehors, comme on peut le voir figure 2. Le couvercle E a un rebord
saillant à angle droit en x , haut de 15 millimètres, lequel en se fermant recouvre
la portion évidée de la partie creuse et fixe R qui contient le cheviller. Le rebord
précédent cesse du côté V, au milieu duquel est un petit pêne à ressort qui
entre dans la gâche G à l’extrémité de la partie d, quand, après avoir fermé le-
couvercle E , on relève la partie C et on l’appuie en d sur ce couvercle.
A r t i c l e V.
De l’accord de l ’E ’oud, et de son système musical.
Il seroit également difficile, long et minutieux d’expliquer la singulière disposition
des cordes de l’e’oud, et l’ordonnance des sons qui composent son accord,
sans le secours d’une image qui les rendît sensibles à la vue. C’est pourquoi nous
avons pensé qu’il étoit à propos de présenter ici le cheviller avec les cordes, et
les notes des sons qu’elles rendent.
Les chiffres que nous avons placés entre les chevilles et les notes qui sont
vis-à-vis, de chaque côté du cheviller, indiquent tout-à-la -fois la disposition des
cordes attachées aux chevilles, et le rang qu’occupent dans l’accord de l’instrument
les sons produits par chacune de ces cordes. Afin qu’on puisse concevoir
plus clairement le mécanisme de I accord, nous avons prolonge par des lignes
de points les lignes des cordes ; au bout de ces lignes, nous avons encore répété le
chiffre correspondant au rang qu’occupe dans l’accord le son exprhné par la note
de l’accord qu’on voit au bas du cheviller: par ce moyen, l’oeil, guidé depuis
l’endroit où la corde est liée à la cheville, jusqu’au sillet où cette corde prend la
place qui lui est destinée, est conduit jusqu’à la .note du son qu’elle produit. .
La figure suivante représente le cheviller avec ses cordes, accompagné des
notes de musique qui répondent aux cordes et aux sons que rendent ces cordes,
et dont se compose l’accord de l’instrument. Les chiffres qui sont entre les notes
et les chevilles, indiquent l’ordre dans lequel les cordes sont placées relativement
à l’accord.