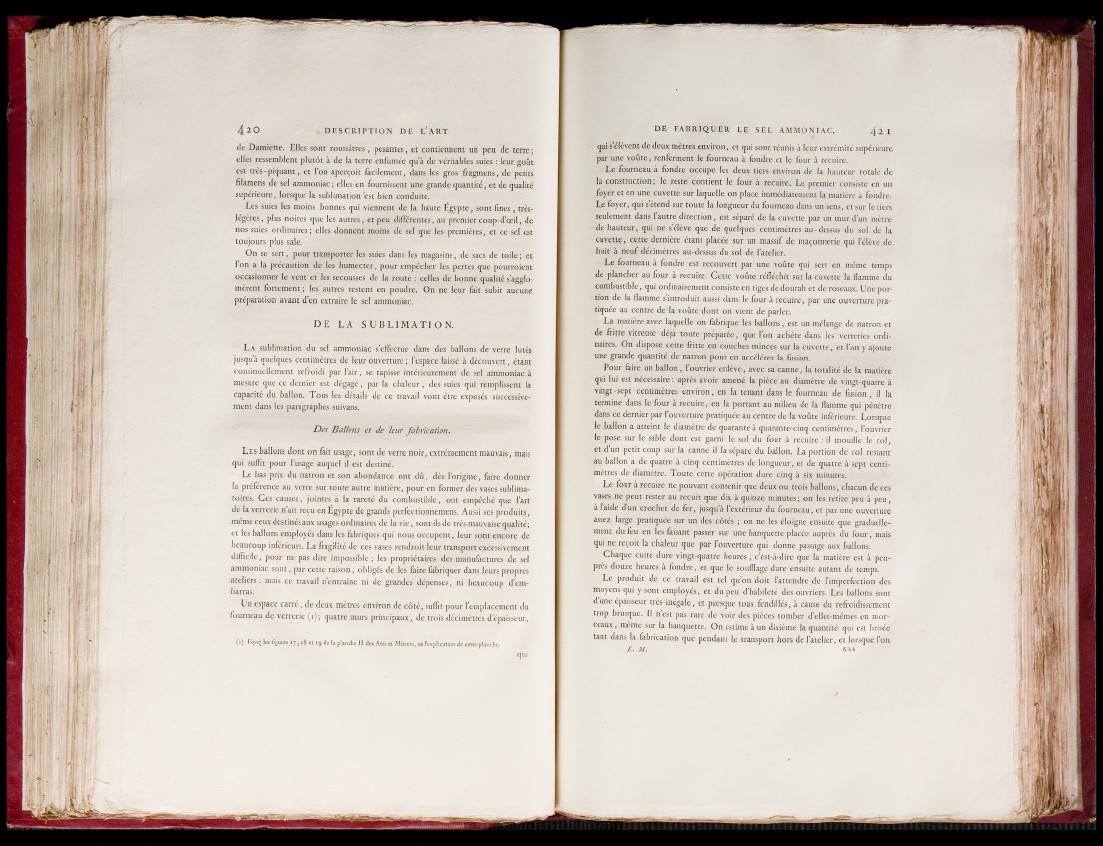
4 ^ 0 [ D E S C R I P T I O N D E L ’ A R T
de Damiette. Elles sont roussâtres , pesantes, et contiennent un peu de terre ;
elles ressemblent plutôt à de la terre enfumée qu’à de véritables suies : leur goût
est très-piquant, et l’on aperçoit facilement, dans les gros fragmens, de petits
filamens de sel ammoniac; elles en fournissent une grande quantité, et de qualité
supérieure, lorsque la sublimation est bien conduite.
Les suies les moins bonnes qui viennent de la haute Égypte, sont fines, très-
légères, plus noires que les autres, et peu différentes, au premier coup-d’oeil, de
nos suies ordinaires; elles donnent moins de sel que les premières, et ce sel est
toujours plus sale.
On se sert, pour transporter les suies dans les magasins, de sacs de toile ; et
1 on a la précaution de les humecter, pour empêcher les pertes que pourroient
occasionner le vent et les secousses de la route : celles de bonne qualité s’agglomèrent
fortement ; Jes autres restent en poudre. On ne leur lait subir aucune
préparation avant d’en extraire le sel ammoniac.
D E L A SU B L IMA T I O N.
L a sublimation du sel ammoniac s’effectue dans des ballons de verre lutéj
jusqu’à quelques centimètres de leur ouverture ; l’espace laissé à découvert, étant
continuellement refroidi par l’air, se tapisse intérieurement de sel ammoniac à
mesure que ce dernier est dégagé, par la chaleur, des suies qui remplissent la
capacité du ballon. Tous les détails de ce travail vont être exposés successivement
dans les paragraphes suivans.
Des Ballons et de leur fabrication.
L es ballons dont on fait usage, sont de verre noir, extrêmement mauvais, mais
qui suffit pour l’usage auquel il est destiné.
Le bas prix du natron et son abondance ont dû, dès l’origine, faire donner
la préférence au verre sur toute autre matière, pour en former des vases sublima-
toires. Ces causes, jointes à la rareté du combustible, ont empêché que l’art
de la verrerie n’ait reçu en Égypte de grands perfectionnemens. Aussi ses produits,
meme ceux destinés aux usages ordinaires de la vie, sont-ils de très-mauvaise qualité ;
et les ballons employés dans les fabriques qui nous occupent, leur sont encore de
beaucoup inférieurs. La fragilité de ces vases rendroit leur transport excessivement
difficile, pour ne pas dire impossible; Jes propriétaires des manufactures de sel
ammoniac sont, par cette raison, obligés de les faire fabriquer dans leurs propres
ateliers : mais ce travail n’entraîne ni de grandes dépenses, ni beaucoup d’em-
frarras.
Un espace carré, de deux mètres environ de côté, suffit pour l’emplacement du
fourneau de verrerie (i); quatre murs principaux, de trois décimètres d’épaisseur,
.0 ) yÿyiz Ie5 figures 17, 18 et 19 de la p'anche II des Arts et M étiers, et l’explication de cette planche.
D E F A B R I Q U E R L E S E L A M M O N I A C . 4 2 I
qui s elevent de deux métrés environ, et qui sont réunis à leur extrémité supérieure
par une voûte, renferment le fourneau à fondre et le four à recuire.
Le fourneau a fondre occupe les deux tiers environ de la hauteur totale de
la construction ; le reste contient le four a recuire. Le premier consiste en un
foyer et en une cuvette sur laquelle on place immédiatement la matière' à fondre.
Le foyer, qui s’étend sur toute la longueur du fourneau dans un sens, et sur le tiers
seulement dans 1 autre direction, est séparé de la cuvette par un mur d’un mètre
de hauteur, qui ne s’élève que de quelques centimètres au-dessus du sol de la
cuvette, cette derniere étant placée sur un massif de maçonnerie qui l’élève de
huit à neuf décimètres au-dessus du sol de l’atelier.
Le fourneau à fondre est recouvert par une voûte qui sert en même temps
de plancher au four a recuire. Cette voûte réfléchit sur la cuvette la flamme du
combustible, qui ordinairement consiste en tiges de dourah et de roseaux. Une portion
de la flamme s introduit aussi dans le four à recuire, par une ouverture pratiquée
au centre de la voûte dont on vient de parler.
La matière avec laquelle on fabrique les ballons, est un mélange de natron et
de fritte vitreuse deja toute préparée, que l’on achète dans les verreries ordinaires.
On dispose cette fritte en couches minces sur la cuvette, et l’on y ajoute
une grande quantité de natron pour en accélérer la fiision.
Pour faire un ballon, l’ouvrier enlève, avec sa canne, la totalité de la matière
qui lui est nécessaire : après avoir amené la pièce au diamètre de vingt-quatre à
vingt-sept centimètres environ, en la tenant dans le fourneau de fusion, il la
termine dans le four à recuire, en la portant au milieu de la flamme qui pénètre
dans ce dernier par l’ouverture pratiquée au centre de la voûte inférieure. Lorsque
le ballon a atteint le diamètre de quarante à quarante-cinq centimètres, l’ouvrier
le pose sur le sable dont est garni Je sol du four à recuire : il mouille le col,
et d’un petit coup sur la canne il la sépare du ballon. La portion de col restant
au ballon a de quatre à cinq centimètres de longueur, et de quatre à sept centimètres
de diametre. Toute cette opération dure cinq à six minutes.
Le four a recuire ne pouvant contenir que deux ou trois ballons, chacun de ces
vases ne peut rester au recuit que dix à quinze minutes; on les retire peu à peu,
à laide dun crochet de fer, jusqu’à l’extérieur du fourneau, et par une ouverture
assez large pratiquée sur un des côtés ; on ne les éloigne ensuite que graduellement
du feu en les faisant passer sur une banquette placée auprès du four, mais
qui ne reçoit la chaleur que par l’ouverture qui donne passage aux ballons.
Chaque cuite dure vingt-quatre heures , c’est-à-dire que la matière est à peu-
pres douze heures à fondre, et que le soufflage dure ensuite autant de temps.
Le produit de ce travail est tel qu’on doit l’attendre de l’imperfection des
moyens qui y sont employés, et du peu d’habileté des ouvriers. Les ballons sont
d une épaisseur très-inégale, et presque tous fendillés, à cause du refroidissement
trop brusque. Il nest pas rare de voir des pièces tomber d’elles -mêmes en morceaux
, meme sur la banquette. On estime à un dixième la quantité qui est brisée
tant dans la fabrication que pendant le transport hors de l’atelier, et lorsque l’on
É. M . Kk k