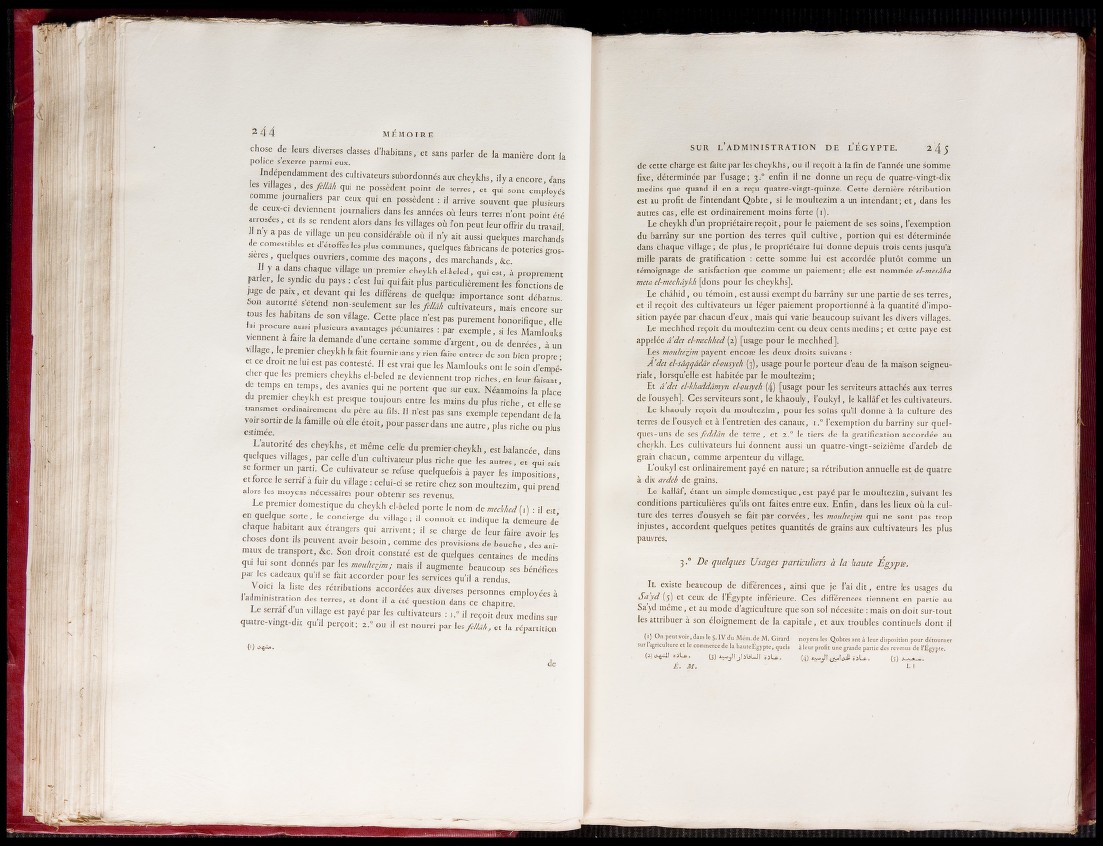
2 4 4 M É M O I R E
C:hose de leurs diverses classes d’habitans, et sans parler de la manière dont la
police s exerce parmi eux.
Indépendamment des cultivateurs subordonnés aux cheykhs, il y a encore, dans
les villages, desfillâh qui ne possèdent point de terres, et qui sont employés
comme journaliers par ceux qui en possèdent : il arrive souvent que plusieurs
de ceux-ci deviennent journaliers dans les années où leurs terres n’ont point été
arrosées, et ils se rendent alors dans les villages où l’on peut leur offrir du travail.
Il ny a pas de village un peu considérable où il n’y ait aussi quelques marchands
e comestibles et d’étoffes les plus communes, quelques fabricans de poteries grossières,
quelques ouvriers, comme des maçons, des marchands, &c
Il y a dans chaque village un premier cheykh el-beled, qui est, à proprement
parler, le syndic du pays : c'est lui qui fait plus particulièrement les fonctions de
juge de paix, et devant qui les différens de quelque importance sont débattus
Son autorité setend non-seulement sur fellâh cultivateurs, mais encore sur
tous les habitans de son village. Cette place n’est pas purement honorifique elle
lu, procure aussi plusieurs avantages pécuniaires : par exemple, si les Mamlouks
viennent a frire la demande d’une certaine somme d’argent, ou de denrées à un
village le premier cheykh la fait fournir sans y rien faire entrer de son bien propre •
et ce droit ne lui est pas contesté. Il est vrai que les Mamlouks ont le soin d’empêcher
que les premiers cheykhs el-beled ne deviennent trop riches, en leur faisant
de temps en temps, des avanies qui ne portent que sur eux. Néanmoins la placé
du premier cheykh est presque toujours entre les mains du plus riche et elle se
transmet ordinairement du père au fils. Il n’est pas sans exemple cependant de la
> ou- sortir de la famille ou elle étoit, pour passer dans une autre, plus riche ou plus
estimee, *
L autorité des cheykhs, et même celle du premier cheykh, est balancée dans
quelques villages, par celle d’un cultivateur plus riche que les autres, et qui sait
se former un parte Ce cultivateur se refuse quelquefois à payer les impositions,
e force le serraf a finr du village : celui-ci se retire chez son moultezim, qui prend
alors les moyens nécessaires pour obtenir ses revenus.
Le premier domestique du cheykh el-beled porte le nom de mechhed (,) : il est
en quelque sorte, le concierge du village; il connoît et indique la demeure dé
chaque habitant aux étrangers qui arrivent; il se charge de leur faire avoir les
choses dont ,1s peuvent avoir besoin, comme des provisions de bouche, des animaux
de transport, &c. Son droit constaté est de quelques centaines dé medins
qui ui sont donnés par les mouheiim; mais il augmente beaucoup ses bénéfices
par les cadeaux qu’il se fiiit accorder pour les services qu’il a rendus.
Voici la liste des rétributions accordées aux diverses personnes employées à
1 administration des terres, et dont il a été question dans ce chapitre.
Le serraf d’un village est payé par les cultivateurs : i i l reçoit deux medins sur
quatre-vingt-dix qu’,1 perçoit; z.° ou il est nourri par les fdlâh, et la répartition
(i)
de
de cette charge est faite par les cheykhs, ou il reçoit à la fin de l’année une somme
fixe, déterminée par l’usage; 3.° enfin il ne donne un reçu de quatre-vingt-dix
medins que quand il en a reçu quatre-vingt-quinze. Cette dernière rétribution
est au profit de l’intendant Qobte, si le moultezim a un intendant; et, dans les
autres cas, elle est ordinairement moins forte (1).
Le cheykh d’un propriétaire reçoit, pour le paiement de ses soins, l’exemption
du barrâny sur une portion des terres qu’il cultive, portion qui est déterminée
dans chaque village ; de plus, le propriétaire lui donne depuis trois cents jusqu’à
mille parats de gratification : cette somme lui est accordée plutôt comme un
témoignage de satisfaction que comme un paiement; elle est nommée el-mesâha
meta el-mechâykh [dons pour les cheykhs].
Le châhid, ou témoin, est aussi exempt du barrâny sur une partie de ses terres,
et il reçoit des cultivateurs un léger paiement proportionné à la quantité d’imposition
payée par chacun d’eux, mais qui varie beaucoup suivant les divers villages.
Le mechhed reçoit du moultezim cent ou deux cents medins ; et cette paye est
appelée â'det el-mechhed (2) [usage pour le mechhed].
Les moultezim payent encore les deux droits suivans :
A'det el-sâqqâdâr el-ousyeh (3), usage pour le porteur d’eau de la maison seigneuriale,
lorsqu’elle est habitée par le moultezim;
Et â’det el-khaddâmyn el-ousyeh (4) [usage pour les serviteurs attachés aux terres
de l’ousyeh]. Ces serviteurs sont, le khaouly, l’oukyl, le kallâf et les cultivateurs.
Le khaouly reçoit du moultezim, pour les soins qu’il donne à la culture des
terres de l’ousyeh et à l’entretien des canaux, 1 ° l’exemption du barrâny sur quelques
uns de ses feddân de terre, et 2.° le tiers de la gratification accordée au
cheykh. Les cultivateurs lui donnent aussi un quatre-vingt-seizième d’ardeb de
grain chacun, comme arpenteur du village.
L’oukyl est ordinairement payé en nature ; sa rétribution annuelle est de quatre
à dix ardeb de grains.
Le kallâf, étant un simple domestique, est payé par le moultezim, suivant les
conditions particulières qu’ils ont frites entre eux. Enfin, dans les lieux où la culture
des terres d’ousyeh se frit par corvées, les moulteÿm qui ne sont pas trop
injustes, accordent quelques petites quantités de grains aux cultivateurs les plus
pauvres.
3,° De quelques Usages particuliers à la haute Egypte.
I l existe beaucoup de différences, ainsi que je l’ai dit, entre les usages du
Sa’yd (5) et ceux de l’Egypte inférieure. Ces différences tiennent en partie au
Sayd même, et au mode d’agriculture que son sol nécessite : mais on doit sur-tout
les attribuer à son éloignement de la capitale, et aux troubles continuels dont il
(r) Un peut voir, dans te S, IV du Mem. de M. Girard moyens les Qobtes ont à leur disposition pour détourner
sur I agriculture et le commerce de la haute Egypte, quels à leur profit une grande partie des revenus de l'Égypte.
(2) S iU . (3) ï jL o . (4) (jçatoü ï p U . (5) o - v e— . É. M. " L I