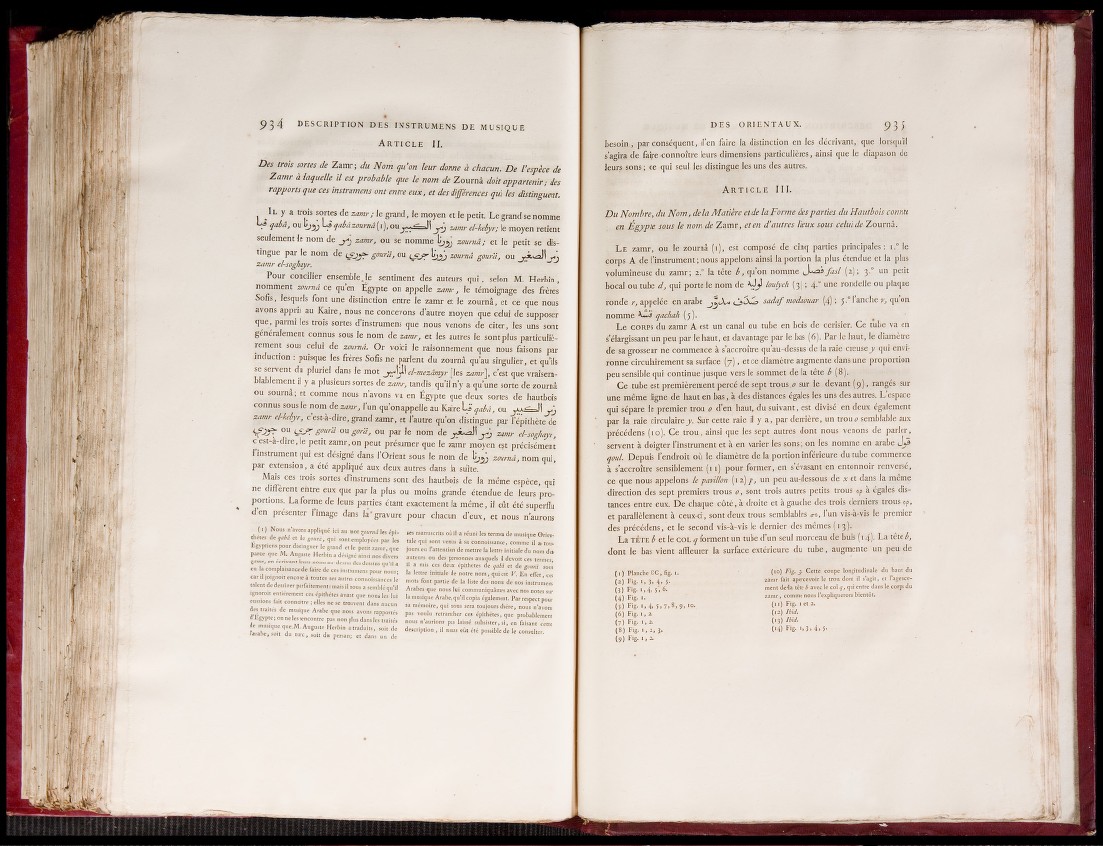
p?
9 3 4 D E S C R I P T I O N d e s i n s t r u m e n s d e m u s i q u e
A r t i c l e II.
D es trois sortes de Zamr; du Nom qu ’on leur donne à chacun. D e l ’espèce de
Zam r à laquelle il est probable que le nom de Zournâ doit appartenir; des
rapports que ces instrumens ont entre eux, et des différences qui les distinguent.
I l y a trois sortes de zamr; le grand, le moyen et le petit. Le grand se nomme
• fl ab‘‘l> ou PHP 4^’ qaba zournâ ( i), o u ^ ^ J I y j zamr el-!ebyr; le moyen retient
seulement le nom de y y zamr, ou se nomme lÿjjj zournâ; et le petit se distingue
par le nom de iSDyfy goura, ou hjyj zounâ goura, ou y ,
zamr el-soglmyr. '
Pour concilier ensemble.le sentiment des auteurs qui, selon M. Herbin,
nomment zournâ ce qu’en Egypte on appelle zamr, le témoignage des frères’
Sofis, lesquels font une distinction entre le zamr et le zournâ, et ce que nous
avons appris au Kaire, nous ne concevons d’autre moyen que celui de supposer
que, parmi les trois sortes d’instrumens que nous venons de citer, les uns sont
généralement connus sous le nom de zamr, et les autres le sont plus particulièrement
sous celui de zournâ. Or voici le raisonnement que nous faisons par
induction : puisque les frères Sofis ne parlent du zournâ qu’au singulier, et qu’ils
se servent du pluriel dans le mot el-mezâmyr [les zamr\, c’est que vraisemblablement
il y a plusieurs sortes de zamr, tandis qu’il n’y a qu’une sorte de zournâ
ou sourna; et comme nous n avons vu en Egypte que deux sortes de hautbois
connus sous le nom de zamr, l’un qu’on appelle au Kaire qabâ, ou
zamr el-lebyr, c’est-à-dire, grand zamr, et l’autre qu’on distingue par 1 epithète de
ou ë our'à ou gord, ou par le nom de joL sJl y j Zamr el-soglmyr,
c est-à-dire, le petit zamr, on peut présumer que le zamr moyen eçt précisément
l’instrument qui est désigné dans l’Orient sous le nom de I j ÿ zournâ, nom qui,
par extension, a été appliqué aux deux autres dans la suite.
Mais ces trois sortes d instrumens sont des'hautbois de la même espèce, qui
ne diffèrent entre eux que par la plus ou moins grande étendue de leurs proportions.
La forme de leurs parties étant exactement la même, il eût été superflu
den présenter limage dans la"gravure pour chacun d’eux, et nous n’aurons
. . , ° US, " aVO"S i PP’iï ue ici ai1 mot fourni les épi- ses manuscrits où il a réuni les ternies de musique Orienti
C ?<I 2 *?• e è0“™ , qui sont employées par les taie qui sont venus à sa connoissance,in itcioamlem due inlo ma. tdoeus- ppaarrGuee gyptiens qquuee pour MM .. AAuugeuussttee istinguer HHeerrbhiinn le grand aa désigné et le ainsi petit n_zam o_s_ d.r,1i:v_ que e_jours eu l’attention de mettre la lettre Zamr4 en écrivant leurs noms au-dessus des dessins qu’il rs a
auteurs ou des personnes auxquels il devoit ces termes
eu la complaisance de faire de ces instrumens pour nous;
il a mis ces deux épithétes de qabâ et de goura sous
car il joignoit encore à toutes ses autres connoissances le
la lettre initiale de notre nom , qui est V. E n effet, ces
talent de dessiner parfaitement: mars il nous a semblé qu’il
mots font partie de la liste des noms de nos instrumens
ignorait entièrement ces épithétes avant que nous les lui
Arabes que nous lui communiquâmes avec nos notes sur
eussions fait connoître ; elles ne se trouvent dans aucun
la musique Arabe, qu’il copia également. Par respect pour
j-c e\n • a l . sa m ém oirme, éqmuoi inreo,uq su isn eorua sts oeurajot ouursjo cuhrèsc reh,e rneo, us n’avonnosus n'avons
d ’EJîgevymptee , oo n neT les“ re’n“"c ontre pas no"n° p“i?n sa Vd°a"nSs lreasp tPr°arit*é"s nPoauss vn°’a”uIuri ornestr apnacsh leari sscée t suépbistihséteter,s ,s iq, ueen pfraoisbaanbtl ecm'eennet
daer ambues,i qsoune qdnue .Mtu.r cA,u gsouistt ed Hu eprebrisna na; treatd udiatns,s suoni, ddee description , il nous eût été possible de le ccoonnssuulltteerr.
D E S O R I E N T A U X . 9 35
besoin , par conséquent, d’en faire la distinction en les décrivant, que lorsqu’il
s’agira de faiye connoître leurs dimensions particulières, ainsi que le diapason de
leurs sons ; ce qui seul les distingue les uns des autres.
Article I I I .
D u Nombre, du N om , de la Matière et de la Forme des parties du Hautbois connu
en Egypte sous le nom de Zamr, et en d ’autres lieux sous celui de Zournâ.
L e zamr, ou le zournâ (1), est composé de cinq parties principales; i.° le
corps A de l’instrument ; nous appelons ainsi la portion la plus étendue et la plus
volumineuse du zamr; z.° la tête b , qu 011 nomme fa s l (2); 3. un petit
bocal ou tube d , qui porte le nom de AJy loulyeh (3) ; 4-° une rondelle ou plaque
ronde r, appelée en arabe jiJJiA. cjèLéô sadaf modaouar (4) ; 5r° 1 anche v, quon
nomme A44 qachah (5).
L e corps du zamr A est un canal ou tube en bois de cerisier. Ce tube va en
s’élargissant un peu par le haut, e.t davantage par le bas (6). Par le haut, le diametre
de sa grosseur ne commence à s’accroître qu’au-dessus de la raie creuse y qui environne
circulairement sa surface (7), et ce diamètre augmente dans une proportion
peu sensible qui continue jusque vers le sommet de la tête b (8).
Ce tube est premièrement percé de sept trous.0 sur le devant (9), rangés sur
une même ligne de haut en bas, à des distances égales les uns des autres. L ’espace
qui sépare le premier trou 0 d’en haut, du suivant, est divise en deux également
par la raie circulaire y. Sur cette raie il y a, par derrière, un trou 0 semblable aux
précédens (10). Ce trou, ainsi que les sept autres dont nous venons de parler,
servent à doigter l’instrument et à en varier les sons ; on les nomme en arabe o ÿ
qoul. Depuis l’endroit où le diamètre de la portion inférieure du tube commence
à s'accroître sensiblement (i i) pour former, en s évasant en entonnoir renverse,
ce que nous appelons le pavillon (i 2) p , un peu au-dessous de x et dans la meme
direction des sept premiers trous 0, sont trois autres petits trous op a égalés distances
entre eux. De chaque cô té ,à droite et agauche des trois derniers trous 0p,
et parallèlement à ceux-ci, sont deux trous semblables 0 -0 ,1 un vis-a-vis le premier
des précédens, et le second vis-à-vis le dernier des memes (13).
La t ê t e b et le c o l q forment un tube d’un seul morceau de buis (14)- L a tete ^
dont le bas vient affleurer la surface extérieure du tube, augmente un peu de
(1 ) Planche C C , fig. i>-
(2 ) Fig. 1, 3 , 4 » 5-
(3) Fig- ‘ . 4. 5Ï 6. (4) Fig. t.
((65)) FFiigg-. 11,, 24.. 5. 7, 8,1
((78 )) FF«igg-. l. >, 22-, 3.
(9 ) Fig. 1 ,2 .
(10) Fig. 3. Cette coupe longitudinale du haut du
zam r fait apercevoir le trou dont il s’agit, et l’agencem
ent de-la tête b avec le col q, qui entre dans le corps du
zam r, comme nous l’expliquerons bientôt.
(11) Fig. 1 et 2.
(12) Ibid, (13) Ibid.
(14) Fig. 1 ,3 , 4 , 5-