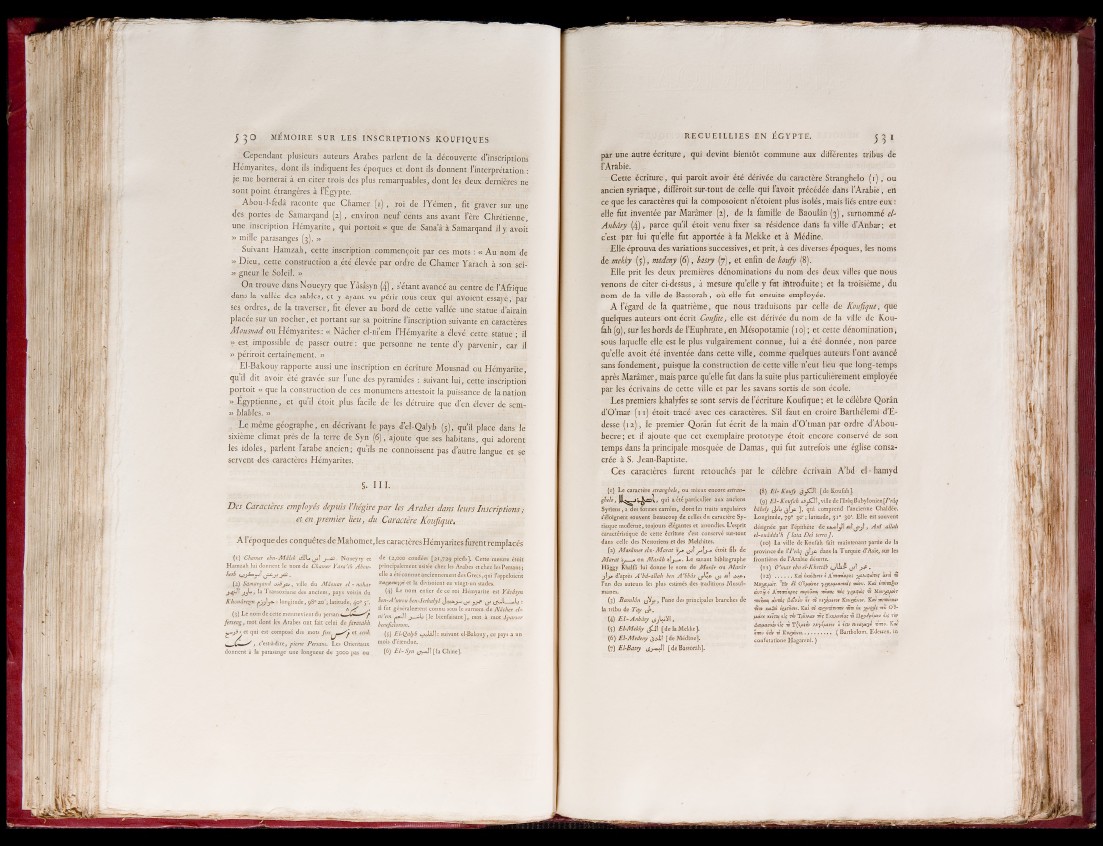
Cependant plusieurs auteurs Arabes parlent de la découverte d’inscriptions
Hémyarites, dont ils indiquent les époques et dont ils donnent l’interprétation :
je me bornerai à en citer trois des plus remarquables., dont les deux dernières ne
sont point étrangères à l’Egypte.
Abou-l-fedâ raconte que Chaîner (i) , roi de .l’Yémen, fit graver sur une
des portes de Samarqand (2), environ neuf cents ans avant l’ère Chrétienne,
une. inscription Hémyarite, qui portoit « que de Sana’â à Samarqand il y. avoit
» mille parasanges (3). » ,
Suivant Hamzah, cette inscription commençoit par ces mots : «A u nom de
» Dieu, cette construction a ,été élevée par ordre de Chaîner Yarac-h à son sei-
b gneur le. Soleil. »
On trouve dans Noueyry que Yâsàsyn (4), s’étant avancé au centre de l’Afrique
dans la vallée des sables, et y ayant vu périr tous ceux qui avoient essayé, par
ses ordres,.de la traverser, fit elever au bord de cette vallée une statue d’airain
placée sur un rocher, et portant sur sa poitrine 1 inscription suivante en caractères
Mousnad. ou Hémyarites: « Nâcher el-ni’em l’Hémyarite a élevé cette statue ; il
b est impossible de passer outre: que personne ne tente d’y parvenir, car il
b périroit certainement. »
El-Bakouy rapporte aussi une inscription en écriture Mousnad ou Hémyarite,
quil dit avoir ete gravee sur lune des pyramides : suivant lui, cette inscription
portoit « que la construction de ces monumens attestoit la puissance de la nation
».Égyptienne, et qu’il étoit.plus facile de les détruire que d’en élever de sem-
» blables. »
, Le même géographe, en décrivant le pays d’el-Qalyh (5), qu’il place dans le
sixième climat près de la terre de Syn (6), ajoute que ses habitans, qui adorent
les idoles, parlent l’arabe ancien; qu’ils ne connoissent pas d’autre langue et se
servent des caractères Hémyarites.
§. III .
Des Caractères employés depuis l’hégire par les Arabes dans leurs Inscriptions ;
et en premier lieu, du Caractère Koufique.
j
A l’époque des conquêtes de Mahomet.
(1) Chanter ebn- Mâlek ufUL* aS. Noueyry et
Hamzah lui donnent le nom de Chamer kerb Yara’ch Abou- c_i_y.fr->«-; 1 ysü .
(2) Samarqand oJλjo», ville, du Mâouar el - nahar
jjL>, la Transoxiane des anciens, pays voisin du Khouâre^m çjyj*- ■ longitude, 98°20'; latitude, 4o° 5'.
(3) Le nom de cette mesure vient du p e rsa n ^ / I H I ferseng, mot dont les Arabes ont fait celui de farasakh
et qui est composé des mots fe r s et senk
U s , c’est-à-dire, pierre Persane. Les Orientaux
donnent à la parasange une longueur de 3000 pas ou
les caractères Hémyarites furent remplacés
de 12,000 coudées [21,729 pieds]. Cette mesure étoit
principalement usitée chez les Arabes et chez les Persans;
■elrlea &ai oéatéyp cjonnue anciennement des Grecs, qui Pappeloient ét la divisoient en vingt-un stades.
ben(4-A) ’iLner onùobmen -Seenrthiearb ydle ce roi Hémyarite est Yâsâsyn Jaao.y*. ^ ,jV= ^ :
inl i’feumt généralement connu sous le surnom de Nâcher el- benefic ioTum.j —il» [le bienfaisant], mot. à mot Sparsor
(5) El-Qalyb <_*Uk!I : suivant el-Bakouy, ce pays a un
mois d’étendue.
(6) El-Syn [la Chine].
par une autre écriture, qui devint bientôt commune aux différentes tribus de
l’Arabie.
Cette écriture, qui paroît avoir été dérivée du caractère Stranghelo (i) , ou
ancien syriaque, différoitsur-tout de celle qui l’avoit précédée dans l’Arabie, en
ce que les caractères qui la composoient n’étoient plus isolés, mais liés entre eux :
elle fut inventée par Marâmer (2), de la famille de Baoul.în (3), surnommé el-
Anbâry (4), parce qu’il étoit venu fixer sa résidence datls la ville d’Anbar ; et
c’est par lui qu’elle fut apportée à la Mekke et à Médine.
Elle éprouva des variations successives, et prit, à ces diverses époques, les noms
de mtkky (5), medeny (6), basry (7), et enfin de koufy (8).
Elle prit les deux premières dénominations du nom des deux villes que nous
venons de citer ci-dessus, à mesure qu’elle y fut introduite ; et la troisième, du
nom de la ville de Bassorah, où elle fut ensuite employée.
A l’égard de la quatrième, que nous traduisons par celle de Koufique, que
quelques auteurs ont écrit Confite, elle est dérivée du nom de la ville de Koufah
(9), sur les bords de l’Euphrate, en Mésopotamie (10) ; et cette dénomination,
sous laquelle elle est le plus vulgairement connue, lui a été donnée, non parce
qu’elle avoit été inventée dans cette ville, comme quelques auteurs l’ont avancé
sans fondement, puisque la construction de cette ville n’eut lieu que long-temps
après Marâmer, mais parce qu’elle fut dans la suite plus particulièrement employée
par les écrivains de cette ville et par les savans sortis de son école.
Les premiers khalyfes se sont servis de l’écriture Koufique ; et le célèbre Qorân
d’O’mar (u ) étoit tracé avec ces caractères. S’il faut en croire Barthélemi d’É-
desse (12), le premier Qorân fut écrit de la main d’O ’tman par ordre d’Abou-
becre ; et il ajoute que cet exemplaire prototype étoit encore conservé de son
temps dans la principale mosquée de Damas, qui fut autrefois une église consacrée
à S. Jean-Baptiste.
Ces caractères furent retouchés par le célèbre écrivain A’bd el - hamyd
ghe(1lo), Le caractère stranghelo, ou mieux encore estran- , qui a'été particulier aux anciens
Syriens, a des formes carrées, dont les traits angulaires
s’éloignent souvent beaucoup de celles du caractère Syriaque
moderne, toujours élégantes et arrondies. L’esprit
caractéristique de cette écriture s’est conservé sur-tout
dans celle des Nestoriens et des Melchites.
(2) Marâmer ebn-Mar at ÿ* étoit fils de Marat y -» ou Marâh »1j •. Le savant bibliographe
Hj\âj>ggy Khalfii lui donne le nom de Morâr ou Marâr d’après A’bd-allah ben A’bbâs q j a»Î o-**»
l’iln des auteurs les plus estimés des traditions Musulmanes.
(3) Baoulân , l’une des principales branches de
la tribu de Tay ,
' (4) El-Anbâry <_SjLjY[,
(ç) El-Mekhy [de la Mekke].
(6) El-Medeny ¿o-lf [de Médine].
(7) El-Basry [de Bassorah].
(8) El-Koufy [de Koufah].
bâb(9el)y El-Koufah fcjjJCJÎ, ville de l’Iraq Babylonien [I’râq ¿ib* ]> comprend l’ancienne Chaldée.
Longitude, 790 30'; latitude, 310 30'. Elle est souvent
edlé-osiugândéde a’pha r[ Ila’étpai tDhèetel tedrera * J*.^>ljJt w tjs jt, Ard allah
(10) La ville de Koufah fait maintenant partie de la
province de Yl’r.aq ^ b * dans la Turquie d’Asie, sur les
frontières de l’Arabie déserte.
(11) O’mar ebn el-Khettâb
(12) Ko} îkclSîoïy 0 A’mznKfnç %LXttpot.wiç cu/tt w
MxytyiitT. ’Hk S i O’0(Mzu'iif yçyjupMTitdç tttutv. Keu cmlvtTîïtoj)a 0f àAw’mmmç x(hptnCçxl otvm tpvtu orna i xinytpu/mUYç omvç y&upciç w Mov%tp*T Kot/gjtyioy. Kai onmiwuv
pTuV7tvBv Kttÿtt ¿hwoîy. Kcù 7» imçÿo'jp'jvmv wn a1 ^/gpV tju O 0- xmzq tiç 7»V TpSMttf 7«f E’wcAhotoî 75 TlçytyofMv îiç rur AapUMMV tiçornu tçiy 7D Xtyo\uayoy 0 içlv tjvvayayn Ka< 7® Kv&cy/or. .............. ( Bartholom. Edessen. in
confutatione Hagareni. )