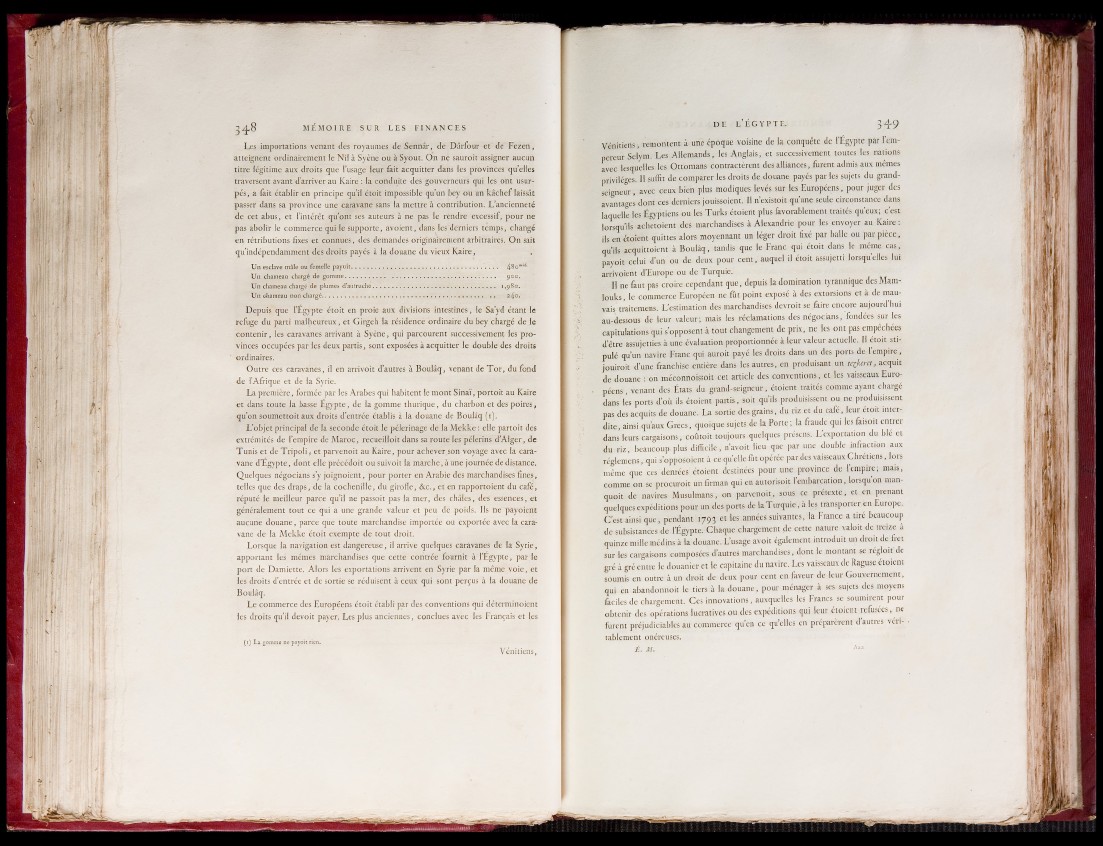
Les importations venant des royaumes de Sennâr, de Dârfour et de Fezen,
atteignent ordinairement le Nil à Syène ou à Syout. On ne sauroit assigner aucun
titre légitime aux droits que l’usage leur fait acquitter dans les provinces qu’elles
traversent avant d’arriver au Kaire : la conduite des gouverneurs qui les ont usurpés,
a fait établir en principe qu’il étoit impossible qu’un bey ou un kâchef laissât
passer dans sa province une caravane sans la mettre à contribution. L’ancienneté
de cet abus, et l’intérêt qu’ont ses auteurs à ne pas le rendre excessif, pour ne
pas abolir le commerce qui le supporte, avoient, dans les derniers temps, changé
en rétributions fixes et connues, des demandes originairement arbitraires. On sait
qu’indépendamment des droits payés à la douane du vieux Kaire,
U n esclave mâle ou femelle payoit.................................................................................. . . . . . . 4 8 omti‘
U n chameau chargé de gomme................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 900.
Un chameau chargé de plumes d’autruche................................................................................... 1,980.
U n chameau non ch argé . ................................ . . . . . . 7 7 . . . . . . . . . . . . . 24 °-
Depuis que l’Egypte étoit en proie aux divisions intestines, le Sa’yd étant le
refuge du parti malheureux, et Girgeh la résidence ordinaire du bey chargé de le
contenir, les caravanes arrivant à Syène, qui parcourent successivement les provinces
occupées par les deux partis, sont exposées à acquitter le double des droits
ordinaires.
Outre ces caravanes, il en arrivoit d’autres à Boulâq, venant de T or, du fond
de l’Afrique et de la Syrie.
La première, formée par les Arabes qui habitent le mont Sinaï, portoit au Kaire
et dans toute la basse Egypte, de la gomme thurique, du charbon et des poires,
qu’on soumettoit aux droits d’entrée établis à la douane de Boulâq (i).
L’objet principal de la seconde étoit le pèlerinage de la Mekke : elle partoit des
extrémités de l’empire de Maroc, recueilloit dans sa route les pèlerins d’Alger, de
Tunis et de Tripolis et parvenoit au Kaire, pour achever.son voyage avec la caravane
d’Egypte, dont elle précédoit ou suivoit la marche,à une journée de distancé.
Quelques négocians s’y joignoient, pour porter en Arabie des marchandises fines,
telles que des draps, de la cochenille, du girofle, &c., et en rapportoient du café,
réputé le meilleur parce qu’il ne passoit pas la mer, des châles, des essences, et
généralement tout ce qui a une grande valeur et peu de poids. Ils ne payoient
aucune douane, parce que toute marchandise importée ou exportée avec la caravane
de la Mekke étoit exempte de tout droit.
Lorsque la navigation est dangereuse, il arrive quelques caravanes de la Syrie,
apportant les mêmes marchandises que cette contrée fournit à l’Egypte, par le
port de Damiette. Alors les exportations arrivent en Syrie par la même voie, et
les droits d’entrée et de sortie se réduisent à ceux qui sont perçus à la douane de
Boulâq.
Le commerce des Européens étoit établi par des conventions qui déterminoient
les droits qu’il devoit payer. Les plus anciennes, conclues avec les Français et les
(') 1 gOlt s payoit r
Vénitiens,
Vénitiens, remontent à une époque voisine de la conquête de l’Egypte par l’empereur
Selym. Les Allemands, les Anglais, et successivement toutes les nations
avec lesquelles les Ottomans contractèrent des alliances, furent admis aux mêmes
privilèges. Il suffit de comparer les droits de douane payés par les sujets du grand-
seigneur , avec ceux bien plus modiques levés sur les Européens, pour juger des
avantages dont ces derniers jouissoient. Il n’existoit qu’une seule circonstance dans
laquelle les Égyptiens ou les Turks étoient plus favorablement traites queux; cest
lorsqu’ils achetoient des marchandises à Alexandrie pour les envoyer au Kaire :
ils en étoient quittes alors moyennant un léger droit fixé par balle ou par pièce,
qu’ils acquittoient à Boulâq, tandis que le Franc qui étoit dans le même cas,
payoit celui d’un ou de deux pour cent, auquel il étoit assujetti lorsqu’elles lui
arrivoient d’Europe ou de Turquie.
Il ne faut pas croire cependant que, depuis la domination tyrannique des Mam-
louks, le commerce Européen ne fût point exposé à des extorsions et à de mauvais
traitemens. L’estimation des marchandises devroit se faire encore aujourd’hui
au-dessous de leur valeur; mais les réclamations des négocians, fondées sur les
capitulations qui s’opposent à tout changement de prix, ne les ont pas empêchées
d’être assujetties à une évaluation proportionnée à leur valeur actuelle. Il étoit stipulé
qu’un navire Franc qui auroit payé les droits dans un des ports de Iempire,
jouiroit d’une franchise entière dans les autres, en produisant un teZh n t, acquit
de douane ; on méconnoissoit cet article des conventions, et les vaisseaux Européens
, venant des États du grand-seigneur, étoient traités comme ayant chargé
dans les ports d’où ils étoient partis, soit qu’ils produisissent ou ne produisissent
pas des acquits de douane. La sortie des grains, du riz et du café, leur étoit interdite,
ainsi qu’aux Grecs, quoique sujets de la Porte ; la fraude qui les faisoit entrer
dans leurs cargaisons, coûtoit toujours quelques présens. L’exportation du ble et
du riz, beaucoup.plus difficile, n’avoit lieu que par une double infraction aux
réglemens, qui s’opposoient à ce qu’elle fût opérée par des vaisseaux Chrétiens, lors
même que ces denrées étoient destinées pour une province de 1 empire; mais,
comme on se procuroit un firman qui en autorisoit l’embarcation, lorsquon man-
quoit de navires Musulmans, on parvenoit, sous ce prétexte, et en prenant
quelques expéditions pour un des ports de la Turquie, à les transporter en Europe.
C ’est ainsi que, pendant 1793 et les années suivantes, la France a tiré beaucoup
de subsistances de l’Egypte. Chaque chargement de cette nature valoit de treize à
quinze mille médins à la douane. L’usage avoit également introduit un droit de fret
sur les cargaisons composées d’autres marchandises, dont le montant se région de
gré à gré entre le douanier et le capitaine du navire. Les vaisseaux de Raguse étoient
soumis en outre à un droit de deux pour cent en faveur de leur Gouvernement,
qui en abandonnoit le tiers à la douane, pour ménager à ses sujets des moyens
faciles de chargement. Ces innovations, auxquelles les Francs se soumirent pour
obtenir des opérations lucratives ou des expéditions qui leur étoient refusees, ne
furent préjudiciables au commerce qu’en ce qu’elles en préparèrent d autres véritablement
onéreuses.
1 M.