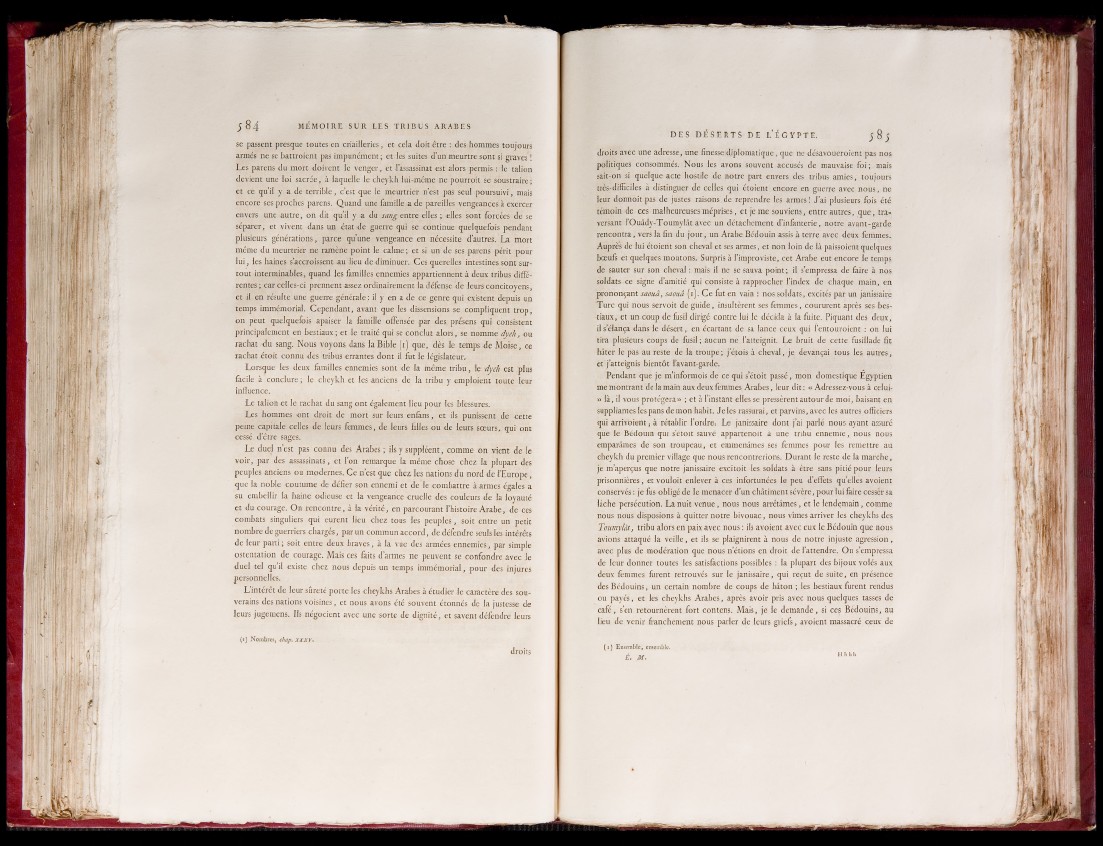
se passent presque toutes en criailleries, et cela doit être : des hommes toujours
armés ne se hattroient pas impunément; et les suites d’un meurtre sont si graves !
Les parens du mort doivent le venger, et l’assassinat est alors permis : le talion
devient une loi sacrée, à laquelle le cheykh lui-meme ne pourrait se soustraire;
et ce qu’il y a de terrible, c’est que le meurtrier n’est pas seul poursuivi, mais
encore ses proches parens. Quand une famille a de pareilles vengeances à exercer
envers une autre, on dit qu’il y a du sang entre elles ; elles sont forcées de se
séparer, et vivent dans un état de guerre qui se continue quelquefois pendant
plusieurs générations, parce qu’une vengeance en nécessite d’autres. La mort
même du meurtrier ne ramène point le calme; et si un de ses parens périt pour
lui, les haines s’accroissent au lieu de diminuer. Ces querelles intestines sont surtout
interminables, quand les familles ennemies appartiennent à deux tribus différentes;
car celles-ci prennent assez ordinairement la défense de leurs concitoyens,
et il en résulte une guerre générale ; il y en a de ce genre qui existent depuis un
temps immémorial. Cependant, avant que les dissensions se compliquent trop,
on peut quelquefois apaiser la famille offensée par des présens qui consistent
principalement en bestiaux; et Je traité qui se conclut alors, se nomme dyeh, ou
rachat -du sang. Nous voyons dans la Bible (i) que, dès le temps de Moïse, ce
rachat étoit connu des tribus errantes dont il fut Je législateur.
Lorsque les deux familles ennemies sont de la même tribu, le dyeli est plus
facile à conclure ; le cheykh et les anciens de la tribu y emploient toute leur
influence.
Le talion et le rachat du sang ont également lieu pour les blessures.
Les hommes ont droit de mort sur leurs enfàns, et ils punissent de cette
peine capitale celles de leurs femmes, de leurs filles ou de leurs soeurs, qui ont
cessé, d’être sages.
Le duel n’est pas connu des Arabes ; ils y suppléent, comme on vient de le
voir, par des assassinats, et l’on remarque la même chose chez la plupart des
peuples anciens ou modernes. Ce n’est que chez les nations du nord de l’Europe,
que la noble coutume de défier son ennemi et de le combattre à armes égales a
su embellir la haine odieuse et la vengeance cruelle des couleurs de la loyauté
et du courage. On rencontre, à la vérité, en parcourant l’histoire Arabe, de ces
combats singuliers qui eurent lieu chez tous les peuples , soit entre un petit
nombre de guerriers charges, par un commun accord, de défendre seuls les intérêts
de leur parti; soit entre deux braves, à la vue des années ennemies, par simple
ostentation de courage. Mais ces faits d’armes ne peuvent se confondre avec le
duel tel qu’il existe chez nous depuis un temps immémorial, pour des injures
personnelles.
L’intérêt de leur sûreté porte les cheykhs Arabes à étudier le caractère des souverains
des nations voisines, et nous avons été souvent étonnés de la justesse de
leurs jugemens. Ils négocient avec une sorte de dignité, et savent défendre leurs
{•i) Nombres, chap. x x x v »
droits
droits avec une adresse, une finesse.tçfiplomatique, que ne désavoueroient pas nos
politiques consommés. Nous les avons souvent accusés de mauvaise foi; mais
sait-on si quelque acte hostile de notre part envers des tribus amies, toujours
très-difficiles à distinguer de celles qui étoient encore en guerre avec nous, ne
leur donnoit pas de justes raisons de reprendre les armes ! J’ai plusieurs fois été
témoin de ces malheureuses méprises, et je me souviens, entre autres, que, traversant
l’Ouâdy-Toumylât avec un détachement d’infanterie, notre avant-garde
rencontra, vers la fin du jour, un Arabe Bédouin assis à terre avec deux femmes.
Auprès de lui étoient son cheval et ses armes, et non loin de là paissoient quelques
boeufs et quelques moutons. Surpris à l’improviste, cet Arabe eut encore le temps
de sauter sur son cheval : mais il ne se sauva point; il s’empressa de faire à nos
soldats ce signe d’amitié qui consiste à rapprocher l’index de chaque main, en
prononçant saonâ, saouâ (i). Ce fut en vain : nos soldats, excités par un janissaire
Turc qui nous servoit de guide, insultèrent ses femmes, coururent après ses bestiaux,
et un coup de fusil dirigé contre lui le décida à la fuite. Piquant des deux,
il s’élança dans le désert, en écartant de sa lance ceux qui l’entouroient : on lui
tira plusieurs coups de fusil ; aucun ne l’atteignit. Le bruit de cette fusillade fit
hâter le pas au reste de la troupe; j’étois à cheval, je devançai tous les autres,
et j’atteignis bientôt l’avant-garde.
Pendant que je m’informois de ce qui s’étoit passé, mon domestique Egyptien
me montrant de la main aux deux femmes Arabes, leur dit : « Adressez-vous à celui-
» là, il vous protégera» ; et à l’instant elles se pressèrent autour de moi, baisant en
suppliantes les pans de mon habit. Je les rassurai, et parvins, avec les autres officiers
qui arrivaient, à rétablir l’ordre. Le janissaire dont j’ai parlé nous ayant assuré
que le Bédouin qui s’étoit sauvé appartenoit à une tribu ennemie, nous nous
emparâmes de son troupeau, et emmenâmes ses femmes pour les remettre au
cheykh du premier village que nous rencontrerions. Durant le reste de la marche,
je m’aperçus que notre janissaire excitoit les soldats à être sans pitié pour leurs
prisonnières, et vouloit enlever à ces infortunées le peu d’effets qu’elles avoient
conservés : je fus obligé de le menacer d’un châtiment sévère, pour lui faire cesser sa
lâche persécution. La nuit venue, nous nous arrêtâmes, et le lendemain, comme
nous nous disposions à quitter notre bivouac, nous vîmes arriver les cheykhs des
Toumylât, tribu alors en paix avec nous : ils avoient avec eux le Bédouin que nous
avions attaqué la veille, et ils se plaignirent à nous de notre injuste agression,
avec plus de modération que nous n’étions en droit de l’attendre. On s’empressa
de leur donner toutes les satisfactions possibles : la plupart des bijoux volés aux
deux femmes furent retrouvés sur le janissaire, qui reçut de suite, en présence
des Bédouins, un certain nombre de coups de bâton ; les bestiaux furent rendus
ou payés, et les cheykhs Arabes, après avoir pris avec nous quelques tasses de
café, s’en retournèrent fort contens. Mais, je le demande, si ces Bédouins, au
lieu de venir franchement nous parler de leurs griefs, avoient massacré ceux de
( i ) Ensemble, ensemble.
É. M. H h h h