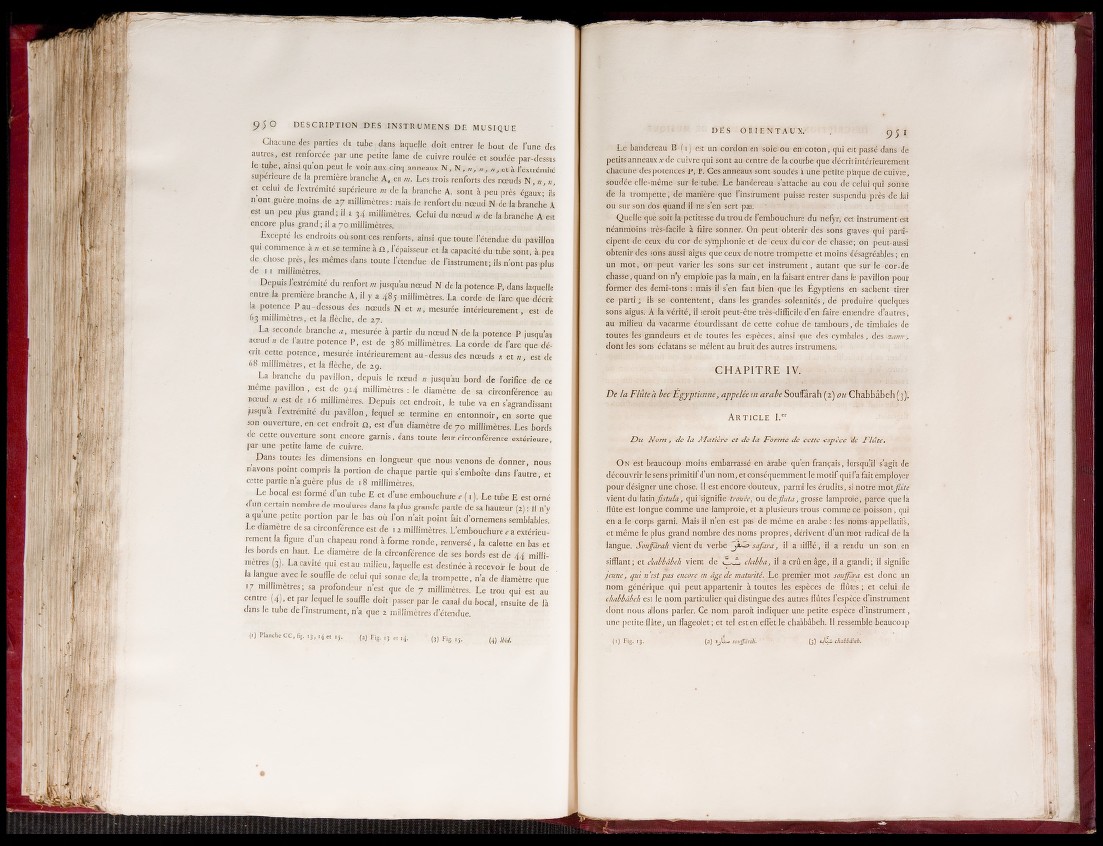
Chacune des parties du tube dans laquelle doit entrer le bout de l’une des
autres, est renforcée par une petite lame de cuivre roulée et soudée par-dessus
le tube, ainsi quon peut le voir aux cinq anneaux N , N , n ,n , n, et à l’extrémité
supérieure de la première branche A, en m. Les trois renforts des noeuds N , n, n,
et celui de 1 extrémité supérieure m de la branche A, sont à peu près égaux; ils
n’ont guère moins de 27 millimètres: mais le renfort du noeud N de la branche A
est un peu plus grand; il a 34 millimètres. Celui du noeud « de la branche A est
encore plus grand ; il a 70 millimètres.
Excepté les endroits où sont ces renforts, ainsi que toute l’étendue du pavillon
qui commence à n et se termine à D , l’épaisseur et là capacité du tube sont, à peu
de chose près, les mêmes dans toute l’étendue de l’instrument; ils n’ont pas plus
de 1 1 millhirètres.
Depuis i extrémité du renfort m jusqu’au noeud N de la potence P, dans laquelle
entre la première branche A, il y a 48y millimètres. La corde de l’arc que décrit
la potence P au-dessous des noeuds N et n, mesurée intérieurement, est de
63 millimètres, et la flèche, de 27.
La seconde branche a, mesurée à partir du noeud N de la potence P jusqu’au
noeud n de l’autre potence P , est de 386 millimètres. La corde de l’arc que décrit
cette potence, mesurée intérieurement au-dessus des noeuds n et n, est de
68 millimètres, et la flèche, de 29.
La branche du pavillon, depuis le noeud n jusqu’au bord de l’orifice de ce
même pavillon , est de 924 millimètres : le diamètre de sa circonférence au
noeud« est de 16 millimètres. Depuis cet endroit, le tube va en s’agrandissant
jusqu’à l’extrémité du pavillon, lequel se termine en entonnoir, en sorte que
son ouverture, en cet endroit a , est d’un diamètre de 70 millimètres. Les bords
de cette ouverture sont encore garnis, dans toute leur circonférence extérieure,
par une petite lame de cuivre.
^ Dans toutes les dimensions en longueur que nous venons de donner, nous
n avons point compris la portion de chaque partie qui s’emboîte dans l’autre, et
cette partie n a guère plus de 18 millimètres.
^ Le bocal est formé d un tube E et d’une embouchure e ( 1 ). Le tube E est orné
d un certain nombre de moulures dans la plus grande partie de sa hauteur (2).: il n’y
a qu une petite portion par le bas où l’on n’ait point fait d’ornemens semblables.
Le diamètre de sa circonférence est de 12 millimètres. L ’embouchure e a extérieurement
la figure d’un chapeau rond à forme ronde, renversé, la calotte en bas et
les bords en haut. Le diamètre de la circonférence de ses bords est de 44 millimètres
(3). La cavité qui est au milieu, laquelle est destinée à recevoir le bout de
la langue avec le souffle de celui qui sonne de;la trompette, n’a de diamètre que
17 millimètres; sa profondeur n’est que de 7 millimètres. Le trou qui est au
centre (4), et par lequel le souffle doit passer par le canal du bocal, ensuite de là
dans le tube de l’instrument, n’a que 2 millimètres detendue.
(1) Planche CC, fig. .3 , ,4 « i j . (a) Fig. ,3 e. .4. ' (3) Fig. , 5. (4) Ibid.
Le bandereau B- ( 1 ) est un cordon en soie-ou en-coton, qui est passé dans de
petits anneaux x de cuivre qui sont au centre de la courbe que décrit intérieurement
chacune des potences P, P. Ces anneaux sont soudés à une petite plaque de cuivre,
soudée elle-même sur le tube. Le bandereau s’attache au cou de celui qui sonne
dé la trompette; de manière que l'instrument puisse rester suspendu près de Jui
ou sur son dos quand il ne s’en sert pas.
Quelle que soit la petitesse du trou de l’embouchure du nefyr, cet instrument est
néanmoins très-facile à faire sonner. On peut obtenir des sons graves qui participent
de ceux du cor de symphonie et de ceux du cor de chasse ; on peut-aussi
obtenir des sons aussi aigus que ceux de notre trompette et moins désagréables ; en
un mot, on peut varier les sons sur cet instrument, autant que sur le cor.de
chasse, quand on n y emploie pas la main, en la faisant entrer dans le pavillon pour
former des demi-tons : mais il s’en faut bien que les Égyptiens en sachent tirer
ce parti; ils se contentent, dans les grandes:solennités, de produire quelques
sons aigus. A la vérité, il seroit peut-être très-difficile d’en faire entendre d’autres,
au milieu du vacarme étourdissant de cette cohue de tambours, de timbales de
toutes les grandeurs et de toutes les espèces, ainsi que des cymbales, des zamr ,
doùt les sons éclatans se mêlent au bruit des autres instrumens.
C H A P I T R E IV .
De la Flûte a bec Egyptienne, appelée en arabe Souffârah (2) on Chabbâbeh (3 ).
A r t i c l e I . "
D u N om , de la Matière et de la Forme de cette espèce de Flûte.
O n est beaucoup moins embarrassé en arabe qu’en français, lorsqujl s’agit de
découvrir le sens primitif d’un nom, et conséquemment le motif qui l’a fait employer
pour désigner une chose. Il est encore douteux, parmi les érudits, si notre m otfûte
vient du latin fistula, qui signifie troiiée, ou d e fu ta , grosse lamproie, parce que la
flûte est longue comme une lamproie, et à plusieurs trous comme ce poisson, qui
en a le corps garni. Mais il n’en est pas de même en arabe : les noms âppellatifs,
et même le plus grand nombre des noms propres, dérivent d’un mot radical de la
langue. Sonffàrah vient du verbe fyiEb sa.fa.ra, il a sifflé, il a rendu un son. en
sifflant; et chabbâbeh vient de é L j l chabba, il a crû en âge, il a grandi; il signifie
jeune, qui n’est pas encore en âge de maturité. Le premier mot souffâra est donc un
nom générique qui peut appartenir à toutes les espèces de flûtes ; et celui de
chabbâbeh est le nom particulier qui distingue des autres flûtes l’espèce d’instrument
dont nous allons parler. Ce nom paroît indiquer une petite espèce d’instrument,
une petite flûte, un flageolet ; et tel esLen effet le chabbâbeh. Il ressemble beaucoup