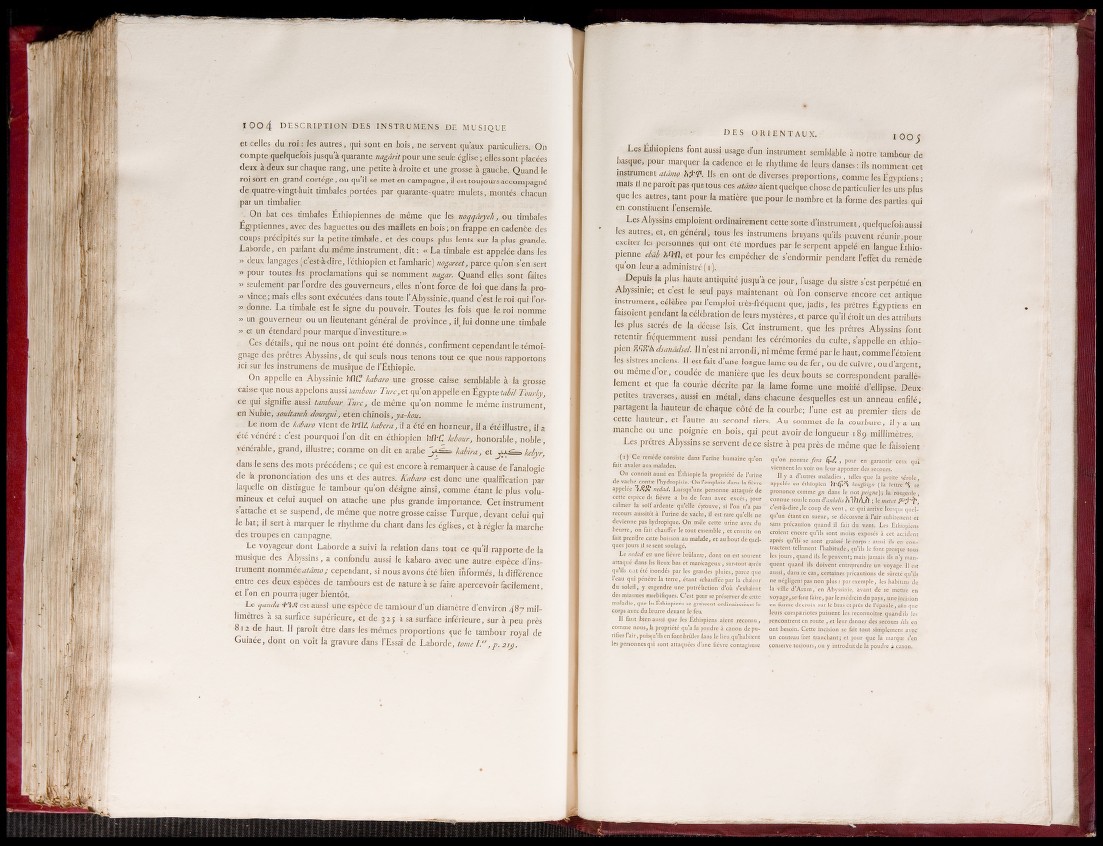
I QÇ>4 D E S C R I P T I O N D E S I N S T R U M E N S D E M U S I Q U E
et celles .du roi : les autres, cjui sont en bois, ne servent cju'aux particuliers. On
compte quelquefois jusqua quarante nagârh pour une seule église ; elles sont placées
deux à deux sur chaque rang, une petite à droite et une grosse à gauche. Quand le
roi sort en grand cortège, ou qu’il se met en campagne, il est toujours accompagné
de quatre-vingt-huit timbales portées par quarante-quatre mulets, montés chacun
par un timbalier.
On bat ces timbales Ethiopiennes .de même que les noqqâryeli, ou timbales
Egyptiennes, avec des baguettes ou des maillets en bois ; on frappe en cadenie des
coups précipités sur la petite timbale, et des coups plus lents sur la plus grande.
Laborde, en parlant du même instrument, dit: « L a timbale est appelée dans les
» deux langages (c’est-à-dire, l’éthiopien et l’amharic) nogareet, parce qu’on s’en sert
» pour toutes les proclamations qui se nomment nagar. Quand elles sont faites
» seulement par l’ordre des gouverneurs, elles n’ont force de loi que dans la pro-
» vince; mais elles sont exécutées dans toute l’Abyssinie, quand c’est le roi qui i’or-
» donne. La timbale est le signe du pouvoir. Toutes les fois que le roi nomme
» un gouverneur ou un lieutenant général de province, il. lui donne une timbale
» et un étendard pour marque d ’investiture. »
Ces détails, qui ne nous ont point été donnés, confirment cependant le témoignage
des prêtres Abyssins, de qui seuls nous tenons tout ce que nous rapportons
ici sur les instrumens de musique de l’Éthiopie.
On appelle en Abyssinie hflC kabaro une grosse caisse semblable à la grosse
caisse que nous appelons aussi tambour Turc, et qu’on appelle en Egypte tabd Tourly,
ce qui signifie aussi tambour. Turc, de même qu’on nomme le même instrument
en Nubie, soultaneh dourgui, et en chinois, ya-kou.
L e nom de kabaro vient de h i l l kabera, il a été en honneur, il a été illustre, il a
été vénéré : c’est pourquoi l’on dit en éthiopien htbC kebour, honorable, noble,
vénérable, grand, illustre; comme on dit en arabe kabira, et kelyr,
dans le sens des mots précédens ; ce qui est encore à remarquer à cause de l’analo gie
de la prononciation des uns et des autres. Kabaro est donc une qualification par
laquelle on distingue le tambour qu’on désigne ainsi, comme étant le plus volumineux
et celui auquel on attache une plus grande importance. Cet instrument
s attache et se suspend, de même que notre grosse caisse Turque, devant celui qui
le bat; il sert à marquer le rhythme du chant dans les églises, et à régler la marche
des troupes en campagne.
L e voyageur dont Laborde a suivi la relation dans tout ce qu’il rapporte de la
musique des Abyssins, a confondu aussi le kabaro avec une autre espèce d’instrument
nommée atâmo; cependant, si nous avons été bien informés, la différence
entre ces deux espèces de tambours est de nature à se faire apercevoir facilement,
et 1 on en pourra juger bientôt.
L e qanda est aussi une espèce de tambour d’un diamètre d’environ 487 millimètres
à sa surface supérieure, et de 325 à sa surface inférieure, sur à peu près
8 1 2 de haut. Il paroit être dans les mêmes proportions que le tambour royal de
Guinée, dont on voit la gravure dans l’Essai de Laborde, tome / ." , p . 2 iy .
Les Éthiopiens font aussi usage d’un instrument semblable à notre tambour de
basque, pour marquer la cadence et le rhythme de leurs danses: ils nomment cet
instrument atâmo W P , Iis en ont de diverses proportions, comme les Égyptiens ;
mais il ne paroît pas que tous ces atâmo aient quelque chose de particulier les uns plus
que les autres, tant pour la matière que pour le nombre et la forme des parties qui
en constituent l’ensemble.
Les Abyssins emploient ordinairement cette sorte d’instrument, quelquefois aussi
les autres, et, en général, tous les instrumens bruyans qu’ils peuvent réunir,pour
exciter les personnes qui ont été mordues par le serpent appelé en langue Éthiopienne
ebâb m il, et pour les empêcher de s’endormir pendant l’effet du remède
qu’on leur a administré ( I ).
Depuis la plus haute antiquité jusqu’à ce jour, l’usage du sistre s’est perpétué en
Abyssinie ; et c est le seul pays maintenant où l’on conserve encore cet antique
instrument, célèbre pari emploi très-fréquent que, jadis, les prêtres Égyptiens en
faisoient pendant la célébration de leurs mystères, et parce qu’il étoit un des attributs
les plus sacrés de la déesse Isis. Cet instrument, que les prêtres Abyssins font
retentir fréquemment aussi pendant les cérémonies du culte, s’appelle en éthiopien
SWA dsanâdscl. Il n’est ni arrondi, ni même fermé par le haut, commel etoient
les sistres anciens. Il est fait d’une longue lame ou de fer, ou de cuivre, ou d’argent,
ou même d o r, coudée de manière que les deux bouts se correspondent parallèlement
et que la courbe décrite par la lame forme une moitié d’ellipse. Deux
petites traverses, aussi en métal, dans chacune desquelles est un anneau enfilé,
partagent la hauteur de chaque côté de la courbe; l’une est au premier tiers de
cette hauteur, et 1 autre au second tiers. A u sommet de la courbure, il y a un
manche ou une poignée en bois, qui peut avoir de longueur 189 millimètres.
Les pretres Abyssins se servent de ce sistre à peu près de même que le faisoient
fai(t 1a )v aCleer areumx èmdea lacdoenss.iste dans l’urine hum aine qu’on
O n connoit aussi en Ethiopie la propriété de l’urine
de vache contre l’hydropisie. O n l’emploie dans la fièvre
acpeptteel éees pèce de nfçidèavdre. Lao rbsuq ud’uen el’ epauer saovnence eaxttcaèqsu, épeo duer
calmer la soif ardente qu’elle épfouve, si l’on n’a pas
recours aussitôt à l’urine de vache, il est rare qu’elle ne
devienne pas hydropique. O n mêle cette urine avec du
beurre, on fait chauffer le tout ensem ble, et ensuite on
fait prendre .cette boisson au m alade, et au bout de quelques
jours il se sent soulagé.
Le hedad est une fièvre brûlante, dont on est s.ouvent
attaqué dans les lieux bas et m arécageux, sur-tout après
qu’ils w t été inondés par les grandes pluies, parce que
l’eau qui pénètre la terre, .étant échauffée par la chaleur
du soleil, -y engendre une putréfaction d’où s’exhalent
des miasmes morbifiques. C ’est pour se préserver de cette
m aladie, que les Éthiopiens se graissent ordinairem ent le
corps a.yec du beurre devant le feu.
1J faut bien aussi que Jes Ethiopiens aient reconnu,
comme nous, la propriété qu’a la poudre à canon de purifier
l’air, puisqu’ils en font brûler dans le lieu qu’habitent
les personnes qui sont attaquées d’une fièvre contagieuse
qu on nomme fera , pour en garantir ceux qui i
viennent les voir ou leur apporter des seepurs.
II y a d’autres m aladies , telles que la petite vérole,
appelée en éthiopien ÎÎ* Ç ^ koujfeign (la lettre ^ se
prononce comme gn dans le mot peigne)’, la rouge.ole,
connue sous le nom d’ankelis h'îh/lxh ; le metat JPpjfT
c est-a-dire, le coup de v en t, ce qui arrive lorsque quelqu’un
étant en sueur, se découvre à l’air subitement et
sans précaution quand il fait du v.ent. Les Éthiopiens
croient encore qu’ils sont moins exposés à cet accident
après qu’ils se sont graissé le corps : aussi ils en contractent
tellement l’habitude, qu’ils le font presque tous
les jours, quand ils le peuvent; mais jamais ils n’y m anquent
quand ils doivent entreprendre un voyage. II est
aussi, dans ce cas, certaines précautions de sûreté qu’ils
ne négligent pas non plus : par exem ple, les habitans de
la ville d’A xum ,'en Abyssinie, avant de se m ettre en
voyage, se-font faire, par le médecin du pays, une incision
en forme de croix sur le bras et près de l’épaule, afin que
leurs compatriotes puissent les reconnoîjtre quand ils les
rencontrent en route , et leur donner des secours s’ils en
ont besoin. Cette incision se fait to,ut simplement avec
un couteau fort tranchant; et pour que la marque s’en
çonserve toujours, on y introduit de la poudre à canon.