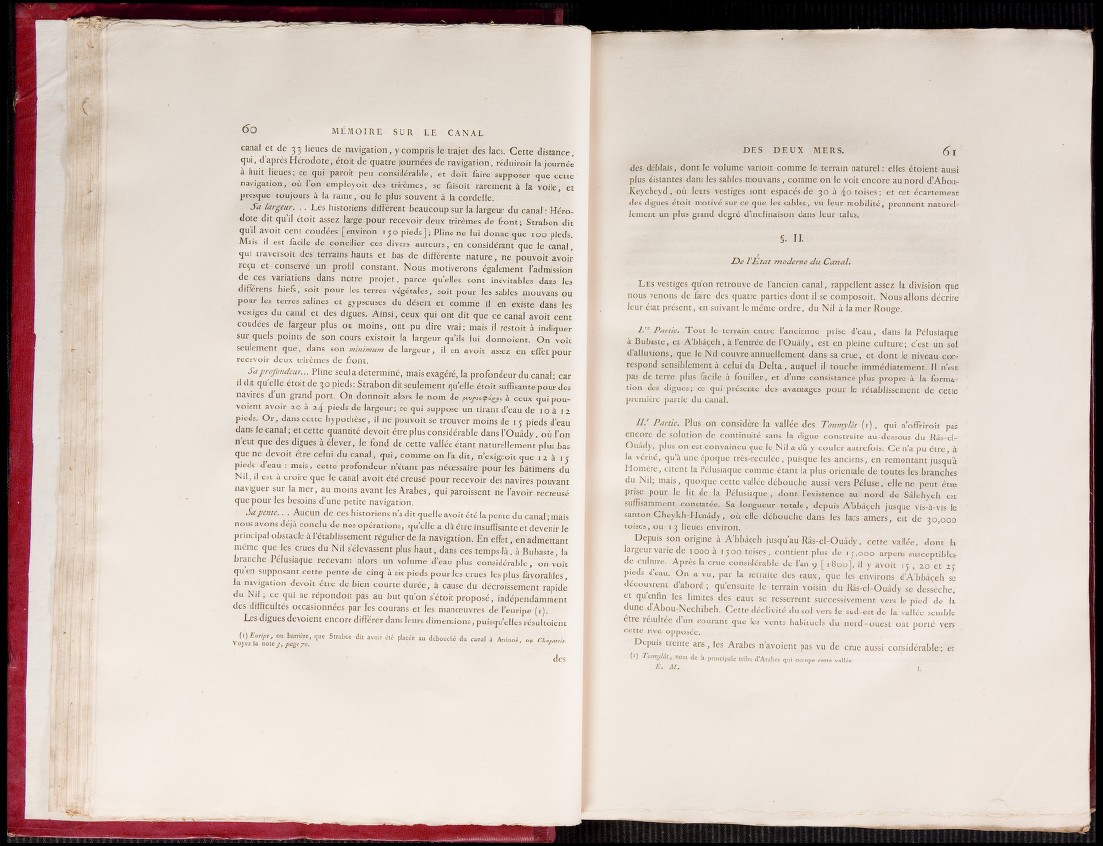
canal et de 3 3 lieues de navigation, y compris ie trajet des lacs. Cette distance,
qui, d après Hérodote, étoit de quatre journées de navigation, réduiroit la journée
a huit lieues; ce qui paroît peu considérable, et doit faire supposer que cette
navigation, où l’on employoit des trirèmes, se faisoit rarement à la voile, et
presque toujours à la rame, ou le plus souvent à la cordelle.
Sa largeur. . . Les historiens diffèrent beaucoup sur la largeur du canal : Hérodote
dit qu’il étoit assez large pour recevoir deux trirèmes de front; Strabon dit
qu’il avoit cent coudées [environ 150 pieds]; Pline ne lui donne que 100 pieds.
Mais il est facile de concilier ces divers auteurs, en considérant que le canal,
qui traversoit des terrains hauts et bas de différente nature, ne pouvoit avoir
reçu et conservé un profil constant. Nous motiverons également l’admission
de ces variations dans notre projet, parce qu’elles sont inévitables dan'; les
différens biefs, soit pour les terres végétales, soit pour les sables mouvans ou
pour les terres salines et gypseuses du désert et comme il en existe dans les
vestiges du canal et des digues. Ainsi, ceux qui ont dit que ce canal avoit cent
coudées de largeur plus ou moins, ont pu dire vrai; mais il restoit à indiquer
sur quels points de son cours existoit la largeur qu’ils lui donnoient. On voit
seulement que, dans son minimum de largeur, il en avoit assez en effet pour
recevoir deux trirèmes de front.
Sa profondeur... Pline seul a déterminé, mais exagéré, la profondeur du canal ; car
il dit qu’elle étoit de 30 pieds: Strabon dit seulement qu’elle étoit suffisante pour des
navires d’un grand port. On donnoit alors le nom de à ceux qui pouvoient
avoir 20 à 24 pieds de largeur; ce qui suppose un tirant d’eau de 10 à 12
pieds. O r, dans cette hypothèse, il ne pouvoit se trouver moins de 15 pieds d’eau
dans le canal; et cette quantité devoit être plus considérable dans l’Ouâdy, où l’on
n eut que des digues à élever, le fond de cette vallée étant naturellement plus bas
que ne devoit etre celui du canal, qui, comme on l’a dit, n’exigeoit que 12 à 15
pieds d eau : mais, cette profondeur n’étant pas nécessaire pour les bâtimens du
Nil, il est à croire que le canâl avoit été creusé pour recevoir des navires pouvant
naviguer sur la mer, au moins avant les Arabes, qui paroissent ne l’avoir recreusé
que pour les besoins d’une petite navigation.
Sa pente. . . Aucun de ces historiens n’a dit quelle avoit été la pente du canal ; mais
nous avons déjà conclu de nos opérations, qu’elle a dû être insuffisante et devenir le
principal obstacle à l’établissement régulier de la navigation. En effet, en admettant
même que les“ crues du Nil s’élevassent plus haut, dans ces temps-là, à Bubaste, la
branche Pélusiaque recevant alors un volume d’eau plus considérable, on voit
qu’en supposant cette pente de cinq à six pieds pour les crues les plus favorables,
la navigation devoit être de bien courte durée, à cause du décroissement rapide
du Nil ; ce qui ne répondoit pas au but qu’on s’étoit proposé, indépendamment
des difficultés occasionnées par les courans et les manoeuvres de l’euripe (1).
Les digues devoient encore différer dans leurs dimensions, puisqu’elles résultoient
( .) E uripe, ou barrière, que Strabon dit avoir été placée au débouché du canal à Arsinoé, ou Cbopatm
V o y e z la n o t e page 70 . ■c“ '"-''
des
des déblais, dont le volume varioit comme le terrain naturel: elles étoient aussi
plus distantes dans les sables mouvans, comme on le voit encore au nord d’Abou-
Keycheyd, où leurs vestiges sont espacés de 30 à 4o toises; et cet écartement
des digues étoit motivé sur ce que les sables, vu leur mobilité, prennent naturellement
un plus grand degré d’inclinaison dans leur talus.
§. IL
De l ’Etat moderne du Canal.
L e s vestiges qu’on retrouve de l’ancien canal, rappellent assez la division que
nous venons de faire des quatre parties dont il se composoit. Nous allons décrire
leur état présent, en suivant le même ordre, du Nil à la mer Rouge.
l r‘ Partie. Tout le terrain entre l’ancienne prise d’eau, dans la Pélusiaque
à Bubaste, et A ’bbâçeh, à l’entrée de l’Ouâdy, est en pleine culture; c’est un sol
d’alluvions, que le Nil couvre annuellement dans sa crue, et dont le niveau correspond
sensiblement à celui du De lta, auquel il touche immédiatement. Il n’est
pas de terre plus facile à fouiller, et d’une consistance plus propre à la formation
des digues; ce qui présente des avantages pour le rétablissement de cette
première partie du canal.
//. Partie. Plus on considère la vallée des Toumylât (t), qui n’ofïriroit pas
encore de solution de continuité sans la digue construite au-dessous du Râs-el-
Ouâdy, plus on est convaincu que le Nil a dû y couler autrefois. Ce n’a pu être, à
la vérité, qu’à une époque très-reculée, puisque les anciens, en remontant jusqu’à
Homère, citent la Pélusiaque comme étant la plus orientale de toutes les branches
du Nil; mais, quoique cette vallée débouche aussi vers Péluse, elle ne peut être
prise.pour le lit de la Pélusiaque, dont l’existence au nord de Sâlehyeh est
suffisamment constatée. Sa longueur totale, depuis A ’bbâçeh jusque vis-à-vis le
santon Cheykh-Henâdy, où elle débouche dans les lacs amers, est de 30,000
toises, ou 13 lieues environ.
Depuis son origine à A ’bbâçeh jusqu’au Râs-el-Ouâdy, cette vallée, dont la
largeur varie de 1000 à 1500 toises, contient plus de 15,000 arpens susceptibles
de culture. Après la crue considérable de l’an 9 [ 1800], il y avoit 15 , 20 et 25
pieds deau. On a vu, par la retraite des eaux, que les environs d’A ’bbâçeh se
découvrent d abord; qu’ensuite le terrain voisin du Râs-el-Ouâdy se dessèche,
et qu enfin les limites des eaux se resserrent successivement vers le pied de la
dune d Abou-Nechâbeh. Cette déclivité du sol vers le sud-est de la vallée semble
etre resultee d un courant que les vents habituels du nord - ouest ont porté vers
cette rive opposée.
Depuis trente ans, les Arabes n’avoient pas vu de crue aussi considérable; et
(1) Toumylât. nom de la-principale tribu d’Arabes qui occupe cette vallée.