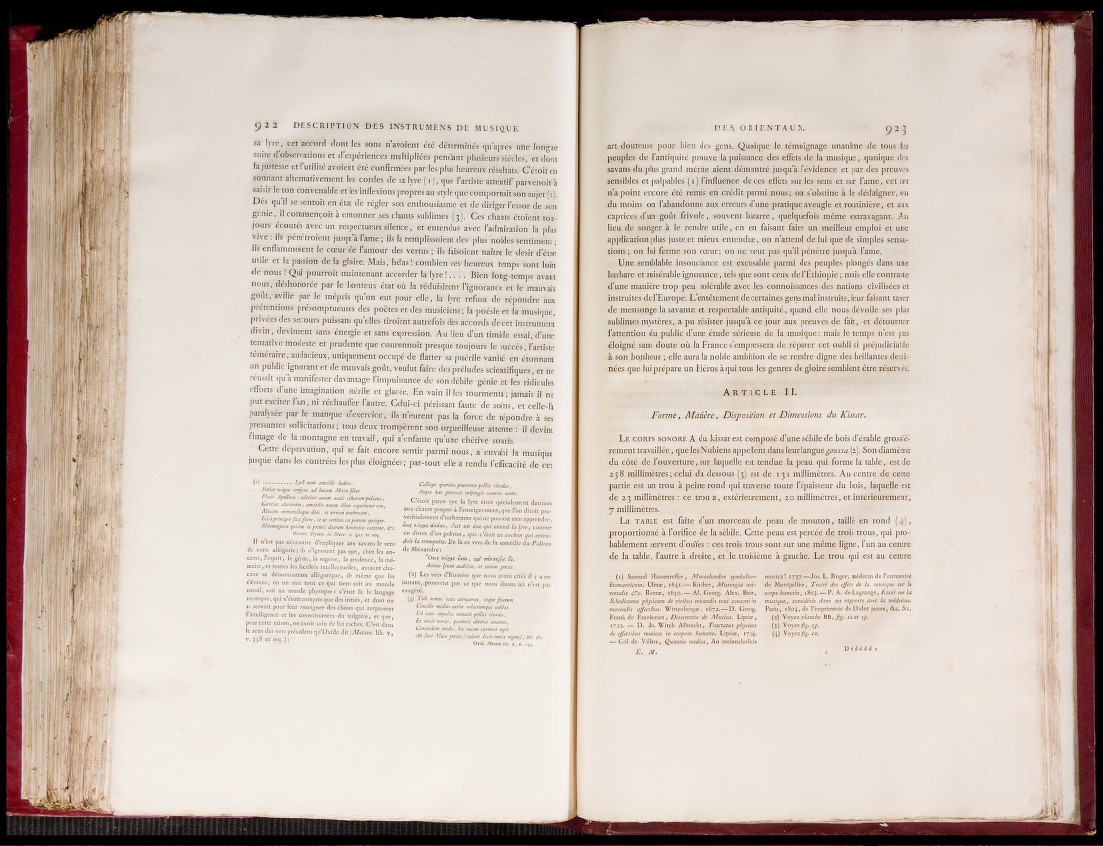
sa lyre, cet accord dont les sons n’avoient été déterminés qu’après une longue
suite d’observations et d’expériences multipliées pendant plusieurs siècles, et dont
la justesse et 1 utilité avoient ete confirmées par les plus heureux résultats. C’étoit en
sonnant alternativement les cordes de sa lyre ( i ), que l’artiste attentif parvenoit à
saisir le ton convenable et les inflexions propres au style que comportoit son sujet (a).
Dès qu il se sentoit en état de régler son enthousiasme et de diriger l’essor de son
génie, il commençoità entonner ses chants sublimes (3). Ces chants étoient toujours
écoutés avec un respectueux silence, et entendus avec l’admiration la plus
vive : ils pénétraient jusqu’à i’ame ; ils la remplissoient des plus nobles sentimens ;
ils enflammoient le coeur de l’amour des vertus ; ils faisoient naître le désir d’être
utile et la passion de la gloire. Mais, hélas ! combien ces heureux temps sont loin
de nous ! Qui pourrait maintenant accorder la lyre ! Bien long-temps avant
nous, déshonorée par le honteux état où la réduisirent l’ignorance et le mauvais
gout, avilie par le mépris quon eut pour elle, la lyre refusa de répondre aux
prétentions présomptueuses des poètes et des musiciens; la poésie et la musique,
privées des secours puissans qu elles tiraient autrefois des accords de cet instrument
div in , devinrent sans énergie et sans expression. Au lieu d’un timide essai, d’une
tentative modeste et prudente que couronnoit presque toujours le succès, l’artiste
téméraire, audacieux, uniquement occupé de flatter sa puérile vanité en étonnant
un public Ignorant et de mauvais goût, voulut faire des préludes scientifiques, et ne
réussit qu’à manifester davantage l’impuissance de son débile génie et les ridicules
efforts d’une imagination stérile et glacée. En vain il les tourmenta; jamais il ne
put exciter 1 un, ni réchauffer 1 autre. Celui-ci périssant faute de soins, et celle-là
paralysée par le manque d’exercice, ils n’eurent pas la force de répondre à ses
pressantes sollicitations ; tous deux trompèrent son orgueilleuse attente : il devint
1 image de la montagne en travail, qui n’enfante qu’une chétive souris.
Cette dépravation, qui se fait encore sentir parmi nous, a envahi la musique
jusque dans les contrées les plus éloignées ; par-tout elle a rendu l’efficacité de cet
( ' ) ............................ J-yra verà amahile ludens,
S talat vtiqtte confisus a d loevam A fà ia filius
P h ttii ApolUnis : celeriter autem acutè citharam pulsans,
Caneiat alternatim ; amahilis autem ¡Hum sequebatur vox,
Miscens immortalesque deos, et terrant tenebrosam,
U t àprincipio fa c tifu e r e , et ut sortitus est partem quisque.
Mnemosynen quitlem in primis dearum honorabat cantione, frc.
Homer. Hymn. ¡a Merc. v. 42 1 et seq. II n’est pas nécessaire d’expliquer aux savans le sens
de cette allégorie ; ils n’ignorent pas que, chez les anciens,
l’esprit, le génie, la sagesse, la prudence, lam é-
m oire, et toutes les facultés intellectuelles, avoient chacune
sa dénom ination allégorique, de même que les
élém ens, en un m ot tout ce qui tient soit au monde
m oral, soit au m onde physique : c’étoit là le langage
m ystique, qui n’étoit compris que des initiés, et dont on
se servoit pour leur enseigner des choses qui surpassent
l’intelligence et les connoissances du vulgaire, et que,
pour cette raison, on avoit soin de lui cacher. C ’est dans
le sens des vers précédens qu’Ovide v. 338 et seq. ) : dit (Metam. lib. v ,
Calliope querulas proetentat pol/tce c/tordas,
Atq ue la c perçu ¡sis subjungit carmina nervis.
C etoit parce que la lyre étoit spécialement destinée
aux chants propres à l’enseignem ent, que l’on disoit proverbialement
d’un homme qui ne pouvoit rien apprendre,
ovoç hv&Lç ctKvav, c'est un âne qui entend la lyre; comme
on disoit d’un poltron, que c 'étoit un cochon qui enten-
doit la trompette. D e là ce vers de la comédie du Poltron de M énandre :
Ovoç \v&iç H tan , yju ouXTrryÇoç Sç.
Asinus lyram audiebat, et ttibam porcus. (2) Les vers d’Hom ère que nous avons cités il y a un
einxsatgaénrté,. prouvent que ce que nous disons-ici n’est pas
( } ) Ta ie nemus rates attraxerat, inque fe r arum
Concilio médius turboe volucrumque sedebat.
U t satis impulsas teittavit pollice chordas,
E t sensit varios, quamvis diversa sonarent,
Concordarc modos, hoc vocem carminé nmit:
A b Jove Musa parens ( cédant Jouis omnia regno), frc. ire.
Ovid. Metam. lib. X , r. 143.
art douteuse pour bien des gens. Quoique le témoignage unanime de tous les
peuples de l’antiquité prouve la puissance des effets de la musique, quoique des
savans du plus grand mérite aient démontré jusqu’à l’évidence et par des preuves
sensibles et palpables ( 1 ) l’influence de ces effets sur les sens et sur l’ame, cet art
n’a point encore été remis en crédit parmi nous; on s’obstine à le dédaigner, ou
du moins on l’abandonne aux erreurs d’une pratique aveugle et routinière, et aux
caprices d’un goût frivole, souvent bizarre, quelquefois même extravagant. A u
lieu de songer à le rendre utile, en en faisant faire un meilleur emploi et une
application plus juste et mieux entendue, on n’attend de lui que de simples sensations;
on lui ferme son coeur; on ne veut pas qu’il pénètre jusqu’à l’ame.
Une semblable insouciance est excusable parmi des peuples plongés dans une
barbare et misérable ignorance, tels que sont ceux de l’Ethiopie ; mais elle contraste
d’une manière trop peu tolérable avec les connoissances des nations civilisées et
instruites de l’Europe. L ’entêtement de certaines gens mal instruits, leur faisant taxer
de mensonge la savante et respectable antiquité, quand elle nous dévoile ses plus
sublimes mystères, a pu résister jusqu’à ce jour aux preuves de fait, et détourner
l’attention du public d’une étude sérieuse de la musique : mais le temps n’est pas
éloigné sans doute où la France s’empressera de réparer cet oubli si préjudiciable
à son bonheur ; elle aura la noble ambition de se rendre digne des brillantes destinées
que lui prépare un Héros à qui tous les genres de gloire semblent être réservés.
A r t i c l e II.
■ Forme, Matière, Disposition et Dimensions du Kissar.
L e c o r p s s o n o r e A du kissar est composé d’une sébile de bois d’érable grossièrement
travaillée, que les Nubiens appellent dans leur languegoussa (2). Son diamètre
du côté de l’ouverture, sur laquelle est tendue la peau qui forme la table, est de
258 millimètres; celui du dessous (3) est de 13 1 millimètres. Au centre de cette
partie est un trou à peine rond qui traverse toute l’épaisseur du bois, laquelle est
de 23 millimètres : ce trou a , extérieurement, 20 millimètres, et intérieurement,
7 millimètres.
La t a b l e est faite d’un morceau de peau de mouton, taillé en rond ( 4 ) ,
proportionné à l’orifice de la sébile. Cette peau est percée de trois trous, qui probablement
servent d’ouïes : ces trois trous sont sur une même ligne, l’un au centre
de la table, l’autre à droite, et le troisième à gauche. Le trou qui est au centre
(1) Samuel Hassenreffer ,Monochordon symbolico-
biotnanticum. Ulmae, 1641.— Kircher, Musurg ia universalis
¿T 'c. Romae, 1650. — ;Ai. Georg. Alex. Beer,
Schediasma physicum de viribus mirandis toni consoni in
movendis affectibus, W ittenberg», 1672. — D . Georg.
Frank de Frankenau , Dissertano de Musica. Lipsia;,
1722. — D . Jo. W itch A lbrecht, Tractatus physicus
de effectibus musices in corpore huniano. Lipsia;, 1734*
— Col de V illars, Qiicestio medica, An melancholicis
É. M.
m usical 1737.— Jos. L. R oger, m édecin de l’université
de M ontpellier, Traité des effets de la musique sur le
corps humain , 1803. — P . A. de Lagrange, Essai sur la
musique, considérée dans ses rapports avec la médecine. Paris, 1804, d e'l’imprimerie de D idot jeune, &c. &c,
(2) Voyez planche BB, fig. 12 et 13>
(3 ) Vo y ez ./ î®-. y . (4) Voyez fig. 72.
D d d d d d z