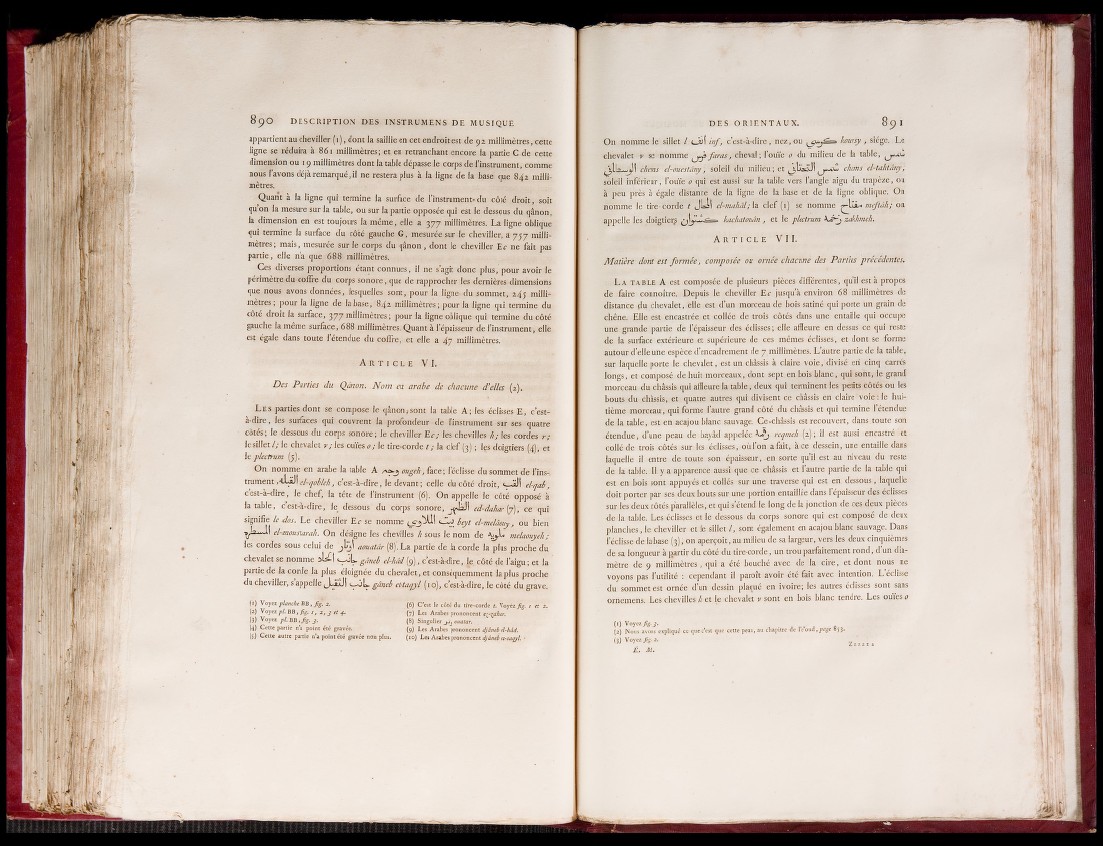
appartient au cheviller (i), dont la saillie en cet endroit est de 92 millimètres, cette
ligne se réduira à 861 millimètres; et en retranchant encore la partie C de cette
dimension ou 19 millimètres dont la table dépasse le corps de l’instrument, comme
nous l’avons déjà remarqué, il ne restera plus à la ligne de la base que 842 millimètres.
Quant à la ligne qui termine la surface de l’instrument«du côté droit, soit
quon la mesure sur la table, ou sur la partie opposée qui est le dessous du qânon,
la dimension en est toujours la même, elle a 377 millimètres. La ligne oblique
qui termine la surface du côté gauche G, mesurée sur le cheviller, a 757 millimètres
; mais, mesurée sur le corps du qânon, dont le cheviller E c ne fait pas
partie, elle 11’a que 688 millimètres.
Ces diverses proportions étant connues, il ne s’agit donc plus, pour avoir le
perimetre du coffre du corps sonore, que de rapprocher les dernières dimensions
que nous avons données, lesquelles sont, pour la ligne- du sommet, 245 millimétrés
, pour la ligne de la base, 842 millimètres; pour la ligne qui termine du
côte droit la surface, 377 millimètres; pour la ligne oblique qui termine du côté
gauche la meme surface, 688 millimètres. Quant à l’épaisseur de l’instrument; elle
est égale dans toute 1 etendue du coffre, et elle a 47 millimètres.
A r t i c l e V I .
Des Parties du Qânon. Nom en arabe de chacune d’elles (2).
L e s parties dont se compose le qânon,-sont la table A ; les éclisses E , c’est-
a-dire, les surfaces qui couvrent la profondeur de l’instrument-sur ses quatre
côtés; le dessous du corps sonore; le cheviller E c; les chevilles h; les cordes r;
le sillet l; le chevalet v; les ouïes 0; le tire-corde t ; la clef (3) ; les doigtiers (4), et
le plectrum (y).
On nomme en arabe la table A oitgeh,i.ace; l’êclisse du sommet de l’ins-i
trument, 41401 cl-qobleh, c’est-à-dire, le devant; celle du côté droit, «_jJ! el-qab ,
cest-à-dire, le chef, la tête de l’instrument (6). On appelle le côté opposé à
la table, cest-à-dire, le dessous du corps sonore, j^lkl! ed-dahar (7), ce qui
signifie le dos. Le cheviller E c se nomme heyt el-melâoity, ou bien
il el-moustara.Ii. On désigne les chevilles h sous le nom de melaouyeh;
les cordes sous celui de M B aouatâr (8). La partie de la corde la plus proche du
chevalet se nomme u-oL. gânel el-hâd (9), c’est-à-dire, le côté de l’aigu ; et la
partie dé la corde la plus éloignée du chevalet, et conséquemment la plus proche
du cheviller, s appelle c_^oL gâneb et-taqyl (10), c’est-à-dire, le côté du grave.
Çi) y oyez, planche BB, Jlg. 2. (6) C ’est le côté du tire-corde t. Voyez fig. 1 et 2.
(2) Voyez pl. BB, fig. / , 2 , j et 4. (y) Les Arabes prononcent e^-gahar.
(3) Voyez pl. BB, fig. 3. (8) Singulier j J , ouatar.
(4) Cette partie n’a point été gravée. (9) Les Arabes prononcent djineb el-hâd.
(5) Cette autre partie n’a point été gravée non plus. (to) Les Arabes prononcent djâmb es-saqyl. •
On nomme le sillet / (_jul inf, c’est-à-dire, nez, ou koursy , siège. Le
chevalet v se nomme Np faras, cheval; l’ouïe o du milieu de la table,
• chems el-ouestâny, soleil du milieu ; et ^lüsïJ! clients cl-tahtâny ;
soleil inférieur, l’ouïe o qui est aussi sur la table vers l’angle aigu du trapèze, ou
à peu près à égale distance de la ligne de la base et de la ligne oblique. On
nomme le tire-corde t Jlsll el-mahâl; la clef (i) se nomme meftâh; on
appelle les doigtiers kachatouân, et le plectrum \J*ÿ zakhme/i.
A r t i c l e VI I .
Matière dont est formée, composée ou ornée chacune des Parties précédentes.
L a t a b l e A est composée de plusieurs pièces différentes, qu’il est à propos
de faire connoître. Depuis le cheviller Ec jusqu’à environ 68 millimètres de
distance {lu chevalet, elle est d’un morceau de bois satiné qui porte un grain de
chêne. Elle est encastrée et collée de trois côtés dans une entaille qui occupe
une grande partie de l’épaisseur des éclisses ; elle afffeure en dessus ce qui reste
de la surface extérieure et supérieure de ces mêmes éclisses, et dont se forme
autour d’elle une espèce d’encadrement de 7 millimètres. L’autre partie de la table,
sur laquelle porte le chevalet, est un châssis à claire voie, divisé en cinq carrés
longs, et composé de huit morceaux, dont sept en bois blanc, qui sont, le grand
morceau du châssis qui affleure la table, deux qui terminent les petits côtés ou les
bouts du châssis, et quatre autres qui divisent ce châssis en claire voie : le huitième
morceau , qui forme l’autre grand côté du châssis et qui termine l’étendue
de la table, est en acajou blanc sauvage. Ce.châssis est recouvert, dans.toute son
étendue, d’une peau de bayâd appelée reqmeh (2) ; il est aussi encastré et
collé de trois côtés sur les éclisses, où l’on a fait, à ce dessein, une entaille dans
laquelle il entre de toute son épaisseur, en sorte qu’il est au niveau du reste
de la table. Il y a apparence aussi que ce châssis et l’autre partie de la table qui
est en bois sont appuyés et collés sur une traverse qui est en dessous, laquelle
doit porter par ses deux bouts sur une portion entaillée dans l’épaisseur des éclisses
sur les deux côtés parallèles, et qui s étend le long de la jonction de ces deux pièces
de la table. Les éclisses et le dessous du corps sonore qui est composé de deux
planches, le cheviller et le sillet l, sont également en acajou blanc sauvage. Dans
l’éclisse de la base (3); on aperçoit, au milieu de sa largeur, vers les deux cinquièmes
de sa longueur à partir du côté du tire-corde, un trou parfaitement rond, d un diamètre
de 9 millimètres , qui a été bouche avec de la cire, et dont nous ne
voyons pas l’utilité : cependant il paroît avoir ete fait avec intention. L eclisse
du sommet est ornée d’un dessin plaqué en ivoire ; les autres éclisses sont sans
oriiemens. Les chevilles h et le chevalet v sont en bois blanc tendre. Les ouïes 0
(1) Voyez ,
(2) Nous avons explique ce que c’est que cette peau, au chapitre de leoud,^qge °>3*
(3) Voyez fig. 2.
Ê . M a