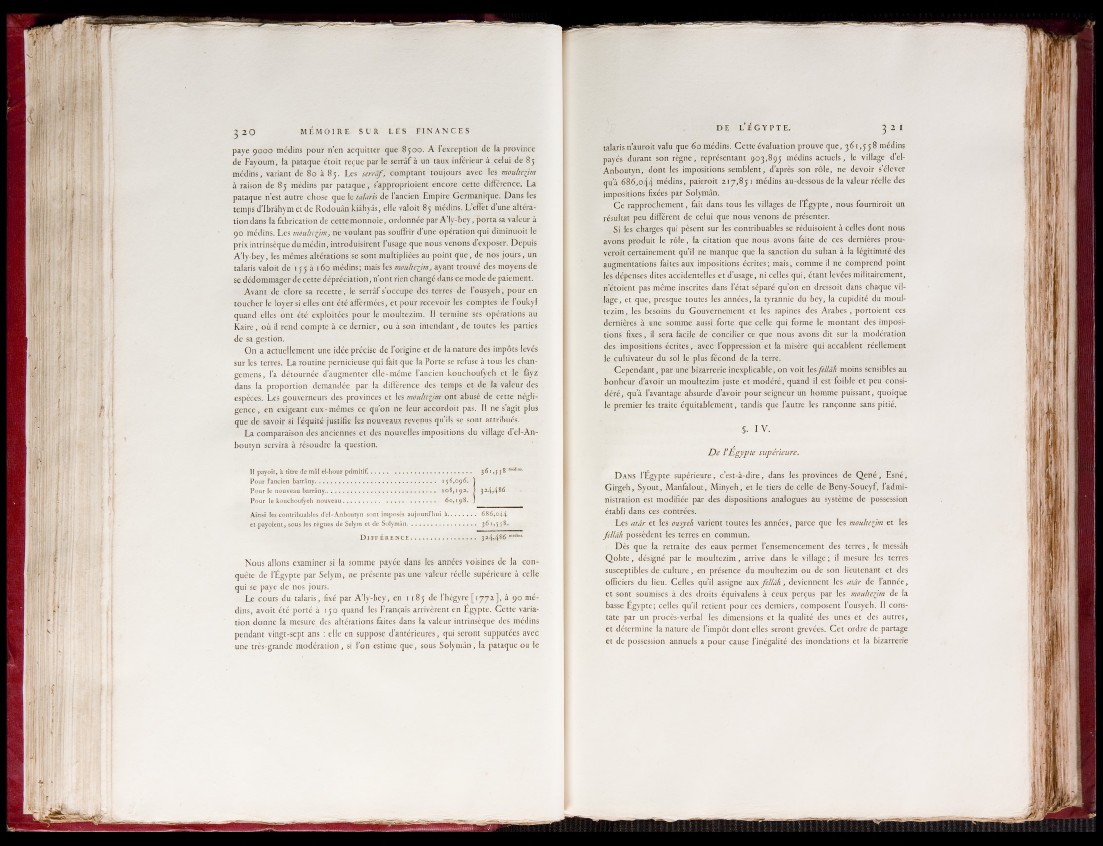
3 2 O M E M O I R E . S U R L E S F I N A N C E S
paye 9000 médins pour n’en acquitter que 8 y 00. A l’exception de la province
de Fayoum, la pataque étoit reçue par le serrâf à un taux inférieur à celui de 8y
médins, variant de 80 à 8y. Les serrâf, comptant toujours avec les moulteiim
à raison de 8y médins par pataque, s’approprioient encore cette différence. La
pataque n’est autre chose que le talaris de l’ancien Empire Germanique. Dans les
temps d’Ibrâhym et de Rodouân kiâhyâs, elle valoit 8y médins. L effet d une altération
dans la fabrication de cette monnoie, ordonnée par A ly-bey, porta sa valeur à
90 médins. Les moulteiim, ne voulant pas souffrir dune opération qui diminuoit le
prix intrinsèque du médin, introduisirent l’usage que nous venons d exposer. Depuis
A’iy-bey, les mêmes altérations se sont multipliées au point que, de nos jours, un
talaris valoit de 1 y y à 160 médins; mais les moulteiim, ayant trouvé des moyens de
se dédommager de cette dépréciation, n’ont rien changé dans ce mode de paiement.
Avant de clore sa recette, le serrâf s’occupe des terres de l’ousyeh, pour en
toucher le loyer si elles ont été affermées, et pour recevoir les comptes de l’oukyl
quand elles ont été exploitées pour le moultezim. Il termine ses opérations au
Kaire, où il rend compte à ce dernier, ou à son intendant, de toutes les parties
de sa gestion.
On a actuellement une idée précise de l’origine et de la nature des impôts levés
sur les terres. La routine pernicieuse qui fait que la Porte se refuse a tous les chan-
gemens, l’a détournée d’augmenter elle-même l’ancien kouchoufyeh et le fâyz
dans la proportion demandée par la différence des temps et de la valeur des
espèces. Les gouverneurs des provinces et les moulteiim ont abusé de cette négligence,
en exigeant eux-mêmes ce qu’on ne leur accordoit pas. Il ne s’agit plus
que de savoir si l’équité justifie les nouveaux revenus qu’ils se sont attribués.
La comparaison des anciennes et des nouvelles impositions du village d’el-An-
boutyn servira à résoudre la question.
II payo it, à titre de mal el-hour p rim itif.................................................................... 3 61,558
Pou r l’ancien barrâny......................................................................... 1 5 6,096. )
Pou r le nouveau barrâny............................................... 10 8 ,19 2 . / 324,486
Pou r le kouchoufyeh nou veau .............................................................. 60 ,198 . )
Ainsi les contribuables d’el-Anboutyn sont imposés aujourd’hui k................... 686,o44
et payoient, sous les règnes de Selym et de Solymân.............................................. 361,5 5 8.
D i f f é r e n c e ........................................... 324,486 midîns-
Nous allons examiner si la somme payée dans les années voisines de la conquête
de l’Égypte par Selym, ne présente pas une valeur réelle supérieure à celle
qui se paye de nos jours.
Le cours du talaris, fixé par A’iy-bey, en i i8y de l’hégyre [1772], à 90 médins,
avoit été porté à 1 yo quand les Français arrivèrent en Egypte. Cette variation
donne la mesure des altérations faites dans la valeur intrinsèque des médins
pendant vingt-sept ans : elle en suppose d’antérieures, qui seront supputées avec
une très-grande modération, si l’on estime que, sous Solymân, la pataque ou le
talaris n’auroit valu que 60 médins. Cette évaluation prouve que, 361 ,y y 8 médins
payés durant son règne, représentant 903,8çy médins actuels, le village del-
Anboutyn, dont les impositions semblent, d’après son rôle, ne devoir s élever
qu’à 686,o44 médins, paierait 217,8y 1 médins au-dessous de la valeur réelle des
impositions fixées par Solymân.
Ce rapprochement, fait dans tous les villages de l’Egypte, nous foumiroit un
résultat peu différent de celui que nous venons de présenter.
Si les charges qui pèsent sur les contribuables se réduisoient à celles dont nous
avons produit le rôle, la citation que nous avons faite de ces dernières prouverait
certainement qu’il ne manque que la sanction du sultan à la légitimité des
augmentations faites aux impositions écrites; mais, comme il ne comprend point
les dépenses dites accidentelles et d’usage, ni celles qui, étant levées militairement,
netoient pas même inscrites dans l'état séparé qu’on en dressoit dans chaque village,
et que, presque toutes les années, la tyrannie du bey, la cupidité du moul-
tczim, les besoins du Gouvernement et les rapines des Arabes , portoient ces
dernières à une somme aussi forte que celle qui forme le montant des impositions
fixes, il sera facile de concilier ce que nous avons dit sur la modération
des impositions écrites, avec l’oppression et la misère qui accablent réellement
le cultivateur du sol le plus fécond de la terre.
Cependant, par une bizarrerie inexplicable, on voit les fellâh moins sensibles au
bonheur d’avoir un moultezim juste et modéré, quand il est foible et peu considéré,
qu’à l’avantage absurde d’avoir pour seigneur un homme puissant, quoique
le premier les traite équitablement, tandis que l’autre les rançonne sans pitié.
§. IV .
De l’Egypte supérieure.
D a n s l’Egypte supérieur^, c’est-à-dire, dans les provinces de Qené, Esné,
Girgeh, Syout, Manfàlout, Minyeh, et le tiers de celle de Beny-Soueyf, l’administration
est modifiée par des dispositions analogues au système de possession
établi dans ces contrées.
Les atâr et les ousyeh varient toutes les années, parce que les moulteiim et les
fellâh possèdent les terres en commun.
Dès que la retraite des eaux permet l’ensemencement des terres, le messâh
Qobte, désigné par le moultezim, arrive dans le village ; il mesure les terres
susceptibles de culture, en présence du moultezim ou de son lieutenant et des
officiers du lieu. Celles qu’il assigne a u fellâh, deviennent les atâr de l’année,
et sont soumises à des droits équivaiens à ceux perçus par les moulteiim de la
basse Egypte; celles qu’il retient pour ces derniers, composent l’ousyeh. Il constate
par un procès-verbal les dimensions et la qualité des unes et des autres,
et détermine la nature de l’impôt dont elles seront grevées. Cet ordre de partage
et de possession annuels a pour cause l’inégalité des inondations, et la bizarrerie
s i M l ü i I l i ' i l ' V ï k ■% : 1 i T & I ï i l v s Î i l : ' ! ’ l ï î Î ; l : i 1 $ 1 : 3 ' : ’