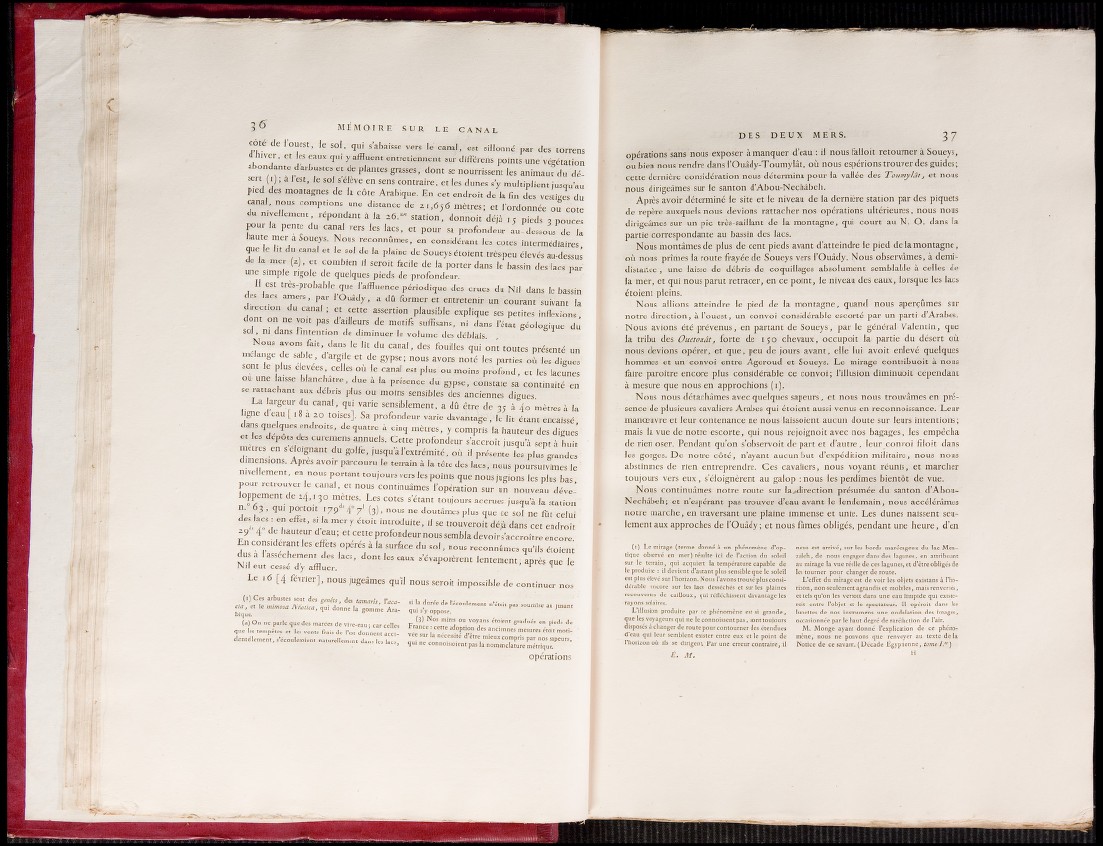
3 ° M é m o i r e s u r l e c a n a l
coté de l’ouest, le sol, qui s abaisse vers le canal, est sillonné par des torrens
nver, et les eaux qui y affluent entretiennent sur différens points une végétation
a ondante d arbustes et de plantes grasses, dont se nourrissent les animaux du désert
(i) ; a 1 est, le sol s’élève en sens contraire, et les dunes s’y multiplient jusqu’au
pie des montagnes de la côte Arabique. En cet endroit de la fin des vestiges du
canal, nous comptions une distance de 21,656 mètres; et l’ordonnée ou cote
du nivellement répondant à la 2 6 . - station, donnoit déjà 15 pieds 3 pouces
pour la pente du canal vers les lacs, et pour sa profondeur au-dessous de la
aute mer a Soueys. Nous reconnûmes, en considérant les cotes intermédiaires
que le ht du canal et le sol de la plaine de Soueys étoient très-peu élevés au-dessus
de la mer (2), et combien .1 seroit facile de la porter dans le bassin des lacs par
une simple rigole de quelques pieds de profondeur.
Il est très-probable que l’affluence périodique des crues du Nil dans le bassin
es lacs amers, par l’Ouâcly, a dû former et entretenir un courant suivant la
direction du canal ; et cette assertion plausible explique ses petites inflexions
dont on ne voit pas d’ailleurs de motif; suffisais, ni dans l’état géologique du'
sol, m dans 1 intention de diminuer le volume des déblais.
Nous avons fait, dans le lit du canal, des fouilles qui ont toutes présenté un
mélangé de sable, darg.le et de gypse; nous avons noté les parties où les digues
sont le plus elevees celles où le canal est plus ou moins profond, et les lacunes
on une laisse blanchâtre, due à la présence du gypse, constate sa continuité en
se rattachant aux débris plus ou moins sensibles des anciennes digues.
La largeur du canal, qui varie sensiblement, a dû être de 35 à 4o mètres à la
igne deau [ 18 a 20 toises]. Sa profondeur varie davantage , le lit étant encaissé
dans quelques endroits, de quatre à cinq mètres, y compris la hauteur des digues’
et les dépôts des curemens-annuels. Cette profondeur s’accroît jusqu’à sept à huit
métrés en selo.gnant du golfe, jusqu’à l’extrémité, où il présente les plus grandes
dimensions. Apres avoir parcouru le terrain à la tête des lacs, nous poursuivîmes le
nivellement, en nous portant toujours vers les points que nous jugions les plus bas
pour retrouver le canal et nous continuâmes l’opération sur un nouveau déve-
oppement ce 24,130 métrés. Les cotes s’étant toujours accrues jusqu’à la station
n. 63 , qui portoit 179 s 4° 7 (3), nous ne doutâmes plus que ce sol ne fût celui
M Ê 1 1 ’ M mCr y ét0it ilUr0dUite’ I SC tr° UVeroit dé' à dans cet endroit
29 4 de hauteur d eau; et cette profondeur nous sembla devoir s’accroître encore
En considérant les effets opérés à la surface du sol, nous reconnûmes qu’ils étoient
dus a assèchement des lacs, dont les eaux s’évaporèrent lentement; après que le
Nil eut cesse d y affluer. ^
Le 16 [4 février], nous jugeâmes qu’il nous seroit impossible de continuer nos
-•*“ - — - ' “ >• bique. ? ' *
(2) On ne parle que des marées de vive-eau• car celles France ° “ grad" “ en Pieds de
que les tempêtes et les vents frais de l’est donnent acct- vée sur la n ' 1 È Ê È ’t™ '™ ' 3 mesures éto!t m0,‘-
dentellement, s’écouleroient naturellement dans les lacs qui 2 E ** »s tes tacs, qui ne conBnotSssoTten t p*a“s *l1 a nomeBnclaPture Pm"ét riqueS.apeUrS’
opérations
opérations sans nous exposer à manquer d’eau : il nous falloit retourner à Soueys,
ou bien nous rendre dans l’Ouâdy-Toumylât, où nous espérions trouver des guides;
cette dernière considération nous détermina pour la vallée des Toumylât, et nous
nous dirigeâmes sur le santon d’Abou-Nechâbeh.
Après avoir déterminé le site et le niveau de la dernière station par des piquets
de repère auxquels nous devions rattacher nos opérations ultérieures, nous nous
dirigeâmes sur un pic très-saillant de la montagne, qui court au N. O. dans la
partie correspondante au bassin des lacs.
Nous montâmes de plus de cent pieds avant d’atteindre le pied de la montagne,
où nous prîmes la route frayée de Soueys vers l’Ouâdy. Nous observâmes, à demi-
distance , une laisse de débris de coquillages absolument semblable à celles de
la mer, et qui nous parut retracer, en ce point, le niveau des eaux, lorsque les lacs
étoient pleins.
Nous allions atteindre le pied de la montagne, quand nous aperçûmes sur
notre direction, à l’ouest, un convoi considérable escorté par un parti d’Arabes.
Nous avions été prévenus, en partant de Soueys, par le général Valentin, que
la tribu des Ouetoiiât, forte de i j o chevaux, occupoit la partie du désert où
nous devions opérer, et que, peu de jours avant, elle lui avoit enlevé quelques
hommes et un convoi entre Ageroud et Soueys. Le mirage contribuoit à nous
faire paroître encore plus considérable ce convoi; l’illusion diminuoit cependant
à mesure que nous en approchions (i).
Nous nous détachâmes avec quelques sapeurs, et nous nous trouvâmes en présence
de plusieurs cavaliers Arabes qui étoient aussi venus en reconnoissance. Leur
manoeuvre et leur contenance ne nous laissoient aucun doute sur leurs intentions ;
mais la vue de notre escorte, qui nous rejoignoit avec nos bagages, les empêcha
de rien oser. Pendant qu’on s’observoit de part et d’autre, leur convoi filoit dans
les gorges. De notre côté, n’ayant aucun but d’expédition militaire, nous nous
abstînmes de rien entreprendre. Ces cavaliers, nous voyant réunis, et marcher
toujours vers eux, s’éloignèrent au galop : nous les perdîmes bientôt de vue.
Nous continuâmes notre route sur la,direction présumée du santon d’Abou-
Nechâbeh; et n’espérant pas trouver d’eau avant le lendemain, nous accélérâmes
notre marche, en traversant une plaine immense et unie. Les dunes naissent seulement
aux approches de l’Ouâdy; et nous fûmes obligés, pendant une heure, d’en
(1) Le mirage (terme donné à un phénomène d'optique
observé en mer) résulte ici de l’action du soleil
sur le terrain, qui acquiert la température capable de
le produire : il devient d’autant plus sensible que le soleil
est plus élevé sur l’horizon. Nous l’avons trouvé plus considérable
encore sur les lacs desséchés et sur les plaines
recouvertes de cailloux, qui réfléchissent davantage les
rayons solaires.
L illusion produite par ce phénomène est si grande,
que les voyageurs qui ne le connoissentpas, sont toujours
disposes à changer de route pour contourner des étendues
d eau qui leur semblent exister entre eux et le point de
l horizon ou ils se dirigent. Par une erreur contraire, il
É. M.
nous est arrivé, sur les bords marécageux du lac M en-
zaleh, de nous engager dans des lagunes, en attribuant
au mirage la vue réelle de ces lagunes, et d’être obligés de
les tourner pour changer de route.
L ’effet du mirage est de voir les objets existans à l’horizon,
non-seulement agrandis et mobiles, mais renversés,
et tels qu’on les verroit dans une eau limpide qui existe-
roit entre l’objet et le spectateur. II opéroit dans les
lunettes de nos instrumens une ondulation des images,
occasionnée par le haut degré de raréfaction de l’air.
M. Monge ayant donné l’explication de ce phénomène,
nous ne pouvons que renvoyer au texte de la
Notice de ce savant. (Décade Egyptienne, tome I . ‘r )
H