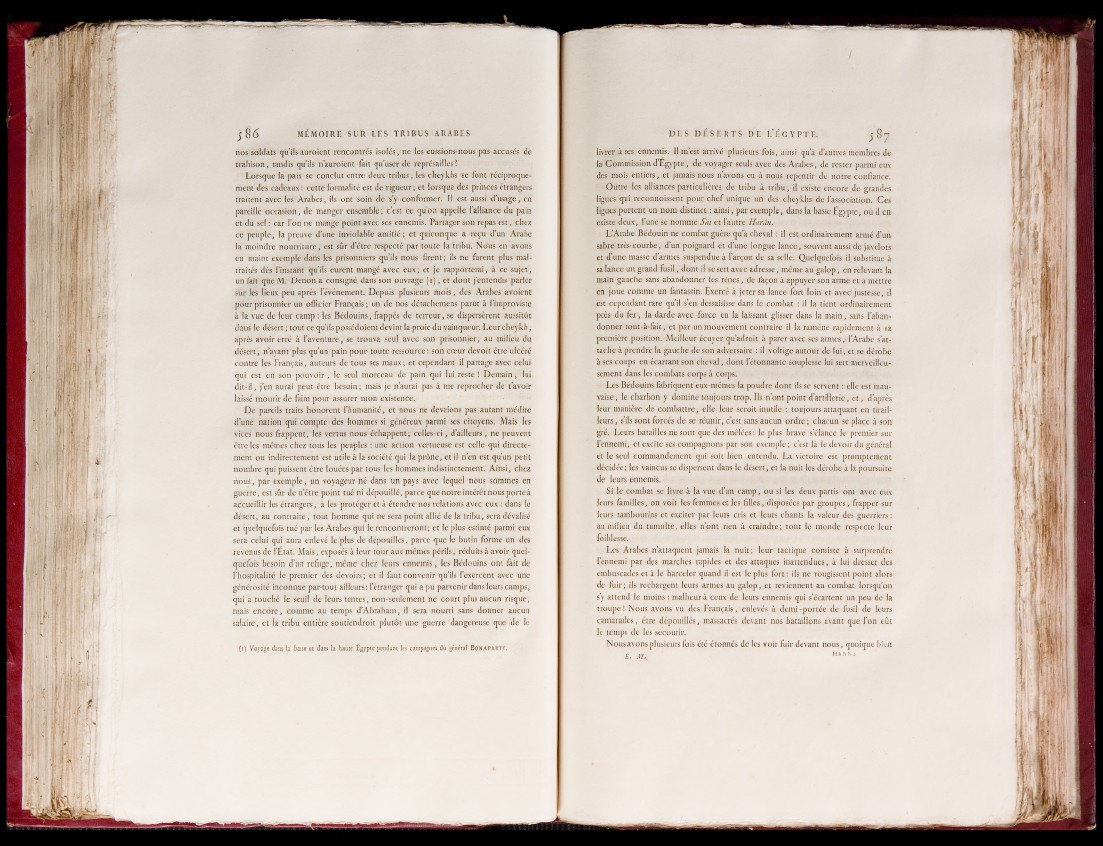
nos soldats qu'ils auraient rencontrés isolés, ne les eussions-nous pas accusés de
trahison, tandis qu’ils n’auroient fait qu’user de représailles!
Lorsque la paix se conclut entre deux tribus, les cheykhs se font réciproquement
des cadeaux : cette formalité est de rigueur ; et lorsque des princes étrangers
traitent avec les Arabes, ils ont soin de s’y conformer. Il est aussi d’usage, en
pareille occasion, de manger ensemble; c’est ce qu’on appelle l’alliance du pain
et du sel : car l’on ne mange point avec ses ennemis. Partager son repas est, chez
ce peuple, la preuve d’une inviolable amitié ; et quiconque a reçu d’un Arabe
la moindre nourriture, est sûr d’être respecté par toute la tribu. Nous en avons
eu maint exemple dans les prisonniers qu’ils nous firent; ils ne furent plus maltraités
dès l’instafit qu’ils eurent mangé avec eux; et je rapporterai, à ce sujet,
un fait que M. Denon a consigné dans son ouvrage (t), et dont j’entendis parler
Sur les lieux peu après l’événement. Depuis plusieurs mois, des Arabes avoient
pour prisonnier un officier Français ; un de nos détachemens parut à l’improviste
à la vue de leur camp : les Bédouins, frappés de terreur, se dispersèrent aussitôt
dans le désert ; tout ce qu’ils possédoient devint la proie du vainqueur. Leur cheykh,
après avoir erré à l’aventure, se trouva seul avec son prisonnier, au milieu du
désert, n’ayant plus qu’un pain pour toute ressource : son coeur devoit être ulcéré
contre les Français, auteurs de tous ses maux; et cependant il partage avec celui
qui est en son pouvoir , le seul morceau de pain qui lui reste ! Demain, lui
dit-il, j’en aurai peut-être besoin; mais je n’aurai pas à me reprocher de t’avoir
laissé mourir de faim pour assurer mon existence.
De pareils traits honorent l’humanité, et nous ne devrions pas autant médire
d’une nation qui compte des hommes si généreux parmi ses citoyens. Mais les
vices nous frappent, lès vertus nous échappent; celles-ci, d’ailleurs, ne peuvent
être les mêmes chez tous les peuples ; une action vertueuse est celle qui directement
ou indirectement est utile à la société qui la prône, et il n’en est qu’un petit
nombre qui puissent être louées par tous les hommes indistinctement. Ainsi, chez
nous, par exemple, un voyageur né dans un pays avec lequel nous sommes en
guerre, est sûr de n’être point tué ni dépouillé, parce que notre intérêt nous porte à
accueillir les étrangers, à les protéger et à étendre nos relations avec eux : dans le
désert, au contraire, tout homme qui ne sera point allié de la tribu, sera dévalisé
et quelquefois tué par les Arabes qui le rencontreront; et le plus estimé parmi eux
sera celui qui aura enlevé le plus de dépouilles, parce que le butin forme un des
revenus de l’Etat. Mais, exposés à leur tour aux mêmes périls, réduits à avoir quelquefois
besoin d’un refuge, même chez leurs ennemis, les Bédouins ont fait de
l’hospitalité le premier des devoirs; et il faut convenir qu’ils l’exercent avec une
générosité inconnue par-tout ailleurs: l’étranger qui a pu parvenir dans leurs camps,
qui a touché le seuil de leurs tentes, non-seulement ne court plus aucun risque,
mais encore, comme au temps d’Abraham, il sera nourri sans donner aucun
salaire, et la tribu entière soutiendroit plutôt une guerre dangereuse que de le
( i) Voyage dans la basse et dans la haute Egypte pendant les campagnes du général B o n a p a r t e .
livrer à ses ennemis. Il m’est arrivé plusieurs fois, ainsi qu’à d’autres membres dë
la Commission d’Egypte, de voyager seuls avec des Arabes, de rester parmi eux
des mois entiers, et jamais nous n’avons eu à nous repentir de notre confiance.
Outre les alliances particulières de tribu à tribu, il existe encore de grandes
ligues qui reconnoissent pour chef unique un des cheykhs de l’association. Ces
ligues portent un nom distinct : ainsi, par exemple, dans la basse Egypte, où il en
existe deux, l’une se nomme Sai et l’autre Harân.
L’Arabe Bédouin ne combat guère qu’à cheval : il est ordinairement armé d’un
sabre très-courbe, d’un poignard et d’une longue lance, souvent aussi de javelots
et d’une masse d’armes suspendue à l’arçon de sa selle. Quelquefois il substitue à
sa lance un grand fusil, dont il se sert avec adresse, même au galop, en relevant la
main gauche sans abandonner les rênes, de façon à appuyer son arme et à mettre
en joue comme un fantassin. Exercé à jeter sa lance fort loin et avec justesse, il
est cependant rare qu’il s’en dessaisisse dans le combat : il la tient ordinairement
près du fer, la darde avec force en la laissant glisser dans la main, sans l’abandonner
tout-à-fait, et par un mouvement contraire il la ramène rapidement à sa
première position. Meilleur écuyer qu’adroit à parer avec ses armes,.l’Arabe s’attache
à prendre la gauche de son adversaire : il voltige autour de lui, et se dérobe
à ses coups en écartant son cheval, dont l’étonnante souplesse lui sert merveilleusement
dans les combats corps à corps.
Les Bédouins fabriquent eux-mêmes la poudre dont ils se servent : elle est mauvaise
, le charbon y domine toujours trop. Ils n’ont point d’artillerie, et, d’après
leur manière de combattre, elle leur seroit inutile : toujours attaquant en tirailleurs,
s’ils sont forcés de se réunir, c’est sans aucun ordre ; chacun se place à son
gré. Leurs batailles ne sont que des mêlées : le plus brave s’élance le premier sur
l’ennemi, et excite ses compagnons par son exemple; c’est là le devoir du général
et le seul commandement qui soit bien entendu. La victoire est promptement
décidée; les vaincus se dispersent dans le désert, et la nuit les dérobe à la poursuite
de leurs ennemis.
Si le combat se livre à la vue d’un camp, ou si les deux partis ont avec eux
leurs familles, on voit les femmes et les filles, disposées par groupes, frapper sur
leurs tambourins et exciter par leurs cris et leurs chants la valeur des guerriers :
au milieu du tumulte, elles n’ont rien à craindre; tout le monde respecte leur
foiblesse.
Les Arabes n’attaquent jamais la nuit; leur tactique consiste à surprendre
l’ennemi par des marches rapides et des attaques inattendues, à lui dresser des
embuscades et à le harceler quand il est le plus fort : ils ne rougissent point alors
de fuir ; ils rechargent leurs armes au galop, et reviennent au combat lorsqu’on
s’y attend le moins : malheur à ceux de leurs ennemis qui s’écartent un peu de la
troupe! Nous avons vu des Français, enlevés à demi-portée de fusil de leurs
camarades, être dépouillés, massacrés devant nos bataillons avant que l’on eût
le temps de les secourir.
Nous avons plusieurs fois été étonnés de les voir fuir devant nous, quoique bien
É . M .. ' Hh h k ,