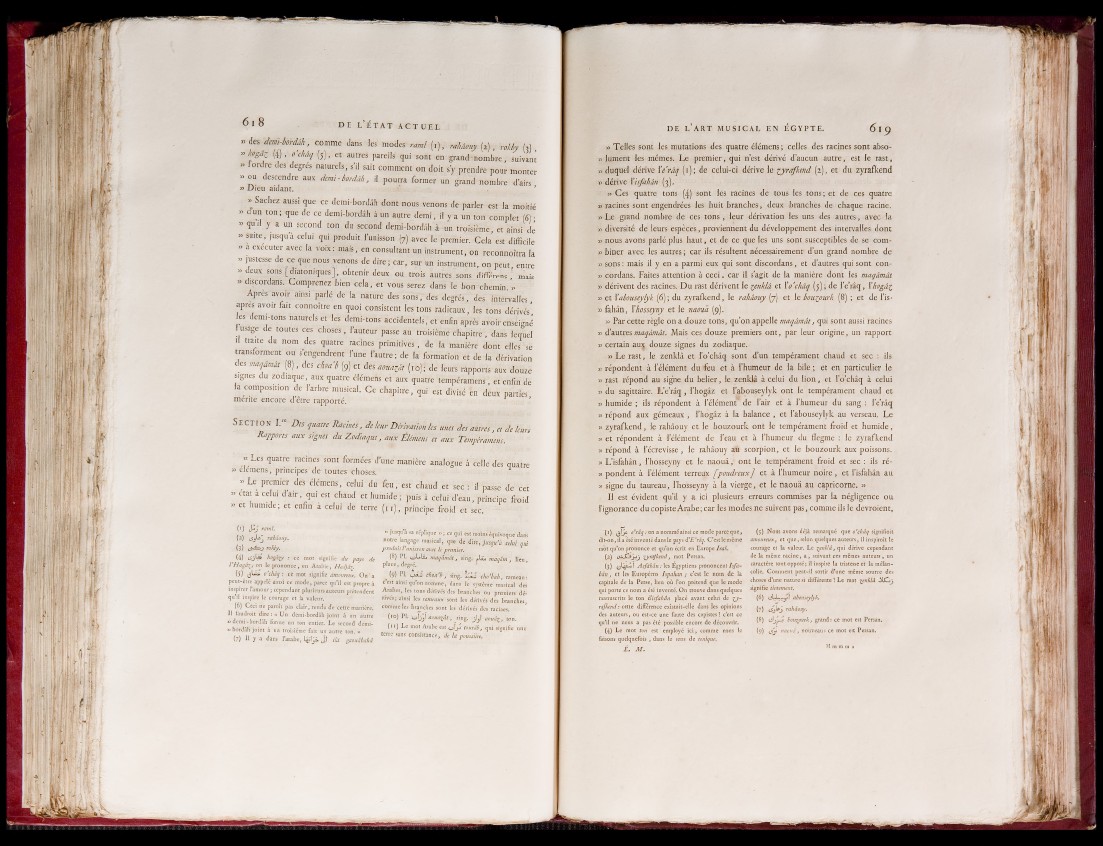
» des demi-bordâh, comme dans les modes raml (r), rahâouy {i) , rolby (*)
»hogâZ (4), o’châj (5), et autres pareils qui sont en grand - nombre , suivant
» I ordre des degrés naturels, s’il sait comment on doit s’y prendre pour monter
» ou descendre aux demi-bordâh, il pourra former un grand nombre d’airs
» Dieu aidant. '
» Sachez aussi que ce demi-bordâh dont nous venons de parler est la moitié
* d u" ton ; f * de ce demi-bordâh à un autre demi, il y a un ton complet (6) ;
” i ud 1 a lm second ton ([u second demi-bordâh à un troisième, et ainsi dé
» suite, jusqu’à celui qui produit l’unisson (7) avec le premier. Cela est difficile
» a executer avec la voix: mais, en consultant un instrument, on reconnoîtra la
» justesse de ce que nous venons de dire ; car, sur un instrument, on peut entre
» deux sons [diatoniques], obtenir deux ou trois autres'sons différens i mais
» discordans. Comprenez bien cela, et vous serez dans le bon chemin »
Après avoir ainsi parlé de la nature des sons, des degrés, dei. intervalles,
après avoir fait connoître en quoi consistent les tons radicaux, les tons dérivés’
les demi-tons naturels et les demi-tons accidentels, et enfin après avoir enseigné
i usage de toutes ces choses, l’auteur passe au troisième chapitre , dans lequel
il traite du nom des quatre racines primitives , de la manière dont elles se
transforment ou s’engendrent l’une l’autre; de la formation et de la dérivation
des maqâmât (8), des choa’l (9) et des aouatft (10); de leurs rapports aux douze
signes du zodiaque, aux quatre élémens et aux quatre tempéramens, et enfin de
la composition de l’arbre musical. Ce chapitre, qui est divisé 'en deux parties
mente encore d’être rapporté. ,
S e c t i o n I ." Des quatre Racines, de leur Dérivation les unes des antres, et de leurs
Rapports aux signes du Zodiaque, aux Élémens et aux Tempéramens.
« L e s quatre racines sont formées d’une manière analogue à celle des quatre
» elemens, principes de toutes choses.
» L e premier des élémens, celui du feu, est chaud et sec : il passe de cet
» ctai.a celui d’air, qui est chaud et humide ; puis à celui d’eau, principe froid
» et humide; et enfin à celui de terre (, r), principe froid et sec. -
,( 1,) 1 - raml. * JU. S(IU Ha sa ^p.lique » ; ce qui est moins équivoque dans 2 ^ Tah“°'V- noire langage m „rical, que de d i r e / ^ llu i nui
(3) rokby. produit l'unisson avec le premier.
(4) hogâty ■" ce mot signifie du pays de maqâinât, sing. «U, maqâm , lieu,
l'Hogâi; on le prononce, en Arabie, Hedjâi. place, degré.
peu(5t-)^ê tr¿eU acpp eol'éch aâiqn s:i ccee mmoodt es,i gpnairfciee qaum’iolu reesut xp. roOpnre aà c’. es(?t )a iPnsI-i qu’on ncohmoam'be,, dsianngs. le systcèhmoe'b amh u}s ircaaml edaues:
inspirer l’am our; cependant plusieurs auteurs prétendent Arabes, les tons dérivés des branches ou premiers dé-
qu’il inspire le courage et la valeur. ’ rivés; ainsi les rameaux sont les dérivés des branches,
(6) Ceci ne paroît pas clair, rendu de cette manière, comme les branches sont les dérivés des racines.
»Il dfcanund-rbaoitr ddaihr ef:o.r.m Uen u nd etmoni- beonrtdieârh. jLoien ts ecào nudn daeumtrie- : (10) Pl. f aou^dt, ring. ;U aovir. ton. /, n r_ .. , r > . . .n » bordâh joint à un troisième fait un autre ton. » terré sans ^ ^
(7) Il y a dans l’arabe, U j i j | Un gaouâbaM ^ k
» Telles sont les mutations des quatre élémens; celles des racines sont absolument
les mêmes. Le premier, qui n’est dérivé d’aucun autre, est le rast,
» duquel dérive Xe’râq (i); de celui-ci dérive le gyrafkend (2), et du zyrafkend
» dérive l’isfahâm (3).
» Ces quatre tons (4) sont les racines de tous les tons; et de ces quatre
» racines sont engendrées les huit branches, deux branches de chaque racine.
» Le grand nombre de ces tons , leur dérivation les uns des autres, avec la
» diversité de leurs espèces, proviennent du développement des intervalles dont
» nous avons parlé plus haut, et de ce que les uns sont susceptibles de se com-
» biner avec les autres ; car ils résultent nécessairement d’un grand nombre de
» sons : mais il y en a parmi eux qui sont discordans, et d’autres qui sont con-
» cordans. Faites attention à ceci, car il s’agit de la manière dont les maqâmât
» dérivent des racines. Du rast dérivent le tynklâ et Xo’châq (5) ; de l’e’râq, Xhogâ^
» et Xabouseylyk (6); du zyrafkend, le rahâouy (7) et le bouqourk (8) ; et de l’is-
» fàhân, Xhosseyny et le naouà (9).
33 Par cette règle on a douze tons, qu’on appelle maqâmât, qui sont aussi racines
» d’autres maqâmât. Mais ces douze premiers ont, par leur origine, un rapport
33 certain aux douze signes du zodiaque.
33 Le rast, le zenkhî et l’o’châq sont d’un tempérament chaud et sec : ils
33 répondent à l’élément du »feu et à l’humeur de la bile ; et en particulier le
33 rast répond au signe du belier, le zenklâ à celui du lion, et l’o’châq à celui
33 du sagittaire. L’e’râq , l’hogâz et l’abouseylyk ont le tempérament chaud et
33 humide ; ils répondent à l’élément de l’air et à l’humeur du sang : l’e’râq
33 répond aux gémeaux , l’hogâz à la balance , et l’abouseylyk au verseau. Le
» zyrafkend, le rahâouy et le bouzourk ont le tempérament froid et humide,
33 et répondent à l’élément de l’eau et à l’humeur du flegme : le zyrafkend
33 répond à l’écrevisse , le rahâouy au scorpion, et le bouzourk aux poissons.
33 L’isfàhân, l’hosseyny et le naouâ, ont le tempérament froid et sec : ils ré-
33 pondent à l’élément terreux [poudreux J e . t à l’humeur noire, et l’isfahân au
33 signe du taureau, l’hosseyny à la vierge, et le naouâ au capricorne. 33
Il est évident qu’il y a ici plusieurs erreurs commises par la négligence ou
l’ignorance du copiste Arabe; car les modes ne suivent pas, comme ils le devroient,
(1) e'râq : on anom méainsi ce mode pareeque,
dit-on, il a été inventé dans le pays d'E'râq. C’est le même
mot qu’on prononce et qu’on écrit en Europe Irak. (2) lyrajkend, mot Persan.
(3) Asfahân : les Egyptiens prononcent Isfahân,
et les Européens Ispahan ; c’est le nom de la
capitale de la Perse, lieu où l’on prétend que le mode
qui porte ce nom a été inventé. On trouve dans quelques
manuscrits le ton tfisfahân placé avant celui de %y-
rafkend: cette différence existoit-eile dans les opinions
des auteurs, ou est-ce une faute des copistes! c’est ce
qu’il ne nous a pas été possible encore de découvrir.
fai(s4on) sL qeu emlqoute fotoins , edsat nse mlep loseynés idcéi, comme nous le tonique.
É. M.
(5) Nous avons déjà remarqué que o'châq signifioit
amoureux, et que, selon quelques auteurs, il inspiroit le
courage et la valeur. Le ^enklâ, qui dérive cependant
de la même racine, a , suivant ces mêmes auteurs, un
caractère tout opposé; il inspire la tristesse et la mélancolie.
Comm ent peut-il sortir d’une même source des
choses d’une nature si différente ! Le mot ^enklâ signifie tintement.
(6) cîUL^jjÎ abouseylyk,
(7) rahâouy.
(8) bouzourk, grand: ce mot est Persan.
(9) (j'oj naouii, nouveau: ce mot est Persan.