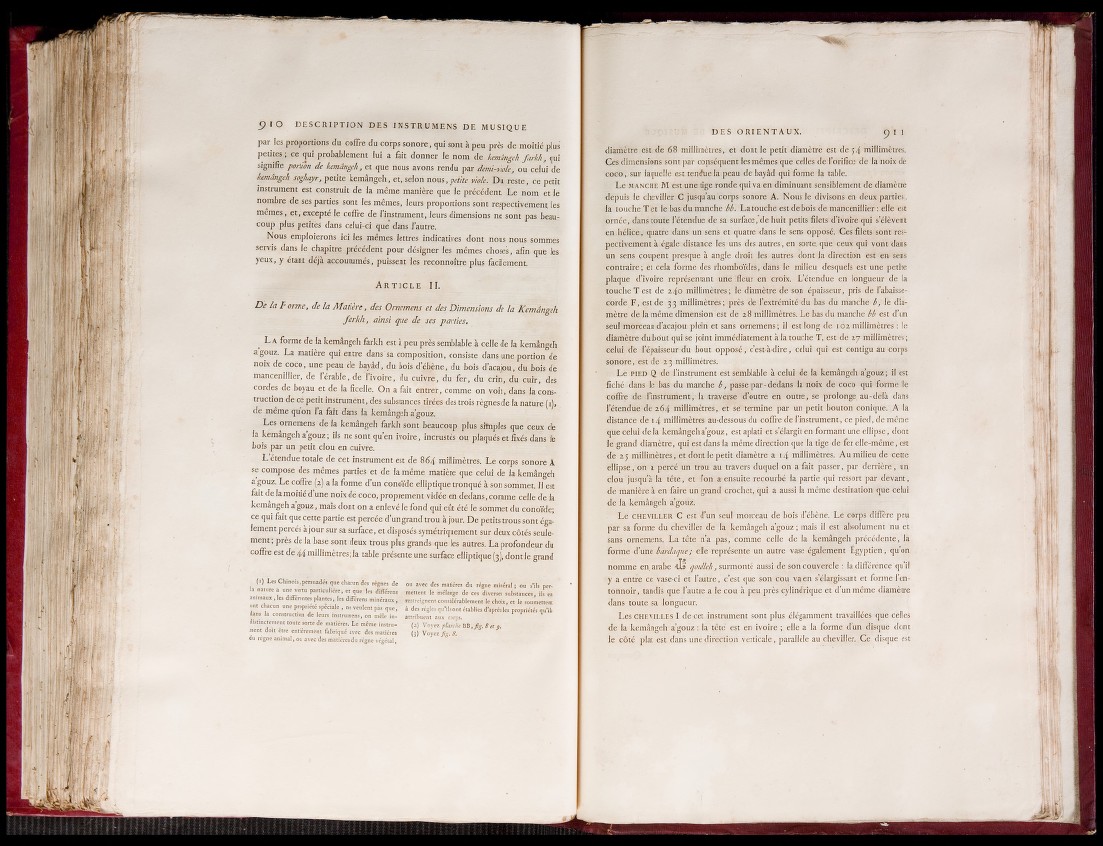
par les proportions du coffre du corps sonore, qui sont à peu près de moitié plus
petites ; ce qui probablement lui a fait donner le nom de kemângeh farkh, qui
signifie portion de kemângeh, et que nous avons rendu par demi-viole, ou celui de
kemângeh soghayr, petite kemângeh, et, selon nous, petite viole. Du reste, ce petit
instrument est construit de la même manière que le précédent. Le nom et le
nombre de ses parties sont les mêmes, leurs proportions sont respectivement les
memes, et, excepte le coffre de l’instrument, leurs dimensions ne sont pas beaucoup
plus petites dans celui-ci que dans l’autre.
Nous emploierons ici les mêmes lettres indicatives dont nous nous sommes
servis dans le chapitre précédent pour désigner les mêmes choses, afin que les
yeux, y étant déjà accoutumés, puissent les reconnoitre plus facilement.
A r t i c l e II.
D e la F orme, de la M atière, des Ornemens et des Dimensions de la Kemângeh
fa rk h , ainsi que de ses parties.
' L a forme de la kemângeh farkh est à peu près semblable à celle de la kemângeh
agouz. La matière qui entre dans sa composition, consiste dans une portion de
noix de coco, une peau de bayad, du bois d’ébène, du bois d’acajou, du bois de
mancenillier, de l’érable, de l’ivoire, du cuivre, du fer, du crm, du cuir, des
cordes de boyau et de la ficelle. On a fait entrer, comme on voit, dans la construction
d eH petit instrument, des substances tirées des trois règnes de la nature (i),
de meme qu on 1 a fait dans la kemângeh a’gouz.
Les ornemens de la kemângeh farkh sont beaucoup plus simples que ceux de
la kemângeh agouz; ils ne sont qu’en ivoire, incrustés ou plaqués et fixés dans le
bois par un petit clou en cuivre.
L étendue totale de cet instrument est de 864 millimètres. Le corps sonore A
se compose des mêmes parties et de la même matière que celui de la kemângeh
agouz. Le coffre (2) a la forme d’un conoïde elliptique tronqué à son sommet. Il est
fait de la moitié d une noix dé coco, proprement vidée en dedans, comme celle de la
kemângeh a gouz, mais dont on a enlevé le fond qui eût été le sommet du conoïde;
ce qui fait que cette partie est percée d’un grand trou à jour. De petits trous sont également
percés à jour sur sa surface, et disposés symétriquement sur deux côtés seulement;
près de la base sont deux trous plus grands que les autres. La profondeur du
coffre est de 44 millimètres ; la table présente une surface elliptique (3), dont le grand
(1) Les C hinois, persuadés que chacun des règnes de ou avec des matières du règne minéral ; ou s’ils perla
nature a une vertu particulière, et que les diffères m ettent le mélange de ces diverses substances, iis en
animaux , les différentes plantes, les différens minéraux , restreignent considérablement le choix, et le soumettent
ont chacun une propriété spéciale , ne veulent pas que, à des règles qu’ils ont établies d’après les darns la construction de leurs instrum ens, on mêle in- attribuent aux corps, propriétés qu’ils
distinctem ent toute sorte de matières. Le même instru- (2) Voyez planche BB >fig. 8 et a. m ent doit être entièremènt fabriqué avec des matières (3) Voyez fig. 8. du régne anim al, ou avec des matières du règne végétal,
diamètre est de 68 millimètres, et dont le petit diamètre est de y4 millimètres.
Ces dimensions sont par conséquent les mêmes que celles de l’orifice de la noix de
coco , sur laquelle est tendue la peau de bayâd qui forme la table.
Le m a n c h e M est une tige ronde qui va en diminuant sensiblement de diamètre
depuis le cheviller C jusqu’au corps sonore A. Nous le divisons en deux parties,
la touche T et le bas du manche bb. La touche est de bois de mancenillier : elle est
ornée, dans toute l’étendue de sa surface, de huit petits filets d’ivoire qui s’élèvent
en hélice, quatre dans un sens et quatre dans le sens opposé. Ces filets sont respectivement
à égale distance les uns des autres, en sorte, que ceux qui vont dans
un sens coupent presque à angle droit les autres dont la direction est en sens
contraire; et cela forme des rhomboïdes, dans le milieu desquels est une pethe
plaque d’ivoire représentant une fleur en croix. L ’étendue en longueur de la
touche T est de 240 millimètres; le diamètre de son épaisseur, pris de i’abaisse-
corde F , est de 33 millimètres; près de l’extrémité du bas du manche b, le diamètre
de la même dimension est de 28 millimètres. Le bas du manche bb est d’un
seul morceau d’acajou plein et sans ornemens; il est long de 102 millimètres : le
diamètre du bout qui se joint immédiatement à la touche T, est de 27 millimétrés ;
celui de l’épaisseur du bout opposé, c’est-à-dire, celui qui est contigu au corps
sonore, est de 23 millimètres.
Le p i e d Q de l’instrument est semblable à celui de la kemângeh a’gouz ; il est
fiché dans le bas du manche b, passe par-dédâns la noix de coco qui forme le
coffre de l’instrument, la traverse d’outre en outre, se prolonge aü-delà dans
l’étendue de 264 millimètres, et se termine par un petit bouton conique. A la
distance de i4 millimètres au-dessous du coffre de l’instrument, ce pied, de même
que celui de la kemângeh a’gouz, est aplati et s’élargit en formant une ellipse, dont
le grand diamètre, qui est dans la même direction que la tige de fer elle-même, est
de 25 millimètres, et dont le petit diamètre a i 4 millimètres. Au milieu de cette
ellipse, on a percé un trou au travers duquel on a fait passer, par derrière, un
clou jusqu’à la tête, et l’on a ensuite recourbé la partie qui ressort par devant,
de manière à en faire un grand crochet, qui a aussi la même destination que celui
de la kemângeh a’gouz.
Le c h e v i l l e r C est d’un seul morceau de bois d’ébène. Le corps diffère peu
par sa forme du cheviller de la kemângeh a’gouz ; mais il est absolument nu et
sans ornemens. La tête n’a pas, comme celle de la kemângeh précédente, la
forme d’une barduque; elle représente un autre vase également Egyptien, qu’on
nomme en. arabe dis qoulleh, surmonté aussi de son couvercle : la différence qu’il
y a entre ce vase-ci et l’autre, c’est que son cou va en s’élargissant et forme l’entonnoir,
tandis que l’autre a le cou à peu près cylindrique et d’un même diamètre
dans toute sa longueur.
Les c h e v i l l e s I de cet instrument sont plus élégamment travaillées que celles
de la kemângeh a’gouz : la tête est en ivoire ; elle a la forme d’un disque dont
le côté plat est dans une direction verticale, parallèle au cheviller. Ce disque est
l i t
U|, ;
M i -