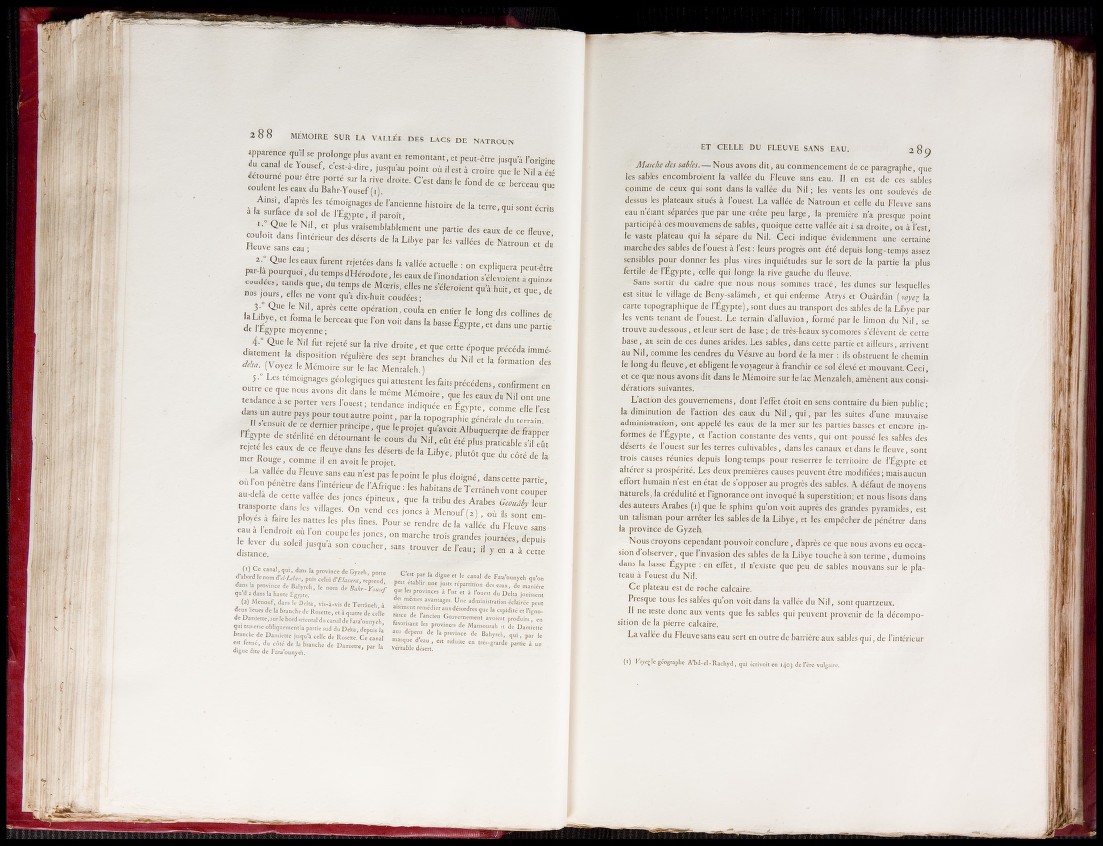
apparence qu'il se prolonge plus avant en remontant, et peut-être jusqua l’origine
du cana de Yousef. c’est-à-dire, jusqu’au point où il est à croire que le N1 a 7 é
détourne pour etre porté sur la rive droite. C ’est dans le fond de ce berceau que
coulent les eaux du Bahr-Yousef (i). erccau que
A,nsi d’après les témoignages de l’ancienne histoire de la terre, qui sont écrits
a la surface du sol de l’Egypte, il paroît, 4
B I S le.,Nii,’ Ct pluS vraiseniblablement une partie des eaux de ce fleuve
z : : , t si : : irieur ^ <li“ m p" 5 P * ( p i * ;
Z.° Q'Ue ,es eaux furent reletées dans la vallée actuelle : on expliquera peut-être
par-la pourquoi, du temps d’Hérodote, les eaux de l’inondation s’élevoient à quinze
nos ioursta I! qUe’ te“ PS dC MoeriS’ dleS ne s’élevoi“ t buit, et que de
nos jours, elles ne vont qua dix-huit coudées; ■
h Ü Que r N il’lapirès cette opération, coula en entier le long des collines de
de^’Égypte moyenne^61063*1 ^°n V°*t ^anS ^ baSSe ^SyPte>et dans une partie
diatemmt'/a S ^ * 8 S i 3 E l “ B Cette éPocTue immé-
B H f c POS,t,°n ^ r rC S SCpt branCheS delta. [Voyez le Mémoire sur le lac Menzaleh.) du Nil et la formation des
y Les témoignages géologiques qui attestent les faits précédens, confirment en
outre ce que nous avons dit dans le même Mémoire, que les eaux du Nil ont une
endance aseporter vers l’ouest; tendance indiquée en Égypte, comme elle l’est
.” d.pr r - M M poiDt- '* ¡K h I I I H Il ensuit de ce dernier principe, que Je projet qu’avoit Alhuquerque de fiapper
Egypte de ster.hte en détournant le cours du Nil, eût été plus praticable s’il eût
rejete les eaux de ce fleuve dans les déserts de la Libye, plutôt que du côté de la
mer Rouge, comme il en avoit le projet.
La vallée du Fleuve sans eau n’est pas le point le plus éloigné, dans cette partie
ou 1 on pénétré dans 1 intérieur de l’Afrique : les habitans de Terrâneh vont couper
-delà de cette vallee des ,oncs épineux, que la tribu des Arabes Geouâby leur
transporte dans les villages. On vend ces joncs à Menouf(2) , où ils somem
p oyés a faire les nattes les plus fines. Pour se rendre de la vallée du Fleuve sans-
eau a 1 endroit ou 1 on coupe les joncs, on marche trois grandes journées depuis
distance. ' ÊÈ " * — > - É | | g y » itZ
p è u T la b T 13 di- ^ Ct-‘e Cana‘ * Fara' ° “ ">"*
dans la province de Bahyreh fe nom de Bahr You 'r ! r .une )USIe rEPanmon des « n a , de manière
qu-il a dans la h,me Egypte. € “ Provinces * ■’«< « à loues, du Delta jouissent
(a) Menouf, dans le Delta, vis-à-vis de Terrâneh à “ ’ a!'a,,'aSes’ Une administration éclairée peut
deux lieues de la branche de Rosette, et à quatredeceÎle ^ ' £»
de D amiette,'sur le bord oriental du canal de Fara’ounyeli favorisant le^ T ' T " ' aV° ,ent Produi,s> aP
qui traverse obliquement la partie sud du D elta, depuis Ja’ aux déDens . P? VlnCeS. e ^ ansourah et de Damiette
branche de Damiette jusqu’à celle de Rosette Ce canal 6 a Provinçe de Bahyreh, qui, par le
ferrn,, du côté d^^branche OE M P * f R |
digue dite de Fara ounyeh.
Marche des sables. — Nous avons dit, au commencement de ce paragraphe, que
les sables encombroient la vallée du Fleuve sans eau. Il en est de ces sables
comme de ceux qui sont dans la vallée du Nil ; les vents les ont soulevés de
dessus les plateaux situés à l’ouest. La vallée de Natroun et celle du Fleuve sans
eau n’étant séparées que par une crête peu large, la première n’a presque point
participé à cesmouvemens de sables, quoique cette vallée ait à sa droite, ou à l’est,
le vaste plateau qui la sépare du Nil. Ceci indique évidemment une certaine
marche des sables de l’ouest à l’est : leurs progrès ont été depuis long-temps assez
sensibles pour donner les plus vives inquiétudes sur le sort de la partie la plus
fertile de l’Ëgypte, celle qui longe la rive gauche du fleuve.
Sans sortir du cadre que nous nous sommes tracé, les dunes sur lesquelles
est situé le village de Beny-salâmeh, et qui enferme Atrys et Ouârdân ( voyez la
carte topographique de l’Égypte), sont dues au transport des sables de la Libye par
les vents tenant de 1 ouest. Le terrain-dalluvion, forme par le limon du Nil, se
trouve au-dessous, et leur sert de base ; de très-beaux sycomores s’élèvent de cette
base, au sein de ces dunes arides. Les sables, dans cette partie et ailleurs, arrivent
àu Nil, comme les cendres du Vésuve au bord de la mer : ils obstruent le chemin
le long du fleuve, et obligent le voyageur à franchir ce sol élevé et mouvant. Ceci,
et ce que nous avons dit dans le Mémoire sur le lac Menzaleh, amènent aux considérations
suivantes.
L’action des gouvernemens, dont l’effet étoit en sens contraire du bien public;
la diminution de l’action des eaux du Nil, qui, par les suites d’une mauvaise
administration, ont appelé les eaux de la mer sur les parties basses et encore informes
de l’Égypte, et l’action constante des vents, qui ont poussé les sables des
déserts de l’ouest sur les terres cultivables, dans les canaux et dans le fleuve, sont
trois causes réunies depuis long-temps pour resserrer le territoire de l’Égypte et
altérer sa prospérité. Les deux premières causes peuvent être modifiées ; mais aucun
effort humain n’est en état de s’opposer au progrès des sables. A défaut de moyens
naturels, la crédulité et l’ignorance ont invoqué la superstition; et nous lisons dans
des auteurs Arabes (1) que le sphinx qu’on voit auprès des grandes pyramides, est
un talisman pour arrêter les sables de la Libye, et les empêcher de pénétrer dans
la province de Gyzeh.
Nous croyons cependant pouvoir conclure, d’après ce que nous avons eu occasion
d observer, que 1 invasion des sables de la Libye touche à son terme, du moins
dans la basse Égypte : en effet, il n’existe que peu de sables mouvans sur le plateau
à l’ouest du Nil.
Ce plateau est de roche calcaire.
Presque tous les sables qu’on voit dans la vallée du Nil, sont quartzeux.
Il ne reste donc aux vents que les sables qui peuvent provenir de la décomposition
de la pierre calcaire.
La vallee du Fleuve sans eau sert en outre de barrière aux sables qui, de l’intérieur
(1) Voyez le géographe A b d - e l -R a c h y d , qui écrivoit en 1403 de I’ère vulgaire.