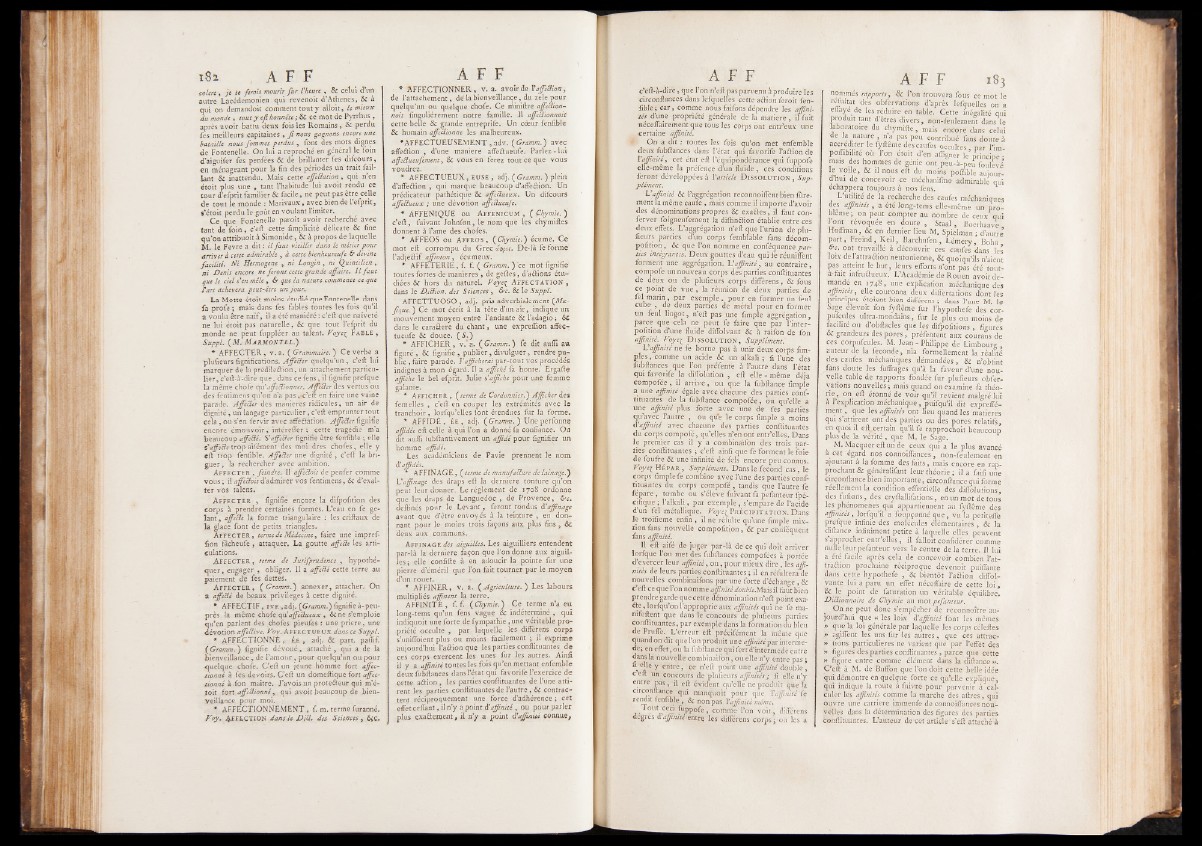
colère, je te ferois mourir fur Cheure , & celui d’un
autre Lacédémonien qui revenoit d’Athenes, & a
qui on demandoit comment tout y alloit, le mieux
du monde , tout y ejl honnête ; & ce mot de Pyrrhus,
après avoir battu deux fois les Romains, & perdü
{es meilleurs capitaines , j i nous gagnons encore une
bataille nous fommes perdus , font des mots dignes
de Fontenelle. On lui a reproché en général le foin
d’aiguifer fes penfées & de brillanter fes dilcôurs,
en ménageant pour la fin des périodes üri trait, fail-
lant & inattendu. Mais cette affectation, qui n’en
étoit plus une , tant l’habitude lui a voit rendu ce
tour d’efprit familier & facile, ne peut pas être celle
de tout le monde : Marivaux, avec bien de l’efprit,
s’étoit perdu le goût en voulant l’imiter. ^
Ce que Fontenelle paroît avoir recherché avec
tant de foin , c’eft cette fimplicité délicate & fine
q u ’on attribuoit à Simonide, & à propos de laquelle
M. le Fevre a dit : il faut vieillir dans le métier pour
•arriver à cette admirable , à cette bienheureufe & divine
facilite. Ni Hermogene , ni Longin , ni Quintilien ,
ni Denis encore ne feront cette grande affaire. I l faut
que le ciel s'en mêle , & que la nature commence ce que
fart achèvera peut-être un jour.
La Motte étoit moins étudié que Fontenelle dans
fa profe ; mais dans fes fables toutes les fois qu’il
a voulu être naïf, il a été maniéré : c’eft que naïveté
ne lui étoit pas naturelle, & que tout l’efprit du
monde ne peut fuppléer au talent. Voyei Fable ,
Suppl. {M. M ARMONT EL.j
* AFFECTER , v. a. ( Grammaire. ) Ce verbe a
plufieurs fignifications. Affecter quelqu’un , c’eft lui
marquer de la prédilection, un attachement particulier,
c’eft-û-dire que. dans ce fens, il lignifie prefque
la même chofe qu'affectionner. Affecter des vertus ou
des fentimens qu’on n’a pas c’eft en faire une vaine
parade. Affecter des maniérés ridicules, un air de
dignité, un langage particulier, c’eft emprunter tout
c e la , ou s’en fervir avec affeCtàtion. Affecter fignifie
encore émouyoir, intéreffer ; .cette tragédie m'a
beaucoup affecté. S'affecter fignifie être fenfible ; elle
f affecte trop aifément des moindres chofes, elle y
e ft trop fenfible. Affecter une dignité , c’eft la briguer,
la rechercher avec ambition.
Affecter , feindre. Il affectait de penfer comme
vous; il affectoitd’admirer vos fentimens, & d’exalter
vos talens.
Affecter , fignifie encore la difpofition des
corps à prendre certaines formes. L’eau en fe gelant
, affecte la forme triangulaire : les criftaux de
la glace, font de petits triangles.
Affecter, terme de Médecine, faire une impref-
fion fâcheufe, attaquer. La goutte affecte les articulations.
AFFECTER, terme de Jurifprudence , hypothéquer
, engager , obliger. Il a affecté cette terre au
paiement de fes dettes.
Affecter, {Gramm.) annexer, attacher. On
a affecté de beaux privilèges à cette dignité.
* AFFECTIF, ivF. ,adj, (Gramm.j fignifie â-peu-
près la même chofe qu'affectueux , & ne s’emploie
qu’en parlant des chofes pieufes : une priere, une
dévotion affective. Voy. AFFECTUEUX dans ce Suppl.
* AFFECTIONNÉ, £e , ad). & part, paflif.
( Gramm. ) fignifie dévoué., attaché , qui a de la
bienveillance, de l’amour, pour quelqu’un ou pour
quelque chofe. C ’eft un jeune homme fort affectionné
à fes devoirs. C ’eft un domeftique fort affectionné
à.fon maître. J’avoisun protecteur qui m’é-
îoit fort affectionné, qui avoit beaucoup de bienveillance
pour moi.
* AFFECTIONNEMENT, f. m. terme furanné.
Voy. Affection dans U Diiï. des Sciences, Ôéc.
* AFFECTIONNER, v. a. avoir de l’affection,
de l’attachement, de* la bienveillance, du zele pour
quelqu’un ou quelque chofe. Ce miniftre affection-
noit finguliérement notre famille. Il affectionnait
cette belle & grande entreprife. Un coeur fenfible
& humain affectionne les malheureux.
♦ AFFECTUEUSEMENT , adv. {Gramm.) avec
affettion , d’une maniéré affeftueufe. Parlez - lui
affectueuftment, &c vous en ferez tout ce que vous
voudrez.
* AFFECTUEUX, EUSE , ad). {Gramm. ) plein
d’affe&ion , qui marque beaucoup d’affedion. Un
prédicateur pathétique & affectueux. Un difeours
affectueux ; une dévotion affeclueufe.
* AFFENIQUE ou Affenicum , ( Çhymie. )
c’eft, fuivant Johnfon, le nom que les chymiftes
donnent à l’ame des chofes.
* AFFEOS ou Affros, {Chymie.) écume. Ce
mot eft corrompu du Grec açpoç. De-là fe forme
l’adjedif affroton, écumeux.
* AFFETERIE, f. f. ( Gramm.')'ce mot fignifie
toutes fortes de maniérés , de geftes, d’adions étudiées
& hors du naturel. Voye^ Affectation ,
dans le Diction, des Sciences , &c. & le Suppl.
A FFETTUOSO, ad), pris adverbialement {Ma-
Jîque.) Ce mot écrit à la tête d’un air, indique un
mouvement moyen entre l’andante & l’adagio; &
dans le caradere du chant, une expreflion affec-
tueufe & douce. («S*.)
* AFFICHER , v / a . {Gramm.) fe dit auffi aa
figuré , & fignifie , publier, divulguer, rendre pub
lic, faire parade. Vafficherai par-tout vos procédés
indignes à mon égard. Il a affiché fa honte. Ergafte
affiche le bel efprit. Julie s’affiche pour une femme
galante.
* AFFICHER , {terme de Cordonnier.) Afficher des
femelles , c’eft en couper les extrémités avec le
tranchoir, lorfqu’elles font étendues fur la forme.
* AFFIDÉ, ée , ad). {Gramm.) Une perfonne
affidée eft celle à qui l’on a donné fa confiance. On
dit auffi lubftantivement un affidé pour fignifiçr un
homme affidé.
Les académiciens de Pavie prennent le nom
d’affidés. , _ . , ' ,
* AFFINAGE, ( terme de manufacture de lainage.)
L’affinage des draps eft la derniere tonture qu’on
peut leur donner. Le réglement de 170& ordonne
que les draps de Languedoc , de Provence, &c.
deftinés pour le Levant, feront tondus d'affinage
avant que d’être envoyés à la teinture , en don-
; nant pour le moins trois façons aux plus fins, &
| deux aux communs.
Affinage^ aiguilles. Les aiguilliers entendent
par-là la-derniere façon que l’on donne aux aiguilles;
elle confifte à en adoucir la pointe fur une
pierre d’éméril que l’on fait tourner par le moyen
d’un rouet.
* AFFINER, v. a. {Agriculture.) Les labours
multipliés affinent la terre.
AFFINITÉ, f. f. {Chymie.) Ce terme n’a eu
long-tems qu’un fens vague & indéterminé , qui
indiquoit une forte de fympathie ,une véritable propriété
occulte , par laquelle les différens corps
s’uniffoient plus ou moins facilement ; il exprime
aujourd’hui l’action que les parties conftituantes de
ces corps exercent les unes fur les autres. Ainli
i l y a affinité toutes les fois qu’en mettant enfemble
deux fubftances dans l’état qui favorife l ’exercice de
cette adion , les parties cqnftituantes de l’une attirent
les parties conftituantes de l’autre, & contractent
réciproquement une force d’adhérence ; cet
effet ceffant, il n’y a point $ affinité , ou pour parler
plus exactement, il n’y a point d’affinité connue,
c’éft-à-dire, que l’on n’eft pas parvenu à produire les
■ circonftances dans lefquelles cette action ïeroit fen-
lible; car, comme nous faifons dépendre les affinités
d’une propriété générale de la matière , il luit
néceffairement que toits les corps ont entr’eux une
certaine affinité.
* On a dit : toutes les fois qu’on met enfemble
deux fubftances dans l’état qui favorife l’adion de
Vaffinité, cet état eft l’équipondérance qui fuppofe
elle-même la préfence d’un fluide , ces conditions
feront développées à l’article Dissolution , Supplément.
L'affinité & l’aggrégation reconnoiffent bien fûre-
ment la même caufe , mais comme il importe d’avoir
des dénominations propres & exactes, il faut con-
ferver foigneufement la diftindion établie entre ces
deux effets. L ’aggrégation n’eft que l’union de plusieurs
parties, d’un corps femblâble fans décom-
pofition, & que l’on nomme en conféquence parties
intégrantes. Deux gouttes d’eau qui fe réunifient
forment une aggrégation. L'affinité, au contraire,
compofe un nouveau corps des parties conftituantes
de deux ou de plufieurs corps différens, & fous
ce point de vue , la réunion de deux parties de
• fçl marin, par exemple, pour en former un feul
cube , de deux parties de métal pour en former
un feul lingot, n’eft pas une fimple aggrégation,
parce que cela ne peut fe faire que par l ’inter-
pofition d’une fluide diffolvant & à raifon de fon
affinité. Voyeç DISSOLUTION, Supplément
L'affinité ne fe borne pas à unir deux corps Amples
, comme un acide & un alkali ; fi l’une des
fubftances que l’on préfente à l’autrè dans l’état
qui favorife la diffolution , eft elle - même déjà
compofee, il arrive, ou que la fubftance fimple
a une affinité égale avec chacune des parties conftituantes
de la fubftance compofée, ou qu’elle a
une affinité plus forte avec une de fes parties
qu’avec l’autre , ou que le corps fimple a moins
d'affinité avec chacune des parties conftituantes
du corps compofé, qu’elles n’en ont entr’elles. Dans
le premier cas il y a combinaifon des trois parties
conftituantes ; c’eft ainfi que fe forment le foie
de foufre & une infinité de fels encore peu connus.
Voye{ Hépar , Supplément. Dans le fécond cas , le
corps fimple fe combine avec l’une des parties conftituantes
du corps compofé, tandis que l’autre fe
fépare, tombe ou s’élève fuivant fa pefanteur fpé-
eifique ; l’alkali, par exemple, s’empare de l’acide
d’un fel métallique. Voye^ Précipitation. Dans
k troifieme enfin, il ne réfulte qu’une fimple mixtion
fans nouvelle compofition, & par confisquent
fansaffinité.
Il eft aifé de juger par-là de ce qui'doit arriver
lorfque l’on met des fubftances compofées à portée
d’exercer leur affinité, ou, pour mieux dire, les affinités
de leurs parties conftituantes ; il en réfultera de
nouvelles combinaifons par une forte d’échange , &
c eft ce que l’on nomme affinité double.Nizis il faut bien
prendre garde que cette dénomination n’eft point exa-
éle, lorfqü’on l’approprie aux affinités qui ne fe ma-
nifeftent que dans le concours de plufieurs parties
conftituantes, par exemple dans la formation du bleu
de Pruffe. L’erreur eft précifément la même que j
quand on dit qüe l’on produit une affinité par intermède;
en effet, ou la fubftance qui fert d’intermedë entre
dans la nouvelle combinaifon, ou elle n’y entre pas ;
|®3 £ÿj entre, ce n’eft poirit une affinité double ,
ceft un concours de plufieurs affinités ; fi elle n’y
entre pas, il eft évident qu’elle ne produit que la
arconftance qui manquôit pour que Vaffinité fe
rendu fenfible , & non pas Y affinité même.' '
Tout ceci fuppofe j comme"l’on voit-, différens
degies d affinité-emts les différens corps;-on tes a
nommés rapports, & l’on trouvera fous ce mot le
r™ lt?t des obfervations d’après lefquelles on a
ellayc de les réduire en table. Cette inégalité qui
produit tant d’êtres divers, non-feulement dans le
laboratoire du chymifte, mais encore dans celui
■ de la nature , a i pas peu contribué fans doute à
aCC£L-!?e.r ? ées caufes occultes , par l’impoffibihte
ou l’on étoit d’en affigner le principe;
mais des hommes de genie ont peu-à-peu foulevé
f f i n B R & ü nous eft du moins poffible aujour-
dhui de concevoir ce méchanifnie admirable qui
échappera toujours à nos fens.
L’utilité de la recherche des caufes méchaniques
des affinités , a été long-tems elle-même un problème;
on peut compter au nombre de ceux qui
l ’ont révoquée en doute , Staal , Boerhaave .
Hoffman, & en dernier lieu M. Spielman ; d’autre
part, Freind, K e il, Barchufen, Lémery, Bohn
6c. ont travaillé à découvrir ces caufes dans les
loix de Battra&ion neutonienne, & quoiqu’ils n’aient
pas atteint le but, leurs efforts n’ont pas été tout-
à-fait infruftueux. L Academie de Rouen avoit demandé
en 1748, une explication méchanique des
affinités, elle couronna deux diflertations dont les
principes étoient bien différens; dans Tune M. le
Sage élevoit fon fyftême fur l’hypothefe des cor-
pufcules ultra-mondains, fur le plus ou moins de
facilité ou d’obftacles que les difpofitions , figures
& grandeurs des p ores, préfentent aux courans de
ces corpufcules. M. Jean - Philippe de' Limbourg ,
auteur de la fécondé, nia formellement la réalité
des caufes méchaniques démandées, & n’obtint
fans douté les fuffrages qu’à la faveur d’une nouvelle
tablé de rapports fondée fur plufieurs obfer-
yations nouvelles ; mais quand on examine fa théor
ie , on eft étonné de voir qu’il revient malgré lui
à l’explication méchanique, puifqu’il dit exprefie-
mênt, que les affinités ont lieu quand les matières
qui s’attirent ont des parties ou des pores relatifs,
en quoi il eft. certain qu’il fe rapprochoit beaucoup
plus de la v é r ité , que M. le Sage.
M. Macquer eft un de _ ceux qui a le plus avancé
a cet égard nos connoiffances, non-feulement en
ajoutant à la fomme des faits, mais encore en rapprochant
& généralifant leur théorie ; il a faifi une
cirçonftance bien importante, circonftance qui forme
réellement la condition effentielle des diflolutions
des fufions, des cryftallifations, en un mot de tous
les phénomènes qui appartiennent au fyftême des
affinités, lorfqu’il a foupçonné que, vu la petiteffe
préfqùë infinie -des molécules élémentaires , & la
diftance infiniment petite à laquelle elles peuvent
s’approcher entr’elles, il falloit confidérer comme
nüllë.leur pefanteur vers le centre de la terre. Il lui
a été facile après cela de concevoir combien l’at-
traâion prochaine réciproque devenoit puiftante
dans cette hypothefe , & bientôt l’a&ion diffol-
vante lui a paru un effet néceflaire de cette lo i ,
& le point de faturation un véritable équilibre.
Dictionnaire de Chymie au mot pefanteur.
On ne peut donc s’empêcher de reconnoître aujourd’hui
que « les loix d'affinité font les mêmes
» que la loi générale par laquelle les corps céleftes
» agiflent les uns fur les autres, que ces attrac-
» fions particulières ne varient que par l’effét des
» figures des parties conftituantes , parce que cette
» figure entre comme élément dans la diftance ».
C ’eft à M. de Buffon que l’on doit cette belle idée
qui démontre en quelque forte ce qu’elle explique,
qui indique la route à fuivre pour parvenir à calculer
les affinités comme la marche des aftres, qui
ouvre une carrière immenfe de connoiffances nouvelles
dans la détermination des figures des parties
conftituàntës. L’auteur de-cet article ' s’eft attaché à