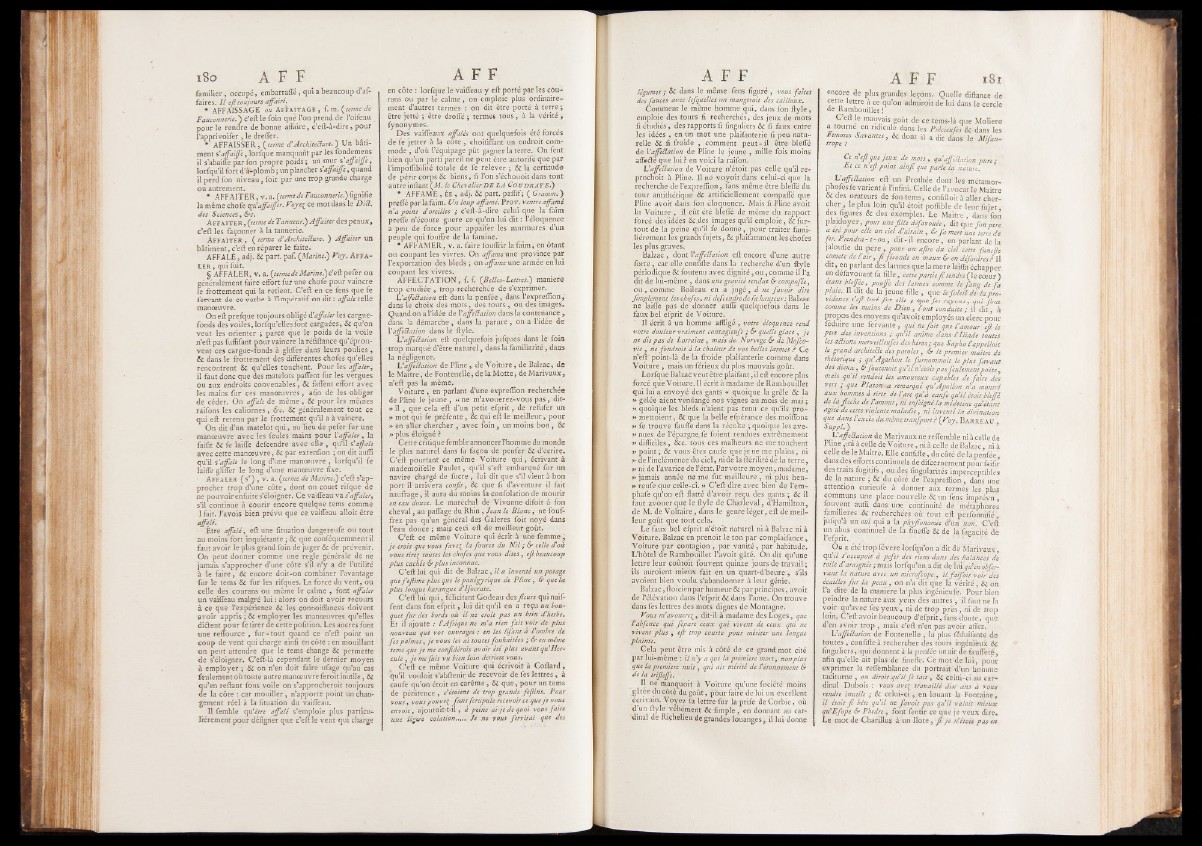
familier, occupé, embarraffé , qui a beaucoup d affaires.
I l ejl toujours affairé.
* AFFAISSAGE ou Affaitage , f. m. {terme de
Fauconnerie.') c’eft le foin que l’on prend de l’oifeau
pour le rendre de bonne affaire, c’eft-à-dire, pour
l’apprivoifer, le dreffer.
* AFFAISSER, ( terme £ Architecture. ) Un batiment
s'affaiffe , lorfque manquait par les fondemens
il s’abaiffe par fon propre poids ; un mur s'affaifft,
lorfqu’il fort d’à-plomb ; un plancher s'affaifft y quand
il perd fon niveau, foit par une trop grande charge
ou autrement.
* AFFAITER, v . a. (terme de Fauconnerie.) lignifie
la même chofe qu'affaiffer. V>yt£ te mot dans le Dict.
des Science s, &c.
Affaiter, (terme de Tanneur.) Affaiter des peaux,
c’eft les façonner à la tannerie.
Affaiter , ( terme £ Architecture. ) Affaiter un
bâtiment, c’eft en réparer le faîte.
AFFALÉ , adj. & part. paf. (Marine.) Voy. Affaler
, qui fuit.
§ AFFALER, v . a. (termede Marine.)c’eft pefer ou
généralement faire effort fur une chofe pour vaincre
le frottement qui la retient. C’eft en ce fens que fe
fervant de ce verbe à l’impératif on dit : affale telle
manoeuvre.
On eft prefque toujours obligé £ affaler Xts cargue-.
fonds des voiles, lorfqu’elles font carguées, & qu’on
veut les orienter ; parce que le poids de la voile
n’eft pas fuffifant pour vaincre la réfiftance qu’éprou-
vènt ces cargue-fonds à gliffer dans leurs poulies,
& dans le frottement des différentes chofes qu’elles
rencontrent & qu’elles touchent. Pour les affaler,
il faut donc que des matelots paffent fur les vergues
ou aux endroits convenables, & faffent effort avec
les mains fur ces manoeuvres, afin de les obliger
de céder. On affale de même , & pour les mêmes
raifons les caliornes , &c. & généralement tout ce.
qui eft retenu par le frottement qu’il a à vaincre.
On dit d’un matelot qui, au lieu de pefer fur une
manoeuvre avec les feules mains pour Vaffaler, la
faifit & fé laiffe defeendre avec elle , qu’il s'affale
avec cette manoeuvre, & par extenfion ; on dit aufli
qu’il s'affale le long d’une manoeuvre , lorfqu’il fe
laiffe gliffer le long d’une manoeuvre fixe.
Affaler ( s ’ ) , V. a. (terme de Marine.) c’eft s’approcher
trop d’une cô te, dont on court rifque de
ne pouvoir enfuite s’éloigner. Ce vaiffeau va s'affaler,
s’il continue à courir encore quelque tems comme
1 fait. J’avois bien prévu que ce vaiffeau alloit être
affalé.
Être affalé, eft une fituation dangereufe ou tout
au moins fort inquiétante ; & que conféquemment il
faut avoir le plus grand foin de juger & de prévenir.
On peut donner comme une réglé générale de ne
jamais s’approcher d’une côte s’il n’y a de l’utilité à le faire, & encore doit-on combiner l’avantage
fur le tems & fur les rifques. La force du vent, ou
celle des courans ou même le calme , font affaler
un vaiffeau malgré lui : alors on doit avoir recours
à ce que l’expérience & les connoiffances doivent
avoir appris. ; & employer les manoeuvres qu’elles
dictent pour fe tirer de cette pofition. Les ancres font
une reffource , fur-tout quand ce n’eft point un
coup de vent qui charge ainfi en côte : en mouillant
on peut attendre que le tems change & permette
de s’éloigner. C ’eft-là cependant le dernier moyen
à employer ; & on n’en doit faire ufage qu’au cas
feulement où toute autre manoeuvre feroit inutile, &
qu’en reftant fous voile on s’approcheroit toujours
de la côte : car mouiller, n’apporte point un changement
réel à la fituation du vaiffeau.
11 femble qu'être affalé s’emploie plus particuliérement
pour défigner que c’eft: le vent qui charge
en côte : lorfque le vaiffeau y eft porté par les cou-
rans ou par le calme, on emploie plus ordinairement
d’autres termes : on dit être porté à terre ;
être jetté ; être droffé ; terme« tou s, à la vérité ,
fynonymes.
Des vaifl'eaux affalés ont quelquefois été forcés
de fe jetter à la côte , choififfant un endroit commode
, d’où l’équipage pût gagner la terre. On fent
bien qu’un parti pareil ne peut être autorifé que par
l’impoflibilité totale de fe relever ; & la certitude
de périr corps & biens, fi l’on s’échouoit dans tout
autre inftant (M . le Chevalier DE LA Co u d r a y e .)
* AFFAMÉ , ÉE , adj. & part, paflif; ( Gramm. )
preffé par la faim. Un loup affamé. Prov. ventre affamé
n'a point d'oreilles ; c’eft-à-dire celui que la faim
preffe n’écoute guere ce qu’ on lui dit : l’éloquence
a peu de force pour appaifer les murmures d’un
peuple qui fouffre de la famine.
* AFFAMER, v. a. faire l'ouffrir la faim, en ôtant
ou coupant les vivres. On affame une province par
l’exportation des bleds ; on affame une armée en lui
coupant les vivres.
AFFECTATION, f. f. (Belles-Lettres.) maniéré
trop étudiée , trop-recherchée de s’exprimer.
L’affectation eft dans la penfée, dans l’expreflion,’
dans le choix des mots, des tours, ou des images.
Quand on a l’idée de l'affectation dans la contenance ,
dans la démarche, dans la parure, on a l’idée de
l’affectation dans le ftyle.
L'affectation eft quelquefois jufques dans le foin
trop marqué d’être naturel, dans la familiarité, dans
la négligence.
L'affectation de Pline , de Voiture , de Balzac, de
le Maitre, de Fontenelle, de la M otte, de Marivaux,
n’eft pas la même.
Voiture, en parlant d’une expreflion recherchée
de Pline le jeune , « ne m’avouerez-vous pas, dit-
» il , que cela eft d’un petit efprit, de refufer un
» mot qui fe préfente, & qui eft le meilleur, pour
» en aller chercher , avec loin , un moins b on , 6c
» plus éloigné ?
Cette critique femble annoncer l’homme du monde
le plus naturel dans fa façon de penfer & d’écrire.
C ’eft pourtant ce même Voiture q u i, écrivant à
mademoifelle Paulet, qu’il s’eft 'embarqué fur un
navire chargé de fucre, lui dit que s’il vient à bon
port il arrivera confit, & que fi d’aventure il fait
naufrage, il aura du moins la confolation de mourir
en eau douce. Le maréchal de Vivonne difoit à fon
cheval, au paffage du Rhin, Jean le Blanc, ne fouf*
frez pas qu’un général des Galeres foit noyé dans
l’eau douce ; mai? ceci eft de meilleur goût.
C’eft ce même Voiture qui écrit à une femme,'
je crois que vous favez la fource du Nil ; 6* celle £oit
vous tirez toutes les chofes que vous dites, eft beaucoup
plus cachée & plus inconnue.
C ’eft lui qui dit de Balzac, il a inventé un potage
que j'tjlime plus que le panégyrique de Pline, & que la
plus longue harangue d'Ifocrate.
C ’eft lui qui, félicitant Godeau des fleurs qui naif-
fent dans fon efprit, lui dit qu’il en a reçu un bouquet
fur des bords ou il ne croît pas un brin d'herbe.
Et il ajoute : P Afrique ne nia rien fait voir de plus
nouveau que vos ouvrages : en les lifant a L'ombre de
fes palmes, je vous les ai toutes fouhaitées ; & en même
tems que je me confidérois "avoir été plus avant qu Hercule
, je me fuis vu bien loin derrière vous.
C’eft ce même Voiture qui écrivoit à Coftard,
qu’il vouloit s’abftenir de recevoir de fes lettres, à
caufe qu’on étoit en carême, & que, pour un tems
de pénitence , d étaient de trop grands feflins. Pour
vous, vous pouve^ fans fcrupule recevoir ce que je vous
envoie, ajoutoit-t-il, a peine ai-je de quoi vous faire
une légère cotation..... Je ne vous fervirai que des
légumes ; & dans le même fens figuré , vous faites
des fauces avec lefquelles on mangtroit des cailloux.
Comment le même homme qui, dans fon fty le ,
emploie des tours fi recherchés, des jeux de mots
fi étudiés, des rapports fi finguliers & fi faux entre
les idées , en un mot une plaifanterie fi peu naturelle
6c fi froide , comment p eu t - il être bleffé
de l'affectation de Pline le jeune , mille fois moins
affe&é que lui ? en voici la raifon.
L’affectation de Voiture n’étoit pas celle qu’il reprochoit
à Pline. Il né voyoit dans celui-ci que la
recherche de l’expreflion, fans même être bleffé du
tour antithétique & artificiellement compaffé que
Pline avoit dans fon éloquence. Mais fi Pline avoit
lu Voiture , il eût été bleffé de même du rapport
forcé des idées &„des images qu’il emploie , & fur-
tout de la peine qu’il fe donne, pour traiter familièrement
les grands fujets, & plaifamment les chofes
les plus graves,
Balzac , dont Vaffectation eft encore d’une autre
forte, car elle confifte dans la recherche d’un ftyle
périodique 6c foutenu avec dignité, o u , comme il l’a
dit de lui-même , dans une gravité tendue & compofée,
o u , comme Boileau en a ju g é, à ne f avoir dire
fimplement les chofes, ni defeendre de fa hauteur; Balzac
ne laiffe pas de donner aufli quelquefois dans le
faux bel efprit de Voiture.
Il écrit à un homme affligé , votre éloquence rend
votre douleur vraiment contugieufe ; & quelle glace , je
ne dis pas de Lorraine, mais de. Norvège & de Mof co-
vie , ne f endroit à la chaleur de vos belles larmes ? Cë
n’eft'point-là de la froide plaifanterie comme dans
Voiture , mais un férieux du plus mauvais goût.
Lorfque Balzac veut être plaifant, il eft encore plus
forcé que Voiture. Il écrit à madame de Rambouillet
qui lui a envoyé des gants « quoique la grêle & la
» gelée aient vendangé nos vignes au mois de mai ;
» quoique les bleds n’aient pas tenu ce qu’ils pro-
» mettoient, & que la belle efpérance des moiffons
» fe trouve fauffe dans la récolte ; quoique les ave-
>> nues de l’ëpargne^fe foient rendues extrêmement
» difficiles, &c. toiis ces malheurs ne me touchent
» point ; 6c vous êtes caufe que je ne me plains, ni
» de l’inclémence du ciel, ni de la ftérilité de la terre,
» ni de l’avarice de l’état. Par votre m oyen, madame,
» jamais année ne me fut meilleure , ni plus heu-
» reufe que celle-ci. » C ’eft dire avec bien de l’em-
phafe qu’on eft flatté d’avoir reçu des gants ; & il
faut avouer que le ftyle de Charleval, d’Hamilton,
de M. de Voltaire, dans le genre léger, eft de meilleur
goût que tout cela.
Le faux bel efprit n’étôit naturel ni à Balzac ni à
Voiture. Balzac en prenoit le ton par complaifance,
Voiture par contagion, par vanité, par habitude.
L ’hôtel de Rambpuillet l’avoit gâté. On dit qu’une
lettre leur çoûtoit fouvent quinze jours de travail ;
ils auroient mieux fait en un quart-d’heure , s’ils
avoient bien voulu, s’abandonner à leur génie.
Balzac, ftoïcien par humeur 6c par principes, avoit
de l’élévation dans l’efprit 6c dans l’ame. On trouve
dans fes lettres des mots dignes de Montagne.
V jus m'avouerez, dit-il à madame des Loges, que
tabfence qui fépare ceux qui vivent de ceux qui ne
vivent plus , eft trop courte pour mériter une longue
plainte.
Cela peut être mis à côté de ce grand mot cité
par lui-même : i l n y a que la première mort, non plus !
que la première nuit, qui ait mérité de létonnement &
de la trifleffe.
Il ne manquoit à Voiture qu’une fociété moins
eâtee du côté du goût, pour faire de lui un excellent
écrivain. Voyez fa lettre fur la prife de Corbie, où
d’un ftyle véhément 6c fimple , en donnant au cardinal
de Richelieu de grandes louanges, il lui donne
encore de plus grandes leçons. Quelle diffance de
cette lettre à ce qu’on admirait de lui dans le cercle
de Rambouillet !
C eil le mauvais goût de ce tems-là que Moliere
a tourné en ridicule dam les Pricuufcs & dans les
Femmes Savantes, & dont -il a dit dans le Mifan-
trope: J
Ce n’efi que jeu x de mots, qu'affeélation pure;
E t ce n efi point ainfi que parle la nature.
. -------------------— c . . i V u » ,x a v u t . (u icm d n r e
OC des orateurs de fon tems, confiftoit à aller chercher
, le plus loin qu’il étoit poflible de leur furet,
desfigures & des exemples. Le Maitre , dans fon
plaidoyer, pour une fille défiavouée, dit que fon pere
a ete pour elle un ciel £ airain , & fa mere une terre de
fer. Prendra-1-on, dit-il encore , en parlant de la
jaloüfie du pere , pour un afire du ciel cette fuhefle
comete de Pair, f i féconde en maux & en défiordres? Il
dit, en parlant des larmes que la mere làifla échapper
en defavouant fa fille, cette partie f i tendre ( le coeur )
étant Jleffee, pouffe des larmes comme le fang de fa
plaie. Il dit de la jeune fille , que le foleil de-la providence
s efi lève fu r elle ; que fes rayons, qûi font
comme les mains de D ieu , l'ont conduite ; il d it , à
propos des moyens qu’avoit employés un clerc pour
féduire une fer vante, qui ne fait que l'amour efi le
pere des inventions ; qu'il anime dans L'Iliade toutes
les délions merveilleufes dés héros; que Sapho l'appelloit
le grand architecte des paroles, & le premier maître de
rhétorique; qu'Agathon le furnommoit le plus f avant
des dieux, & foutenoit qu'il nétoit pas feulement poète ,
mais qu'il rendoit les amoureux capables de faire des
vers ; que Platon .a remarqué qu'Apollon n'a montré
aux hommes à tirer de l'arc qu'à caufe q£il étoit bleffé
de làjleçhe de P amour, ni enfeigné la médecine qu!étant
agité de cette viofente maladie, ni inventé là divination
que dans P excès du même tranfport ? (Voy. Barreau
Suppl.)
XJ affectation de Marivaux ne reffemble ni à celle de
Pline ,*,ni à c e l le de Voiture, ni à celle de Balzac ni à
celle de le Maitre. Elle confifte, du côté de la penfée,
dans des efforts continuels de difeernementpourfaifir
des traits fugitifs , ou des A n g u la r ité s imperceptibles
de la nature ; & ' du côté de l’expreflîon , dans une
attention curieufe à donner aux termes les plus
communs une place nouvelle & un fens imprévu ,
fouvent aufli dans une continuité de métaphores
familières & recherchées oîi tout eft perfônnifié,,
jufqu’à un oui qui a la pkyfionomie d’uri non. C ’eft
un abus continuel dé la fineffe & de là fagacité de
l’efprit.
On a été trop févere lorfqu’on a dit de Marivaux,
qu’i/ s'occupait à pefer des riens dans des b'alàhçes de
toile d’araignée; mais lorfqu’on.a dit de liii qu'enobfer-
vùnt la nature avec un microfcope , ilfaîfoit voir dès
écailles fur la peau , on n’a dit que la vérité, & on
l’a dite de la maniéré la'plus ingénieufe. Pour bien
peindre la nature aux yeux des autres , il faut ne la
voir qu’avec fes yeux , ni de trop p rès, ni de trop
loin, C ’eft avoir beaucoup d’efprit, fans doute, que
d’en avoir trop , mais c’eft n’en pas avoir affez.
XJaffectation de Fontenelle , là plus féduifante de
toutes , confifte à rechercher des tours ingénieux 6c
finguliers, qui donnent à la penfée un air de fauffeté,
afin qu’elle ait plus de fineffe. Ce mot de lui, pour
exprimer la reffemblance du portrait ~d?un homme
taciturne , on diroit qu'il fe tait, 6c Cèlui-ci a u cardinal
Dubois : vous avez travaillé dix ans à vous
rendre inutile ; & celui-ci, en louant la Fontaine,
i l étoit f i bête qu'il ne f avoit pas qu'il valoit mieux
qu'Efope & Phedre, font fentir ce que jé veux dire.
Le mot de Charillus à un Ilote, f i je n'étois pas en