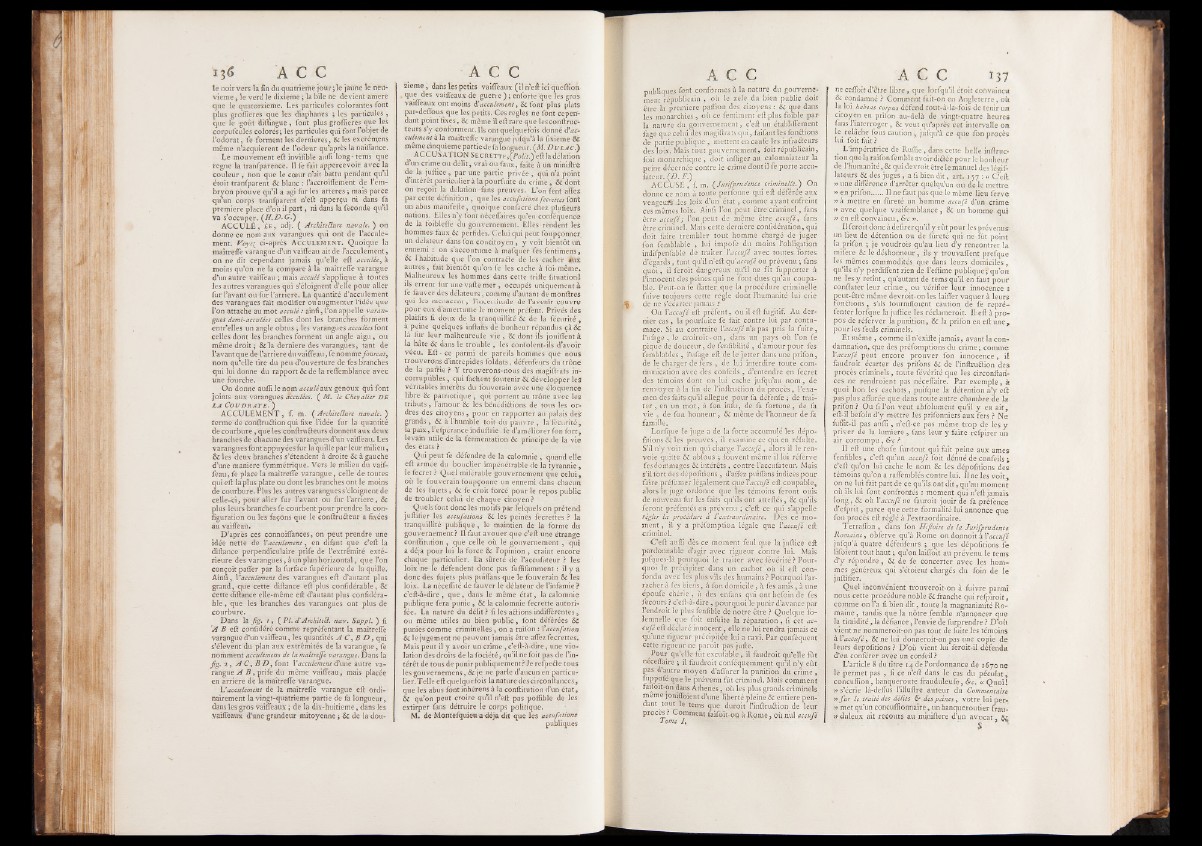
i3 <î A C C
le noir vers la fin du quatrième jour ; le jaune le neuvième
, le verd le dixième ; la bile ne devient amere
que le quatorzième. Les particules colorantes font
plus grofiïeres que les diaphanes ; les particules ,
que le goût diftingue , font plus gfoffiel'ês que les
corpufcules colorés; les particules qui font l’objet de
l’odorat, fe forment les dernierés, & les excrénrenS
même n’àcquierent de l’odeur qu’après la naiffance.
Le mouvement eft invilible auflî long-tems que
régné la tranfparence. 11 fe fait appercevoit avec la
couleur , non que le coeur n’ait battu pendant qu’il
étoit tranfparent & blanc : l’accroiffertient de l’embryon
prouve qu’il a agi fur les arteres ; mais parce
qu un corps tranfparent n’eft apperçu ni dans fa
première place d’où il part, ni dans la fécondé qu’il
Va s’occuper. (.H.D.G'.)
A C CU L É , £E, adj. ( Architecture navale.') Oh
donne ce nom aux varangues qui ont dë l’accule-
ment. V oÿt^ ci-après Accülement. Quoique la
maîtrefle varangue d’un vâiffeau ait de l’acculement,
on ne dit cependant jamais qu’elle eft acculée, à
moins qu’on ne la compare à la maîtrefle varangue
d’un autre vâiffeau ; mais acculé s’applique à toutes
les autres varangues qui s’éloignent d’elle pour aller
fur l’avant ou fur l'arriéré. La quantité d’acculement
des varangues fait modifier Ou augmenter l’idée que
l ’on attache au mot acculé : ainfi, l’on appelle varan-
gueS demi-acculées celles dont les branches forment
entr’elles Un angle obtus ; les varangues acculées {ont
celles dont les branches forment un angle aigu, ou
même droit; & la derniere des varangues, tant de
l’avant que de-l’arriere du vaiffeau, fe nomme fourcat,
nom qu’elle tire du peu d’ouverture de fes branches
qui lui donne du rapport & de la reffemblance avec
une fourche.
On donne alifll le nom acculé aux genoux qui font
/oints aux varangues acculées. ( M. le Chevalier DE
LA COUDRAYE. )
ACCÜLEMEN T, f. m. ( Architecture navale.)
terme de conftruâion qui fixe l’idée fur la quantité
de courbure, que les conftrufteurs donnent aux deux
branches de chacune des varangues d’un vâiffeau. Les
varangues font appuyées fur la quille par leur milieu,
& les deux branches s’étendent à droite & à gaüche
d’une maniéré fÿmmétrique. Vers le milieu du vaiffeau,
fe place la maîtrefle varangue, celle de toutes
qui eft la plus plate ou dont les branches ont le moins
de courbure. Plus les autres varangues s’éloignent de
celle-ci, pour aller fur l’avant ou fur l’arriere, &
plus leurs branches fe courbent pour prendre la configuration
Ou les façons que le conftru&eur a fixées
auvaifleaû. -
D ’après ces connoiffances, on peut prendre une
idée nette de l’accülement, en difant qùë c’eft la
diftance perpendiculaire prife de l’extrémité extérieure
des varangues, à un plan horizontal, que l’on
conçoit paffer par la furface fupérieure de la quille.
Ainfi, Y accülement des varangues eft d’autant plus
grand, que cette diftancè eft plus confidérable, &
cette diftance elle-même eft d’autant plus confidérable
, que les branches des varangues ont plus de
courbure.
Dans la fig. / , (P/, d" A rchite cl. nav. Suppl. ) fi
A B eft cohfidéré comme repréfentant la maîtrefle
Varangue d’un vaiffeau, les quantités A C , B D , qui
s’élèvent du plan aux extrémités de la varangue, fe
nomment acculémens de la maîtreffe varangue. Dans la
fig. 2., A C , B D , font Y accülement d’une autre varangue
A B , prife du même vaiffeau, mais placée
en arriéré dë la maîtrefle varangue.
\J accülement de la maîtrefle varangue eft o r d i nairement
la vingt-quatrieme partie de fà longueur,
dans les gros vaiffeaux ; de la dix-huitieme, dans les
yaiffeaux d’une grandeur mitoyenne ; & de la dou-
A C C
zïeme, dans les petits vaiffeaux ( il n’e è ici queftion
. que des vaiffeaux de guetre ) ; enforte 'que les gros
vaiffeaux ont moins d'accülement, & font plus plats
par-deflous que les petits. Ces réglés ne font cependant
point fixes, &c même il eft rare que leseonftruc-
teurs s’y conforment. Ils ont quelquefois donné d’«zc-
culement à la maîtrefle varangue jufqu’à la fixieme SC
même cinquième partie de fa longueur; (M. D u l a c .)
5 ACCUSATION Secrette,(P o/ù.) eftladélation
d un crime ou délit, vrai ou faux, faite à un miniftrè
de la juftice , par une partie privée , qui n’â point
d’intérêt particulier à la poutfuite du crime, & dont
on reçoit la délation-fans preuves. L’on fent affez
par cette définition , que les accusations fecrettes font
un abus manifefte, quoique confacré chez plufièürs
nations. Elles n’ÿ font néceffaires qu’én cônféquencè
de lafoiblefle du gouvernement. Elles rèndent les
hommes faux & perfides. Celui qui peut fôupçonner
un délateur dans fon concitoyen , y voit bientôt un
ennemi : on s’accoutume à mâfquer fes fentimens,
& 1 habitude que l’on contracte de les Cacher âùx
autres, fait bientôt qu’on fe les cache à foi-même.
Malheureux les hommes dans cette trifte fituâtionl
ils errent fur une vafte mer , occupés uniquement à
fe fauver des délateurs, comme d’autant de monftreS
qui les menacent ; rincertitude de l’avenir couvre
pour eux d amertume le moment préfent. Privés des
plaifirs fi doux de la tranquillité & de la fécurité,
à peine quelques inftahs de bonheur répandus ç à &
là fur leur malheureufe vie , & dont ils jouiffent à
la hâte & dans le trouble , les conlolent-ils d’avoir
vécu. Eft - ce parmi de pareils hommes que nous
trouverons d’intrépides foldats, défenfeurs du trône
de la patrie ? Y trouverons-nous des magiftrats incorruptibles,
qui fâchent foutenir Si. développer les
véritables intérêts du fouverain avec une éloquence
libre & patriotique , qui portent au trône avec les
tributs, l’amour & les bénédictions de tous les ordres
des citoyens, pour en rapporter au palais de?
grands , Si à l’humble toît du pauvre , la fécurité v,
la paix, l’efpéranceinduftrie. fe d’améliorer fon fort,
levàïn utile de la fermentation & principe de la vie
des états ?
Qui peut fe défendre de la calomnie , quand elle
eft armée du bouclier impénétrable de la tyrannie ,
le fecret ? Quel miférable gouvernement que celui,
où le fouverain loupçonne un ennemi dans chacun
de fês.fujets , Si fe croit forcé pour le repos public
de troubler celui de chaque citoyen?
Quels font donc les motifs par lefquels on prétend
juftifier les accufatïons Si les peines fecrettes ? la
tranquillité publiqu'e, le maintien de la forme du
gouvernement? Il faut avouer que c’ëft une étrange
conftitution , que celle où le gouvernement , qui
a déjà pour lui la force Si l’opinion , craint encore
chaque particulier. La sûreté de l’accufateur ? les
loix ne le défendent donc pas fuffifamment : il y a
donc des fujets plus puiffans que le fouverain Si les
loix. La néceflité de fauver le délateur de l’infamie ?
c’eft-à-dire, que, dans le même état, la calomnie
publique fera punie , Si la calomnie fe'crette autori-
ïee. La nature du délit? fi les a étionsindifférentes,
ou même utiles au bien public, font déférées Sc
punies comme criminelles, on a raifon : l’accufation
Si le jugement ne peuvent jamais être affez fecrettes.
Mais peut il y avoir un crime , c’eft-à-dire, urte violation
des droits de la fociété, qu’il ne foit pas de l’intérêt
de tous de punir publiquement ? Je refpeéte tous
les gouvernemens, & je ne parle d’aucun en particu-
lier.Telle eft quelquefois la nature des circonftances,
que les abus fontinhérens à la conftitution d’un état,
& qu’on peut croire qu’il n’eft pas poflible de les
extirper fans détruire le corps politique.
M. deMontefquieua-déja dit que les açeufations
publiques
A C C
publiques font conformes à la nature du gouvernement
républicain , où le zele du bien public doit
être la première paflion des citoyens : Si que dans
les monarchies , où ce fentiment eft plus foible par
la nature du gouvernement, c’eft un établiffement
fage que celui des magiftrats qui, faifant les fondions
de partie publique , mettent en caufe les infraéteurs
des loix. Mais tout gouvernement, foitrépublicain,
foit monarchique , doit infliger au calomniateur la
peine décernée contre le crime dont il fe porte accu-
fatéur. ÇD. F . ) , ; _
A C CU SÉ , f. m. ( Jurifprudence^criminelle.) On
donne ce nom à toute perfonne qui eft déférée aux
vengeufÇ .des loix d’un é ta t, comme ayant enfreint
ces mêmes loix. Ainfi l’on peut être criminel, fans
être accufé; l’on peut de même être accufé, fans
être criminel. Mais cette derniere confidération, qui
doit faire trembler tout homme chargé de juger
fon femblable , lui impofe du moins l’obligation
indifpenfable de traiter l’accufé avec toutes fortes
d’égards , tant qu’il n’eft qu 'accufé ou prévenu ; fans
qu o i, il feroit dangereux qu’il ne fît fupporter à
l’innocent des peines qui ne font dues qu’au coupable.
Peut-ôn fe flatter, quê la procédure criminelle
fuive toujours cette réglé dont l’humanité lui crie
de ne s’écarter jamais.?
Ou Y accufé eft préfent, ou il eft fugitif. Au dernier
ca s , la pôurfuite fe fait contre lui par contumace.
Si au contraire Y accufé n’a pas pris la fuite,
l’ufage , le croiroit- on, dans un pays où l’on fe
pique de douceur, de fenfibilité , d’amour pour fes
îemblables , l’ufage eft de le jetter dans une prifon,
de le charger de fers-r. de lui interdire toute communication
avëc des confeils , d’entendre en fecret
des témoins dont on lui cache jufqu’au nom, de
renvoyer à la fin de l’inftrudlion du procès, l’examen
des faits qu’il allégué pour fa défenfe ; de traiter
, en un mot, à fon infu, de fa fortune, de fa
vie , de fon honneur, & même de l’honneur de fa
famille.
Lorfque le juge a de la forte accumulé les dépositions
& les preuves, il examine ce qui en réfulte.
S’il n’y voit rien qui charge Y accufé, alors il le renvoie
quitte St abfous ; fouvent même il lui réferve
fesdommages & intérêts , contre l’accufateur. Mais
s’il fort des dépofitions, d’affez puiffans indices pour
faire préfumer légalement que Yaccufé eft coupable,
alors le juge ordonne que les témoins feront ouis
de nouveau fur les faits qu’ils ont atteftes, & qu’ils
feront préfentés au prévenu ; c’eft ce qui s’appelle
régler là procédure a Vextraordinaire. Dès ce moment
, il y a préfomptiôn légale que Y accufé eft
criminel.
C ’eft ‘aufii dès ce moment feul que la juftice eft
pardonnable d’agir avec rigueur contre lui. Mais
jufques-là pourquoi le traiter avec févérité ? Pourquoi
le précipiter dans un cachot où il eft confondu
avec les plus vils des humains? Pourquoi l’arracher
à fes biens, à fon domicile, à fes amis, à une
epoufe chérie , à des enfans qui ont befoin de fes
fecours ? c’eft-à-dire, pourquoi le punir d’avance par
l’endroit le plus fenfible de notre être ? Quelque fo-
lemnelle que foit enfuite la réparation, fi cet accufé
eft déclaré innocent, elle ne lui rendra jamais ce
qu’une rigueur précipitée lui a ravi. Par conféquent
cette rigueur ne paroît pas jufte.
Pour qu’elle fût excufable, il faudroit qu’elle fût
neceffaire ; il faudroit conféquemment qu’il n’y eût-
pas d’autre moyen d’affurer la punition du crime,
luppofé que le prévenu fut criminel. Mais comment
fanoit-on dans Athènes, où les plus grands criminels
meme jouiffoient d’une liberté pleine & entière pendant
tout le tems que duroit l’inftru&ion dë leur
procès. Comment faifoit-oo à Rome, où nul accufé
Tome /, -• - ■
A C C 137
ne ceffoit d’être libre, que lorfqa’il étoit convaincu
& condamné ? Comment fait-on en Angleterre, où
la loi habeas corpus défend tout-àda-fois de tenir un
citoyen en prifon au-delà de vingt-quatre heures
fans l’interroger , & veut qu’après cet intervalle on
le relâche fous caution , jufqu’à ce que fon procès
lui foit fait ?
t L ’impératrice de Ruflie, dans cette belle inftruo
tion que la raifon femble avoir dictée pour le bonheur
de l’humanité, & qui devroit être le manuel des législateurs
& des juges, a fi bien dit, art. 1 57 : « C’efl:
» une différence d’arrêter quelqu’un ou de le mettre
» en prifon......Il ne faut pas que le même lieu ferve
» à mettre en fûreté un homme accufé d’un crime
» avec quelque vraifemblance, & un homme qui
» en eft convaincu, &c ».
Il feroit donc à defirer qu’il y eût pour les prévenus
un lieu de détention ou de fûreté qui ne fût point
la prifon ; je voudrois qu’au lieu d’y rencontrer la
mifere & le déshonneur, ils y trouvaffent prefque
les mêmes commodités que dans leurs domiciles,
qu’ils n’y perdiffent rien de l’eftime publiquef qu’on
ne les y retînt, qu’autant de tems qu’il en faut pour
conftater leur crime, ou vérifier leur innocence :
peut-être même devroit-on les laitier vaquer à leurs
fondions, s’ils fourniffoient caution de fe repré-
fenter lorfque la juftice les réclameroit. Ibeft à propos
de réferver la punition, & la prifon en eft une,
pour les feuls criminels.
Et même , comme il n’exifte jamais, avant la condamnation,
que des préfomptions du crime ; comme
Y accufé peut encore prouver fon innocence, il
faudroit écarter des prifons & de l’inftru&ion des
procès criminels, toute févérité que les circonftances
ne rendroient pas neceffaire. Par exemple, à
quoi bon les cachots., puifque la détention n’y eft
pas plus afliirée que dans toute autre chambre de la
prifpn ? Ou fi l’on veut abfolument qu’il y en ait,
eft-il befoin d’y mettre les prifonniers aux fers ? Ne
fuffit-il pas au fli, n’eft-ce pas même trop de les y
priver de la lumière , fans leur y faire refpirer un
air corrompit, &ç ? .
11 eft une chofe fur-tout qui fait peine aux âmes
fenfibles , c’eft qu’un accufé foit dénué de confeils ;
c’eft qu’on lui cache le nom & les dépofitions des
témoins qu’on a raffemblés contre lui. Une les v o it,
on ne lui fait part de çe qu’ils ont d it, qu’au moment
où ils lui font confrontés : moment qui n’eft jamais
long, & où Y accufé ne fauroit jouir de fa préfence
d’efprit, parce que cette formalité lui annonce que
fon procès eft réglé à l’extraordinaire.
Terraffon , dans fon Hifioire de la Jurifprudence
Romaine, obferve qu’à Rome on donnoit à Y accufé
jufqu’à quatre défenfeurs ; que les dépofitions fe
lîfoient tout haut ; qu’on laiffoit au prévenu le tems
d’y répondre, & de fe concerter avec les hommes
généreux qui s’étoient chargés du foin de le
juftifier.
Quel inconvénient trouveroit-on à fuivre parmi
nous cette procédure noble & franche qui refpiroit,
comme on l’a fi bien dit, toute la magnanimité Romaine
, tandis que la nôtre femble n’annoncer que
la timidité, la défiance, l’envie de furprendre ? D ’où
vient ne nommeroit-pn pas tout de fuite les témoins
à Yaccufé, & ne lui donneroit-on pas une copie de
leurs dépofitions ? D ’où vient lui feroit-il défendu
d’en conférer avec un: çonfeil ?
L’article 8 du titre 14 de l’ordonnance de 1670 ne
lè permet pas , fi.ee n’eft dans le cas du péculat,
concuflion, banqueroute frauduleufe, &c. « Quoi!
» s’écrie là-deffus Pilluftre auteur du Commentaire
»fur le traité des délits & des peines, votre loi per-
>> met qu’un concuflionnaire, un banqueroutier frau-
»■ duleux ait recours au miniftère d’un avocat &