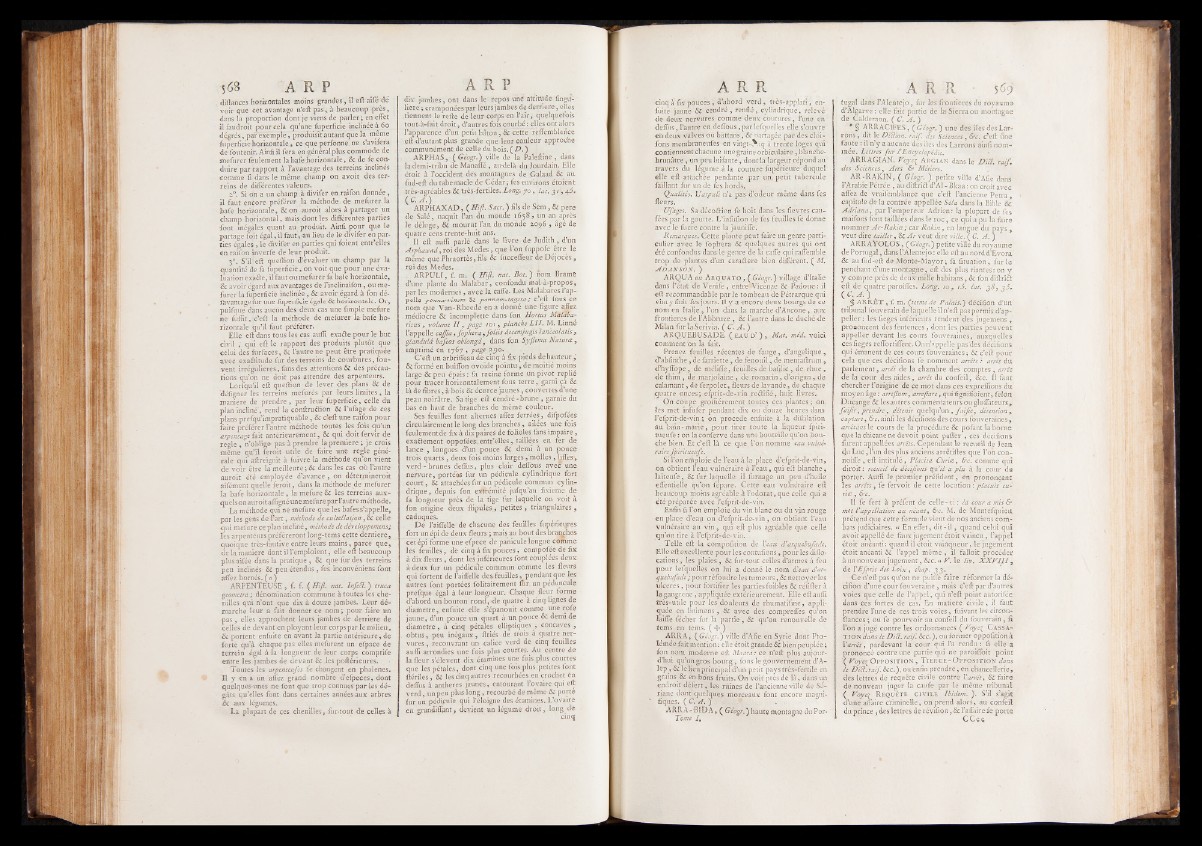
diftances horizontales moins grandes, il ëft aifé dé
voir que cet avantage n’eft pas,. à beaucoup près,
dans la proportion dont je viens de parler; en effet
il faudroit pour cela qu’une fuperfïcie inclinée à 60
degrés, parëxëmpleS produisît autant que la même
fuperfïcie horizontale., ce que perfonne ne s’avifera
de foutenir. Ainfi il fera en général plus commode de
mefurer feulement la bafe horizontale, & de fe conduire
par rapport à l’avantage des terreins inclines
•comme fi dans le même champ on avoit des ter-
reins de différentes valeurs.
z°. Si on a un champ à-divifer en raifon donnée,
il faut enèore préférer la méthode, de mefurer,la
bafe horizontale, & o n auroit alors à partager un
champ horizontal, mais dont les différentes parties
font inégales quant au produit. Ainfi pour que le
partage doit égal, il faut, au lieu de le divifer en parties
égales, le divifer en parties qui foient entr’elles
en raifon inverfe de leur produit.
3°. S’il : eft queftion d’évaluer un. champ par la
quantité de fa fuperfïcie, on voit que pour une évaluation
exàfte, il faut oumefurer fa bafe horizontale,
& avoir égard aux avantages de l’inclinaifon, ou mefurer
la fuperfïcie inclinée, & avoir égard à fon dé-
favantagefur une fuperfïcie égale & horizontale. Or,
puifque dans aucun des deux cas une fimple mefure
ne fuffit, c’eft la méthode de mefurer la bafe horizontale
qu’il faut préférer.
Elle eft dans tous les cas auffi exafte pour le but
civil , qui eft le rapport des produits plutôt que
celui des furfaces, & l’autre ne peut être pratiquée
avec exaftitude fur des terreins de courbures, lou-
vent irrégulières, fans des attentions & des précautions
qu’on ne doit pas attendre des arpenteurs.
Lorfqu’il eft queftion de lever des plans & de
défigner les terreins mefurés par leurs limites, la
maniéré de prendre, par leur fuperfïcie, celle du
plan incliné', rend la conftruâion & l’ufage de ces
plans prefqu’impratiquable, & c’eft une raifon pour
faire préférer l’autre méthode toutes les fois qu’un
arpentage fait antérieurement, & qui doitfervir de
regie , n’oblige pas à prendre la première ; je crois
même qu’il feroit utile de faire une regie générale
qui aftreignît à fuivre la méthode qu’on vient
de voir être la meilleure ; & dans les cas où l’autre
auroit été employée d’avance, on détermineroit
aifément quelle feroit, dans la méthode de mefurer
la bafe horizontale , la mefure & les terreins auxquels
on auroit affigné une mefure par l’autre méthode.
La méthode qui ne mefure que les bafes s’appelle,
par les gens de l’art, méthode de cultellaùon, & celle
qui mefure ce plan incliné,. méthode de développement;
les arpenteurs préféreront long-tems cette derniere,
quoique très-fautive entre leurs mains, parce que,
de la maniéré dont il l’emploient, elle eft beaucoup
plus âifée dans la pratique , & que fur des terreins
peu inclinés & peu étendus, fes inconvéniens font
aflez bornés, (o )
ARPENTEUSE, f. f. ( Hifi. nat. Infect. ) eruca
geometra ; dénomination commune à toutes-les chenilles
qui n’ont que dix à douze jambes. Leur démarche
leur a fait donner‘ce nom; pour faire un
pas, elles approchent leurs jambes de derrière de
celles de devant en ployant leur corps par le milieu,
& portent enfuite en avant la partie antérieure, de
forte qu’à chaque pas elles mefurent un efpace de
terrein égal à la longueur de leur corps comprife
entre les jambes de devant & .les poftérieures.
Toutes les arpenteufes fe changent en phalènes.
Il y en a un aflez grand nombre d’efpeces, dont
quelques-unes ne font que trop connues par les dégâts
qu’elles font dans certaines années aux arbres
& aux légumes.
La plupart de ces chenilles, fur-tout de celles à
dix jambes, ont dans le repos une' attitude, fingiï-
liere ; cramponées par leurs jambes de derrière, elles
tiennent le refte de leur corps en l’air, quelquefois
tout-à-fait droit, d’autres fois courbé : elles ont alors
l’apparence d’un petit bâton, & cette refîemblance
eft d’autant plus grande que leur couleur approche
communément de celle du bois. ( D. )
ARPHAS, ( Géogr.) ville de la Paleftine , dans
la demi-tribu de Manaffé , au-delà du.Jourdain. Elle
étoit à l’occident des montagnes de Galaad & au
fud-eft du tabernacle.de Cédar; fes environs étoient
très-agréables &c très-fertiles. -Long. 70, Ut. 3 /(, 4S.
( C .A . ) I I . g t I
ARPHAXAD, ( Hifi. Sacr. ) fils de Sem, & pere
de Salé, naquit l’an du monde 1658, un an après
le déluge» & mourut l’an du monde 2096 , âgé de
quatre cens trente-huit ans.
Il eft auffi parlé dans le livre de Judith, d’un
Arphaxad, roi des Medes, que l’on fuppofe être le
même que Phraortès, fils & fuceefleUr deDejocès,
, roi des Medes.. - •
. ARPULI, f. m; ( Hifi. nat. Bot. ) nom Brame
d’une plante du Malabar, confondu mal-à-propos,
par les modernes, avec la cafte. Les Malabares l’appelle
ponna-vinem & ponnam-tagera ; c’eft fous ce
nom que Van-Rheede en a donné une figure aflez
médiocre & incomplette dans fon. Hortus Mnldba-
ricus , volume I I , page 101, planche LII. M. Linné
l’appelle caffia , fophera yfoliis decemjugis lanceolatis ,
glanduld bafeos oblongâ, dans fon Syfiema Natura ,
imprimé en 1767 , page P<)Q.
C ’eft. un arbrifleau de cinq à fix pieds de hauteur
& formé en buiflon ovoïde pointu, de moitié moins
large & peu épais : fa racine forme un pivot replié
pour tracer, horizontalement fous terre, garni çà &
. là de fibres, à bois & écorce jaunes, couvertes d’une
peau noirâtre. Sa tige eft cendré - brune , garnie du
bas en haut de branchés de même couleur.
; Ses feuilles font alternes aflez ferrées, difpofées
circulairement le long des branches , ailées une fois
feulement de fix à dix paires de folioles fans impaire,
exactement oppofées, entr’elles, taillées en fer de
lance , longues d’un pouce & demi à un pouce
trois quarts , deux fois moins larges,'molles , liftes-,
verd - brunes defliis, plus clair defîous avec une
nervure, portées fur un pédicule cylindrique fort
court, & attachées fur un pédicule commun cylindrique
, depuis fon extrémité jufqu’au ; fixieme de
fa longueur près de la tige fur laquelle on voit à
fon origine deux ftipules, petites, triangulaires,
caduques.
De l’aiflelle de chacune des feuilles fupérieures
fort un épi de deux fleurs ; mais au bout des branches
cet épi forme une efpece de panicule longue comme
les feuilles, dë cinq à fix pouces, compofée de fix
à dix fleurs, dont les inférieures font couplées deux
à deux fur un pédicule commun comme les' fleurs
qui fortent de l’aiflelle des feuilles, pendant que les
autres font portées folitairement fiât, un péduncule
prefque égal à leur longueur. Chaque fleur forme
d’abord un bouton rond,*de quatre à cinq lignes de
diamètre,_ enfuite elle s’épanouit .comme une rofe
jaune, d’un pouce un quart à un pouce & demi de
diamètre, à cinq pétales elliptiques , concaves,
obtus, peu inégaux, ftriés de trois à quatre nervures
, recouvrant un calice verd de cinq feuilles
auffi arrondies une fois plus courtes. Au centre de
la fleur s’élèvent dix étamines une fois plus courtes
que les pétales, dont cinq une fois plus petites font
ftériles & les cinq autres recourbées en crochet en
defliis à anthères jaunes, entourant l’ovaire qui eft:
verd, un peu plus long, recourbé de même & porté
fur un pédicule qui l’éloigne des étamines. L’ovaire
en grandifîant, devient un légume droit, long de
cinq
cinq à fix pouces , d’abord verd, très-applati, en-
fuite jaune & cendré, renflécylindrique, relevé
de deux nervures comme deux coutures, l’une en
defliis, l’autre en. deflbus, par le fqu elles elle s’ouvre
eh deux valves ou bâttans, & partagée par des clôi-
fons membraneufes en vingt-*.iq à trente loges qui
contiennent chacune une graine orbiculaire , blanche-
brunâtre , un peu luifante, dont la largeur répond au
travers du légume à la couture fuperieure duquel
elle eft • attachée pendante .par un, petit tubercule
faillant fur un de fes, bords»
Qualités. Udrpuli n’a pas d’odeur même dans fes
fleurs.
• Ufages. Sa décoûion fe boit dans les fievres cau-
fées par la goutte. L’infufion de fes feuilles fe donne
avec le fucre contre la jaunifle.
Remarques. Cette plante peut faire un genre particulier
avec le fophera & quelques autres qui ont
été confondus dans le genre de la cafîe qui rafîemble
trop de plantes d’un caraâere bien différent. ( M.
A d a n son . )
ARQUA ou A r q u a t o , ( Géogr.') village d’Italie
dans Pétât de Venife, entre Vicenze & Padoue : il
•eft recommandable parle tombeau de Pétrarque,qui
vint y finit fes jours. Il ÿ a encore deux bourgs de ce
nom en Italie , l’un dans la marche d’Ancone, aux
frontières de. l’Abbruze , & l’autre dans le duché de
Milan furlaSerivïâ. ( C. A .')
ARQUEBUSADE ( e a u d’ ) , Mat. méd. voici
comment'on la fait.
Prenez feuilles récentes de fange, d’angelique,
d’abfinthe , de farriette, de fenouil, de mentaftrum,
d’hyflope, de méliflë, feuilles dé bafjlic, de.rhue,
de thim , de marjolaine , de romarin, d’origan , de
calamànt, de ferpolet, fleurs de lavande, de chaque
quatre onces; elprit-de--vin rectifié, huit livres.
On colipe groffiérement toutes ces plantes ; on-,
les met infufer pendant dix ou douze heures dans
l’efprit-de-vin ;. on procédé enfuite à la diftilation
au bain-marie, pour tirer toute la liqueur fpiri-
tueufe : on la conferve dans une bouteille qu’on bouche
bien. Et c’eft là ce que l’on nomme eau vulnéraire
fpiritueufe.
Si l’on emploie de l’eau à la place d’efprit-de-vin,
on obtient l’eau vulnéraire à l’eau, qui eft blanche,
laiteufe, & fur laquelle il fumage un peu d’huile
effentielle qu’on fepare. Cette eau ' vulnéraire eft
beaucoup moins agréable à l’odorat, que celle qui a
été préparée avec l’efprit-de-vin.
Enfin fi l’on emploie du vin blanc ou du vin rouge
en place d’eau ou d’efprit-de-vin, on obtient l’eau
vulnéraire au v in , qui eft plus agréable que celle
qu’on tire à l’efprit-de-vin.
Telle eft la compofition de Veau d'arquebufade.
Elle eft excellente pour les contufions, pour les diflo-
cations., les plaies , & fur-tout celles d’armes à feu
pour lefqüelles on lui a donné le nom (Veau dUr-
•quebufade; pour réfoudre les tumeurs,.& nettoyer les
ulcérés, pour fortifier les parties foibles & réfifter à
la .gangrené, appliquée extérieurement. Elle eft auffi
très-utile po.ur les douleurs de rhumatifine, appliquée
en linimens, & avec des comprefles qu’on
laiffe fécher fur la partie, & qu’on renouvelle de
tems en teins. ( -f ) *•
ARRA, ( Géogr. ) ville d’Âfie en Syrie dont Pto-
lémée fait mention : elle étoit grande & bien peuplée ;
fon nom moderne eft Ma ara : ce n’eft plus aujourd’hui
qu’un gros bourg, fous le gouvernement d’A-
lep ,& le lieu principal d’un petit pays très-fertile en
grains & en bons fruits. On voit' près dé là , dans un
endroit défert, les ruines de l’ancienne ville de Sé-
riane dont quelques morceaux font encore magnifiques.
( C. A. ) . ^ , .
ARRA rB IDA, ( Géogr.) haute montagne duPor-
Tome /.
tugal dans l’A lentejo, fur les frontières du royaume
d’Algarvè : elle fait partie de la Sierra ou montagne
de Calderaon. ( C. A . )
* § ARRACIFES, (Géogr. ) une des îles des Larrons,
dit le Diction, raif. des Sciences, &c. c’eft une
faute : il n’y a aucune des îles des Larrons ainfi nommée.
Lettres fuŸ VEncyclopédie.
ARRAGIAN. P'oyei A r g î a n dans le Dict. raif.
■ des Sciences, Arts 6* Métiers.
AR -RAKIN, ( Géogr. ) petite ville d’Afie dans
l’Arabie Pétrée , au diftridt d’Al-Bkaa: on croit avec
aflez de vraifemblance que c’eft l’ancienne Petra,
Capitale de la contrée appellée Sela dans la Bible &
Adriàna, par l’empereur Adrien: la plupart de fes
maifons font taillées dans le roc, ce qui a pu là faire
nommer Ar-Rakin ; car Rakin, en langue du pays ,
veut dire tailler, & Ar veut dire ville. (C. A.')
ARR AYOLOS, ( Géogr. ) petite ville du royaume
de Portugal, dans l’Alentejo : elle eft au nordd’Evora
& au fud-eft de Monte-Màyor ; fa fituation, fur le
penchant d’une montagne, eft des plus riantes: on y
y compte près de deux mille habitans, & fon diftriâ:
eft de quatre paroifles. Long., ro, iS. lat. 38, 3 J.
§ ARRÊT, f. m. (ternie de Palais.) décifion d’un
tribunal fouverain de laquelle il n’eft pas permis d’ap-
peller : lés fieges inférieurs rendent des jugemens ,
prononcent des fentences, dont les parties peuvent
appeller devant les cours fouverainés, auxquelles
ces fieges reflortiflent. On n’appelle pas clés décifions
qui émanent de ces cours fouveraines ; & c’eft pour
cela que ces décifions fe nomment arrêts arrêt du
parlement, arrêt de la chambre des comptes, arrêt
de la cour des aides, arrêt du confeil, &c. Il faut
chercher l’origine de ce mot dans ces expreffions du
moyen âge : arrefium, arrefiare, qui fignifioient, félon
Ducange & les autres commentateurs ou gloflàteurs,
faijir^ prendre , détenir quelqu’un , faijie^ détention ,
capture, &c. ainfi les décifions des cours fouveraines ,
arrêtant le cours de la procédure & pofant la borne
que la chicane ne devoit point paffer ,. ces décifions
furent appellées arrêts. Cependant le recueil de Jean
du Luc, l’un des plus anciens arrêtiftes que l’on con-
noifle , eft intitulé, Placita Curice, &c. comme qui
diroit: recueil de décifions qu’f/ a plu à la cour de
porter. Auffi le premier préftdent, en prononçant
les arrêts, fe fervoit de cette locution: placuit eu-
ria , &c. .
Il fe fert à prêtent de celle - ci : la cour a mis &
met l'appellation au néant, &c. M. de Montefquieit
prétend que cette formule vient de nos anciens combats
judiciaires. « En effet, d i t - il, quand celui qui
avoit appellé de, faux jugement étoit vaincu, l’appel
étoit anéanti: quand il étoit vainqueur, le jugement
étoit anéanti & l’appel même , il falloit procéder
à un nouveau jugement, &c. » V. le liv. X X F I I I ,
de VEfprit des Loix , chap. 33. ' "
Ce n’eft pas qu’on ne pnifle faire réformer la décifion
d’une cour fouveraine , mais c’eft par d’autres
voies que celle de l’appel, qui n’eft point autorilée
dans ces fortes de cas. En matière civile, il faut
prendre l’une de ces trois voies , fuivant les circon*
fiances ; oii'fe pourvoir au confeil du fouverain , fi
l’on â jugé contre les ordonnances ( Fpye^ C a s s a t
i o n dans'le D ic l. raif. &c. ), ou former oppofition à
Varrêt, pardevant la cour qui l’a rendu : fi elle a
prononcé contre une partie qui ne paroifloit point
( Foye^ O p p o s i t io n , T i e r c e - O p p o s i t i o n dans
le Dicl. raif & c.), ouënfin prendre, en chancellerie,
des lettres de requête civile contre Varrêt, & faire
de nouveau juger la caufe par le même tribunal
( F o y e i R e q u ê t e c i v i l e Ibidem. ). S’il s’agit
d’une affaire criminelle, On prend alors, au confeil
du prince , des lettres de révifion, & l’affaire fe porte
C C c c