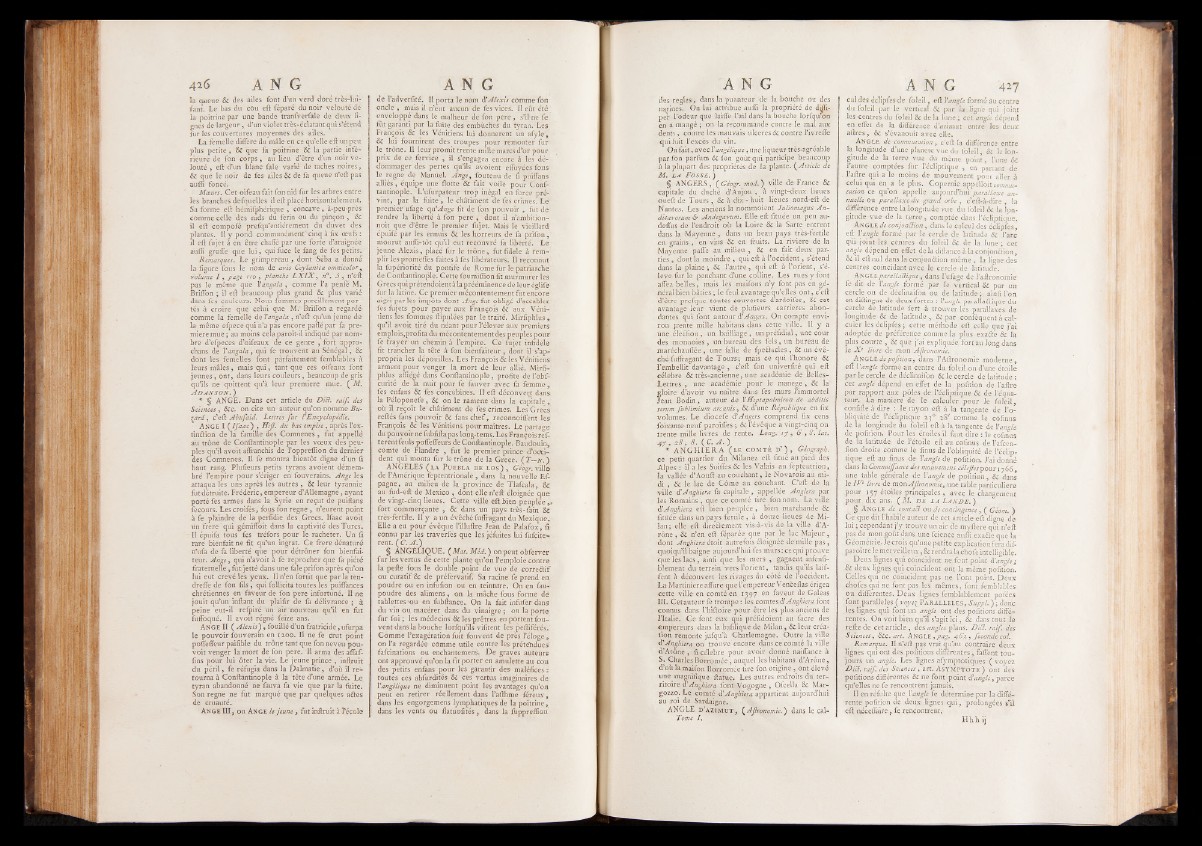
la cuieue & des ailes font d’un verd doré très-lui-
fant. Le bas du cou eft féparé du noir velouté de
la poitrine par une bande tranfverfale de deux lignes
de largeur, d’un violet très-éclatant qui s’étend
fur les couvértures moyennes des ailes.
La femelle différé du mâle en ce qu’elle eft un peu
plus petite, & que fa poitrine & la partie inférieure
de fon corps , au lieu d’être d’un noir velouté
, eft d’un blanc fale varié de taches noires,
& que le noir de fes ailes & de fa queue n’eft pas
aum foncé.
Moeurs. Cet oifeau fait fon nid fur les arbres entre
les branches defquelles il eft placé horizontalement.
Sa forme eft hémifphérique , concave , -à-peu-près
comme celle des nids du ferin ou du pinçon , &
il eft compofè prefqu’entiéremënt du duvet des
plantes. Il y pond communément'cinq à fix oeufs :
il eft fujet à en êtrechaffé par une forte d’araignée
auffi greffe que lu i, qui fuce le fang de fes petits.
Remarques. Le grimpereau , dont Séba a donné
la figure fous le nom de avis Ceylanica omnicolor,
volume I , puge no , planche L X IX , 72°. 5 , n’eft
pas le même que Yangala, comme l’a penfé M.
Briflon ; il eft beaucoup plus grand & plus varié
dans fes couleurs. Nous fommes pareillement portés
à croire que celui que M; Briffon a regardé
comme la femelle de Yangala , n’eft qu’un jeune de
la même efpece qui n’a pas encore paflé par fa première
mue ; au moins cela paroît-il indiqué par nombre
d’efpecës d’oifeaux de ce genre , fort appro-
chans de Yangala, qui fe trouvent au Sénégal, &
dont les femelles font pàrfaitement femblables à
leurs mâles, mais qui, tant que ces oifeaux font
jeunes, ont, dans leurs couleurs, beaucoup de gris
qu’ils ne quittent qu’à leur première mue.~( M.
A d an so n . )
* § ANGE. Dans cet article du Dict. raif. des
Sciences, &c. on cite un auteur qu’on nomme Busard
, ç’eft Abufaid. Lettrés fur ÜEncyclopédie.
A nge I ( Ifaac) , Hijt. du bas empire, après l’extinction
de la famille des Comnenes , fut appelle
au trône de Conftantinople par les voeux des peuples
qu’il avoit affranchis de l’oppreffion du dernier
des Comnenes. Il fe montra bientôt digne d’un fi
haut rang. Plufieurs petits tyrans avoient démembré
l’empire pour s’ériger en fouverains. Ange les
attaqua les uns après les autres , & leur tyrannie
fut détruite. Frédéric, empereur d’Allemagne, ayant
porté fes armes dans la Syrie en reçut de puiflans
fecours. Les croifés, fous fon régné , n’eurent point
à fe plaindre de la perfidie des,Grecs. Ifaac avoit
un frere qui gémiffoit dans la captivité des Turcs.
Il épuifa tous fes tréfors pour le racheter. Un fi
rare bienfait ne fit qu’un ingrat. Ce frere dénaturé
n’ufa de fa liberté que pour détrôner fon bienfaiteur.
Ange, qui n’avoit à fe reprocher que fa piété
fraternelle, fut jetté dans une faleprifon après qu’on
lui eut crevé les yeux. Il n’en fortit que par la ten-
drelfe de fon fils, qui follicita toutes les puiffances
chrétiennes en faveur de fon pere infortuné. Il ne
jouit qu’un inftant du plaifir de fa délivrance ; à
peine eut-il refpiré un air'nouveau qu’il en fut
fuffoqué. Il avoit régné feize ans.
Ange II ( Alexis'), fouillé d’un fratricide, ufurpa
le pouvoir louverain en i zoo. Il ne fe Crut point
poffeffeur paifible du trône tant que fon neveu pou-
voit venger la mort de fon pere. Il arma des affaf-
fins pour lui ôter la vie. Le jeune prince , inftruit
du péril, fe réfugia dans la Dalmatie, d’oii il retourna
à Conftantinople à la tête d’une armée. Le
tyran abandonné ne fauva fa vie que par la fuite.
Son régné ne fut marqué que par quelques a êtes
de cruauté.
Ange III, ou Ange le jeune , fut inftruit à l’école
de l’adverfité. Il porta le nom d’Alexis comme fora
oncle , mais il n’eut aucun de fes vices. Il eut été
enveloppé dans le malheur de fon pere , s’il ne fe
fut garanti par la fuite des embûches du tyran. Les
François & les Vénitiens lui donnèrent un afyle,
& lui fournirent des troupes pour remonter fur
le trône. Il leur promit trente mille marcs d’or pour
prix de ce fervice , il s’engagea encore à les dédommager
des pertes qu’ils avoient efluyées fous
le régné de Manuel. Ange, foutenu de fi puiflans
alliés, équipe une flotte &c fait voile pour Conftantinople.
L’ufurpate.ur trop inégal en force prévint,
par la fuite , le châtiment de (es crimes. Le
premier ufage qu’Ange fit de fon pouvoir , fut de
rendre la liberté à fon pere , dont il n’ambition-
noit que d’être le premier fujet. Mais le vieillard
épu.ifé par les ennuis & les horreurs de fa prifon ,
mourut auflï-tôt qu’il eut recouvré fa liberté. Le
jeune Alexis, placé fur le trône, futfidele à remplir
les promefles faites à fes libérateurs. Il reconnut
la fupériorité du pontife de Rome fur le patriarche
de Conftantinople. Cette foumiffion fit murmurer les
Grecs qui prétendoientà la prééminence de leur églife
fur la latine. Ce premier mécontentement fut encore
aigri par les impôts, dont Ange fut obligé d’accabler
fes fujets pour payer aux François & aux Vénitiens
les fommes ftipulées par le traité. Mirfiphlus ,
qu’il avoit tiré du néant pour l’élever aux premiers
emplois,profita du mécontentement des peuples pour
fe frayer un chemin à l’empire. Ce fujet infidèle
fit trancher la tête à fon bienfaiteur, dont il s’appropria
les dépouilles. Les François & les Vénitiens
arment pour venger la mort de leur allié. Mirfiphlus
affiégé dans Conftantinople, profite de l’obf-
curité de la nuit pour fe fauver avec fa femme ,
Ses enfans & fes concubines. Il eft découvert dans
la Péloponefe, & on le ramene dans la capitale ,
où il reçoit le châtiment de fes crimes. Les Grecs
reftés fans pouvoir & fans chef, reconnoiflent les
François & les Vénitiens pour maîtres. Le partage
du pouvoir ne fubfifta pas long-tems. Lés François ref-
terentfeuls poffefleurs de Conftantinople. Baudouin,
comte de Flandre , fut le premier prince d’occident
qui monta fur le trône de la Grèce. ( T—n .)
ANGELES ( la Puebla de los) , Géogr. villa
de l’Amérique feptentrionale , dans la nouvelle Ef-
pagne, au milieu de la province de Tlafçala, &
au fud-eft de Mexico , dont elle n’eft éloignée que
de vingt-cinq lieues. Cette ville eft bien peuplée ,*
fort commerçante , & dans un pays très-fam &
très-fertile. 11 y a un évêché füffragant du Mexique:
Elle a eu pour évêque l’illuftre Jean de Palàfox, fi
connu par les traverfes que lesjéfuites lui fufcite-
rent. (G. A . )
§ ANGÉLIQUE. ( Mat. Mèd. ) on peut obferver
fur les vertus de cette plante qu’on l’emploie contre
la pefté fous le double point de vue de çôrre&if
ou curatif & de préfervatif. Sa racine fe prend en
poudre ou en infufion ou en teinture. On en fau-
poudre des alimens, on la mâche fous forme de
tablettes’OU en fubftance.. On la fait infufer dans
du vin ou macérer dans du vinaigre ; on la porte
fur foi ; les médecins & les-prêtres en portent fou-
vent dans la bouche lorfqu’ils vifitent les peftiférés.
Comme l’exagération fuit fou vent de près l’éloge ,
on l’a regardée comme utile contre les prétendues’
fafcinations ou enchantemens. De graves auteurs
ont approuvé qu’on la fît porter en amulette au cou
des petits enfans pour les garantir des- maléfices :
toutes ces abfurdités & ces vertus imaginaires de
Y angélique ne diminuent point les avantages qu’on
peut en retirer réellement dans l’afthme fé.reux,
dans les engorgemens lymphatiques de la poitrine,
dans les vents ou flatuofités, dans la fuppreffion
des réglés » dans la puanteur de la bouche ou des
narines. On lui attribue auffi la propriété de dhli-
pelr l’odeur que laide l’ail dans la bouche lorfqiron
en a mangé ; on la recommande contre le mal aux
dents, contre les mauvais ulcérés & contre l’ivrefle
qui fuit l’excès du vin.
On fait, avec Y angélique, une liqueur très-agréable
par fon parfum & fon goût qui participe beaucoup
à la plupart des propriétés de la plante. ( Article de
M . l a F o s s e . )
§ A N GERS , ( Géogr. mod. ) ville de France &
capitale du duché d’Anjou , à vingt-deux lieues
oueft de Tours , & à dix - huit lieues nord-eft de
Nantes. Les anciens la nommoient Juliomagus An-
diçavorum & Andegavum. Elle eft fituée un peu au-
defliis de l’endroit où la Loire & la Sarte entrent
dans la Mayenne , dans un beau pays très-fertile
en grains , en vins & en fruits. La riviere de la
Mayenne pafle au milieu , & en fait deux part
ies ,. dont la moindre , qui eft à l’occident, s’étend
dans la plaine ; & l’autre, qui eft à l’orient, s’élève
fur le penchant d’une colline. Les rues y font
aflez belles,; mais les maifons n’y font pas en général
bien bâties ; le feul avantage qu’elles ont, c’eft
d’être prefque toutes couvertes d’ardoifes., & cet
avantage leur vient de plufieurs carrières abondantes
qui,font autour 8 Angers. On compte environ
trente mille habitans dans cette ville. Il y a
une élection, un bailliage, unpréfidial, une cour
des monnoies , un bureau des fels, un bureau de
maréchàuffée , une falle de fpeftacles , & un évêché
füffragant de Tours; mais ce qui l’honore &
l ’embellit davantage , c’eft fon univerfité qui eft
célébré & très-ancienne, une académie de Belles-
Lettres , une académie pour le manegè - ,& la'
gloire d’avoir vu naître dans fes murs l’immortel
Jean Bodin, auteur de l’Heptapolmiron de abditis
rerum fublimium arcanis, & d’une République en fix
volumes. Le diocefe d’Angers comprend fix cens
foixante neuf paroiffes ; & l’évêque a vingt-cinq ou
trente mille livres de rente. Long. î y , 6 , 8 . lat.
.47 , sl8 , 8. (G. A . )
* A N G H I E R A ( le, COMTÉ d’ ) , Gèograph.
ce petit quartier du Milanez eft fitué au pied des
Alpes : il a les Suifles & les Valais au feptentrion,
la vallée d’Aouft au couchant, le Novarois au midi
, & le lac de Corne au couchant. C’eft de la
ville d’Anghiera fa capitale , appellée Anglera par
les Romains , que ce comté tire fon nom. La ville
d’Anghiera eft bien peuplée , bien marchande &
fitùée dans un- pays fertile, à douze lieues de Milan
; elle eft dire&ement v is - à - v is de la ville d’A-
rône, & n’en eft féparée que par le lac Majeur,
dont Anghiera étoit autrefois éloignée de mille pas,
quoiqu’il baigne aujourd’hui fes murs: ce qui prouve
que les lacs , ainfi que les mers , gagnent infenfi-
blement du terrein vers l’orient, tandis.qu’ils laif-
fent à découvert les rivages du côté de l’occident.
La Martiniere allure que l’empereur Venceflas érigea
cette ville en comté en 1397 en faveur de Galeas
III. Cet auteur fe trompe : les comtes d’Anghiera font
connus dans l’hiftoire pour être les plus anciens de
l’Italie. Ce font eux qui préfidoient au facre des
empereurs dans la bafilique de Milan, & leur création
remonte jufqu’à Charlemagne. Outre la ville
dé Anghiera on trouve encore dans ce comté la ville
d’Arone , fi célébré pour avoir donné naiflance à
S. Charles Borromée, auquel les habitans d’Arône,
d’où lamaifon Borromée tire fon origine , ont élevé
une magnifique ftatue. Les autres endroits du territoire
d’Anghiera font Vogogne , Qfcella & Mar-
gozzo. Le comté dé Anghiera appartient aujourd’hui
au roi de Sardaigne.
ANGLE d’a z im u t , ( Agronomie.) dans le cal-
Tome I.
cul des éclipfes de foleil, eft Y angle formé au centre
du foleil par le vertical & par la.ligne qui joint
les centres du foleil & delà lune; cet angle dépend
en effet de la différence d’azimut entre les deux
aftres, ôc s’évanouit avec elle.
Angle de commutation, c’eft la différence entre
la longitude d’une planete vue du foleil, & la longitude
de la terre vue du même point, l’une &
l’autre comptées fur l’écliptique , en partant de
. l’aftre qui a le moins de mouvement pour aller à
celui qui en a le plus. Copernic appelloit commutation
ce qu’on appelle aujourd’hui parallaxe annuelle
ou parallaxe du grand orbe , c’eft-à-dire , la
différence entre la longitude vue du foleil & la longitude
vue de la, terre , comptée dans l’écliptique.
Angle de conjonction, dans le calcul des éclipfes,
eft Sangle formé par le cercle de latitude & l’arc
qui joint les centres du foleil & de la lune ; cet
angle dépend en effet de la diftance à la conjon&ion,
& il eft nul dans, la conjonction même , la ligne des
centres coïncidant avec le cercle de latitude.
Angleparallactique, dans l’ufage de l’aftronomie
fe dit de YangLe formé par le vertical & par un
cercle ou de déclinaifon ou de latitude;, ainfi l’on
en diftingue de deux fortes : Y angle parallaClique du
cercle de latitude fert à trouver les parallaxes de
longitude & de latitude', & par conféquent à calculer
les éclipfes; cette méthode eft celle que j’ai
adoptée de préférence comme la plus exaCle & la
plus courte , & que j’ai expliquée; fort au long dans
le X e livre de mon 'Astronomie.
. Angle de pojîtion, dans l’Aftronomie moderne,
eft l ’angle formé au centre du foleil où d’une étoile
par le cercle de déclinaifon & le cercle de latitude :
cet angle dépend en effet de la pofition de l’aftre
par rapport aux pôles de l’écliptique & de l ’équateur.
La maniéré de le calculer pour le foleil,
confifte à dire : le rayon eft à la tangente de l’o-
bliquifé de l’écliptique 230 z8y comme le cofinus
de la longitude du foleil eft à la tangente de Y angle
de pofition. Pour les étoiles il faut dire : le cofinus
de la latitude de l’étoile eft au cofinus de l’afcen-
.fion droite comme le finusde l’obliquité de l’écliptique
eft au finus de Y angle da pofition. J’ai donné
dans Xz ConnoiJfance des mouvemens célejles pour 1766 ,
une table générale de Y angle de pofition, & dans
le IVe livre de mon AJhonomie, une table particuliere
pour 157 étoiles principales , avec le changement
pour, dix ans. ( M, d e l a La n d e .)
§ ANGLE de contact ou de contingence, ( Géom. )
Ce que dit l’habile auteur de cet article eft digne de
lui ; cependant j’y trouve un air de myftere qui n’eft
pas de mon goût dans une fcience auffi exafte que la •
Géométrie. Je crois qu’une petite explication fera dif-
paroître le merveilleux ,& rendra la chofe intelligible.
Deux lignes qui coïncident ne font point dé angle;
& deux lignes qui coïncident ont la même pofition.
Celles qui ne coïncident pas ne l’ont point. Deux
chofes qui ne font pas les mêmes, font femblables
ou différentes. Deux lignes femblablement pofées
font parallèles ( voye{ Parallèles, Suppl. ) ; donc
les lignes qui font un angle ont des pofitions différentes.
On voit bien qu’il s’agit ic i, & dans tout le
refte de cet article , des angles plans. Dict. raif. des
Sciences, &c. art. ANGLE ,pag. 462, fécondé col.
Remarque. Il n’eft pas vrai qu’au contraire deux
lignes qui ont des pofitions différentes, faffent toujours
un angle. Les lignes afymptotiques ( voyez
Dict. raif. des Sciences, art. Asymptote ) ont des
pofitions différentes & ne font point $ angle, parce
qu’elles ne fe rencontrent jamais.
Il en réfulte que Y angle fe détermine par la différente
pofition de deux lignes qui, prolongées s’il
eft nécelfaire, fe rencontrent.
Hh h ij