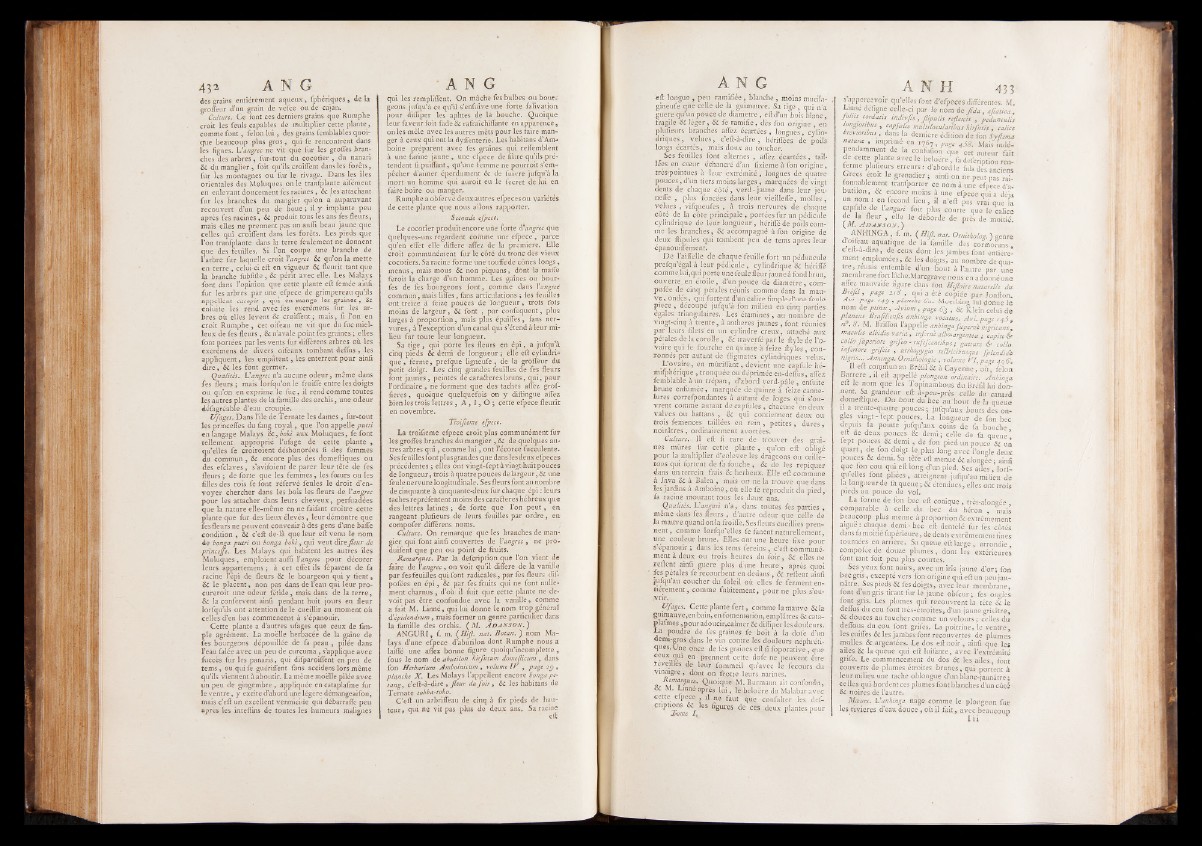
des grains entièrement aqueux-, fphériques, delà
greffeur d’un grain de vefee ou de cajan.
Culture. Ce font ces derniers grains que Rumphe
croit les feuls .capables de multiplier cette plante ,
comme fon t, félon lu i, des grains femblables quoique
beaucoup plus gros, qui fe rencontrent dans
les figues. Vangrec ne vit que fur les groffes branches
des arbres, fur-tout du cocotier , du nanari
& du manglier , foit qu’ils eroiffent dans les forêts,
fur les montagnes ou fur le rivage. Dans les îles
orientales des Moluques on le tranfplante aifément
eh enlevant doucement fes racines , & ^es attachant
fur les branches du mangier qu’on a auparavant
recouvert d’un peu de boue ; il y implante peu
après fes racines, & produit tous les ans les fleurs,
mais elles ne prennent pas un aufli beau jaune que
celles qui eroiffent dans les forêts. Les pieds que
l ’on tranfplante dans la terre feulement ne donnent
que des feuilles. Si l’on coupe une branche de
1 arbre fur laquelle croît Yangrec & qu'on la mette
en terre , celui-ci eft en vigueur & fleurit tant que
la branche fubfifte, & périt avec elle. Les Malays
font dans l’opinion que cette plante eft femée ainfi
fur les arbres par une efpece de grimpereau qu’ils
appellent cacopit ., qui en mange les graines, &
enfuite les rend avec fes excrémens fur les arbres
oh elles lèvent & eroiffent ; mais, fi l’on en
croit Rumphe , Cet oifeau ne vit que du fuc mielleux
de fes fleurs, & n’avale point fes graines ; elles
font portées par les vents fur différens arbres oh les
excrémens de divers oifeaux tombant deffus , les
appliquent, les empâtent , les enterrent pour ainfi
dire, & lés font germer.
Qualités. Vangrec n’a aucune odeur, même dans
fes fleurs ; mais lorfqu’on le froiffe entre les doigts
ou qu’on en exprime le fuc, il rend comme toutes
le^ autres plantes de la famille des orchis, une odeur
défagréable d’eau croupie.
Ufages. Dans M e de Ternate les dames , fur-tout
les princeffes du fang ro y a l, que l’on appelle putri
en langage Malays & , boki aux Moluques, fe font
tellement approprié l’ufage de cette plante ,
qu’ elles fe croiroient déshonorées fi des femmes
du commun , & encore plus des domeftiques ou
des efclaves, s’avifoient de parer leur tête de fes
fleurs ; de forte que les femmes, les foeurs ou les
filles des rois fe font réfervé feules le droit d’envoyer
chercher dans les bois les fleurs de Yangrec
pour les attacher dans leurs cheveux, perfuadées
que la nature elle-même en ne faifant croître cette
plante que fur des lieux é levés, leur démontre que
les fleurs ne peuvent convenir à des gens d’une baffe
condition , & c’eft de-là que leur eft venu le nom
de bonga putri ou bonga boki, qui veut dire fleur de
princefle. Les Malays qui habitent les autres îles
Moluques, emploient aufli Yangrec pour décorer
leurs appartenons ; à cet effet ils féparent de fa
•racine l’épi de fleurs & le bourgeon qui y tient,
& le placent, non pas dans de l’eau qui leur pro-
cureroit une odeur fétide, mais dans de la terre,
& la confervent ainfi pendant huit jours en fleur
lorfqu’ils ont attention de le cueillir au moment oh
celles d’en bas commencent à s’épanouir.
Cette plante a d’autres ufages que ceux de Ample
agrément. La moelle herbacée de la gaîne de
les bourgeons dépouillée de fa peau , pilée dans
l’eau falée avec un peu de curcuma , s’applique avec
fuccès fur les panaris, qui difparoiffent en peu de
tems , ou qui fe guériffent fans accidens lors même
qu’ils viennent à aboutir. La même moelle pilée avec
un peu de gingembre , appliquée en cataplafme fur
le ventre, y excite d’abord une légère démangeaifon,
mais c’eft un excellent vermicide qui débarraffe peu
après les inteftins de toutes les humeurs malignes
qui les rempliffent. On mâche fes bulbes ou bourgeons
jufqu’à ce qu’il s’enfuive une forte falivatiôn
pour difliper les aphtes de la bouche. Quoique
leur faveur foit fade & rafraîchiffante en apparence,
on les mêle avec les autres mêts pour les faire manger
à ceux qui ont la dyffenterie. Les habitans d’Am-
boine préparent avec fes graines qui reffemblent
à une farine jaune, une efpece de filtre qu’ils prétendent
fi puiffant, qu’une femme ne pourroit s’empêcher
d’aimer éperdument & de fuivre jufqu’à la
mort un homme qui auroit eu le feeret de lui en
faite boire ou manger.
Rumphe a obfervé deux autres efpeces ou variétés
de cette plante que nous allons rapporter*
iSeconde efpecei
Le cocotier produit encore uhë forte Yangrec qiie
quelques-uns regardent comme une efpece , parce
qu’en effet elle différé affez de la première. Elle
croît communément fur le côté du tronc des vieux
cocotiers. Sa racine forme une touffe de cônes longs,
menus , mais mous & non piquans, dônt la malle
feroit la charge d’un homme. Les gaines ou bour-
fes de fes bourgeons font, comme dans Yangrec
commun, mais liffes, fans articulations ; fes feuilles
ont treize à feize pouces de longueur, trois fois
moins de largeur, & font , par conféquent, plus
larges à proportion, mais plus épaiffes, fans nervures,
à l’exception d’un canal qui s’étend à leur milieu
fur toute leur longueur.
Sa tige, qui porte les fleurs en ép i, a jufqu’à
cinq pieds & demi de longueur ; elle eft cylindri-»
que, ferme,' prefque ligneufe,, de la groffeur du
‘petit doigt. Les cinq grandes feuilles de fes fleurs
font jaunes, peintes de cafa&efes bruns, qui, pour
l’ordinaire , ne forment que des taches affez greffier
es , quoique quelquefois on y diftingue affez
bien les trois lettres, A , I , O ; cette efpece fleurit
en novembre.
Troifleme efpece.
La troifiemé efpece croît plus communément fut
les groffes branches du mangier , & de quelques autres
arbres q ui, comme lu i, ont l’écorce fucculente.
Ses feuilles font plus grandes que dans les deux efpeces
précédentes ; elles ont vingt-fept à vingbhuit pouces
de longueur, trois à quatre pouces de largeur, & une
feule nervure longitudinale. Ses fleurs font au nombre
de cinquante à cinquante-deux fur ehaquè épi : leurs
taches repréfentent moins des caraéteres hébreux que
des lettres latines ; de forte que l’on peut, en
rangeant plufieurs de leurs feuilles par ordre, en
compofer différens noms.
Culture. On remarque que les branches de mangier
qui font ainfi couvertes de Yangrec , ne pro-
duifent que peu ou point de fruits.
Remarques. Par la defeription que l’on vient de
faire de Yangrec , on voit qu’il différé de la vanille
par fes feuilles qui font radicales, par fes fleurs dif-
pofées en ép i, & par fes fruits qui ne font nullement
charnus, d’où il fuit que cette plante ne de-
voit pas être confondue avec la vanille, comme
a fait M. Linné, qui lui donne le nom trop général
d’’épidendrum, mais former un genre particulier dans
la famille des orchis. (Af. A d a n son . )
ANGURI, f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) nom Malays
d’une efpece d’abutilon dont Rumphe nous a
laiffé une affez bonne figure quoiqu’incomplette,
fous le nom de abutilon hirfutum domefliçum , dans
fon Herbarium Amboinicum , volume lr , page 29 ,
planche X . Les Malays l’appellent encore bonga pe-
tang, c’eft-à-dire , fleur du fo ir , & les habitans de
Ternate tobba-toko.
C ’eft un arbriffeau de cinq à fix pieds de hauteur,
qui ne vit pas plus de deux ans. Sa racine
eft longue , peu ramifiée , blanche, moins mucila- 4
gineufe que celle de la guimauve. Sa tige , qui n’a
guere qu’un pouce de diamètre, eft d’un bois blanc,
fragile &C léger, & fe ramifie, dès fon origine , en
plufietirs branches affez écartées, longues, cylindriques,:
velues, c’eft-à-dire , hériffées de poils
longs écartés , mais doux au toucher.
Ses feuilles font alternes , affez écartées, tail*
lees en coeur echancré d’un fixieme à fon origine,
très-pointues à leur extrémité, longues de quatre
pouces, d’un tiers moins larges, marquées de vingt
dents de chaque côté, verd-jaune dans leur jeune
ffe , plus foncées dans leur vieillefle, molles ,
velues , vifqueufes , à trois nervures de- chaque
côté de la côte principale, portées fur un pédicule
cylindrique de leur longueur, hérifle de poils comme
les branches, &c accompagné à fon origine de
deux ftipules qui tombent peu de tems après leur
cpanouiffement.
De l’aiffelle de chaque feuille fort un péduncule
prefqu’-égal à leur pédicule, cylindrique & hériffé
comme lui,qui porte une feule fleur jaune à fond brun,
ouverte ,en étoile, d’un pouce de diamètre , com-
pofée de cinq pétales réunis comme dans la mauve
, Ôndes, qui fortent d’un calice fimple d’une feule
çiece , découpé jufqu’à fon milieu en cinq parties,
égales triangulaires. Les étamines , au nombre de
vingt-cinq à trente, à anthères jaunes , font réunies
pat leurs filets" en un cylindre creux, attaché aux
pétales de la corolle , & traverfé paf le ftyle de l’ovaire
qui fe fourche en quinze à feize ftyles , couronnes
par autant de ftigmates cylindriques velus.
L’ovaire, en mûriffant, devient une capfule hémisphérique
, tronquée ou déprimée en-deffus, affez
'femblable à un trépan, d’abord verd-pâle , enfuite
brune enfumée , marquée de quinze à feize cannelures
correfpondantes à autant de loges qui s’ouvrent
comme autant de capfules , chacune en deux
valves ou battans , & qui contiennent deux ou
trois femences taillées en rein , petites, dures,
noirâtres, ordinairement avortées.
Culture.- l\ eft fi rare de trouver des graines
mûres fur cette plante , qu’on eft obligé
pour la multiplier d’enlever les drageons ou oeilletons
qui fortent de fa fouche , Sc de les repiquer
dans un terrein frais & herbeux. Elle eft commune
à Java & à Balea , mais ort ne la trouve que dans
les.jardins à Amboine, où elle fe reproduit du pied,
£à racine mourant tous les deux ans.
Qualités. Uanguri n’a , dans toutes fes parties -,
même dans fes fleurs , d ’autre odeur que celle de
la mauve quand onia froiffe. Ses fleurs cueillies prennent
, comme lorfqu’elles fe fanent naturellement,
une couleur brune. Elles ont une heure fixe pour
s’épanouir ; dans les tems fereins , c’eft communément
à deux ou trois heures du foir , Sc elles ne
reftent ainfi guere plus dûine heure, après quoi
' fes pétales fe recourbent en dedans, Sc reftent ainfi
jufqu’au coucher du foleil où elles fe ferment entièrement,
comme fubitement, pour ne plus s’ou-
,Vrir.
Ufàges. Cette plante fert, comme la mauve &Ia
guimauve,en bain, en fomentation, emplâtres & cata-
plafmes, pour adoucir,calmer & difliper les douleurs.
La poudre de fes graines fe boit jà la dofe d’un
demi-gros dans le vin contre les douleurs néphrétiques.
Une once de fes graines eft fi foporative, que
ceux qm en prennent cette dofe ne peuvent être
teveules de leur fommeil qu’avec le fecoùrs du
vinaigre , dont on frotte leurs narines.
Remarques. Quoique M. Burmann ait confondu,
oL M. Linné après lu i, le beloëre du Malabar avec
cette efpece-, il ne faut que confulter les def-
criptions & les figures de ces deux plantes pour
Atome 1,
sappercevoir qu’elles font d’e/peces différentes. M.
Lmné défigne celle-ci par le nom de fida , afiatica,
folus cardans indivfi, , ftipulis reflexis , pcdunculis
Longioribus , capfults mulâloeiUaribus hirfiuis , calice
brevwnbus ; dans la derniere édition de fon Syßema
narurx , imprimé en .76 7, page g. Mais indépendamment
de la confufion que cet auteur fait
de cette plante avec le beloëre, fa defeription renferme
plufieurs erreurs : d'abord le fida des anciens
Orées etott le grenadier ; ainfi on ne peut pas rai-
jonnablement tranlporter ce nom à une efpece. dV
butiion, & encore moins à une efpece qui a déjà
un nom : en fécond lieu, il n’eft pas vrai que la
capfule de languri foit plus courte que le calice
de la fleur > elle le déborde de près de moitié,
f M . A D d N S O N . )
ANHINGA , f. m. ( Hiß. nat. Ornitholog. ) genre
doifeau aquatique de la famille des cormorans ,
celt-a-dire, de ceux dont les jambes font entièrement
emplumées, & les doigts, au nombre de quatre,
réunis enfemble d’un bout à l’autre par une
membrane fort lâche.Marcgrave nous en adonnéune
allez mauvatfe figure dans fon Hiftoirc naturelle du.
Brijile page n d , qui a été copiée par Jonlton.
-s iv. page *49 t planche Go. Moerhing lui donne le
nom de punx, Avium, page % , & Klein celui de
planem Brafihenfis anhmga. vocatus. Avi. page to i
j, s - M- Briffon l’appelle anhmga fupemï nigricans,
maculis albidis varia, infime albtuargentea ; capile &
collo fiuperiore grij'eo - mfefcentibus ; gamin & colla
inferiore grifeis , Urrhopygio reclricibusque fplendidb
nigris... Anhinga. Ornithologie , volume W, page 49 Cf.
Il eft commun au Bréfil Sc à Cayenne, oit, félon
Barrette , il eft appelle plongeon ordinaire. Anhin-a
eft le nom que les Topinatnbous du Bréfil lui donnent.
Sa grandeur eft à-peu-près celle du canard
domeftique. Du bout du’bec au bout de la quéue
il a trente-quatre pouces;, jufqu’aux bouts des ongles
vingt-lept pouces. La longueur de fon bec
depuis fa pointe jufqu’aux coins de fa bouche
eft de deux pouces 8c demi;.celle de fa queue
fept pouces Sc demi , dé fon pied un pouce 8c un
quart, de fon doigt le plus long avec l’ongle deux
pouces Sc demi. Sa tête eft menue Sc alongée ; ainfi
que ion cou qui eft long d’un pied. Ses ailes , lorf-
qu’eUes font pliées , atteignent jufqu’au milieu de
lalongueurde fa queue ; Sc étendues, elles onttrois '
pieds un pouce de vol.
La forme de fon bee eft conique , très-alon^ée ,
comparable à celle du bec du héron , mais
beaucoup plus menue à proportion & extrêmement
aigue: chaque demi-bec eft dentelé fur fes côtés
dans fa moitié fupérieure, de dents extrêmement fines
tournées en arriéré. Sa queue eft large, arrondie,
compofée de douze plumes, dont les extérieures
font tant foit peu plus courtes.
Ses yeux font noirs, avec un iris jaune d’or; fon
bec gris, excepté vers fon origine qui eft iin peu jaunâtre.
Ses pieds & fes doigts, avec leur membrane, •
font d’un gris tirant fur le jaune obfcur ; fes ongles
font gris. Les plumes qui recouvrent la tête & le
deffus du cou font tres-étroites, d’un jaune grisâtre,
& douces au toucher comme un velours ; celles du
deffous du cou font grifes. La poitrine, le ventre,
les cuiffes & les jambes font recouvertes de plumes
molles & argentées. Le dos eft noir , ainfi que les
ailes & la queue qui eft luifante, avec l’extrémité
grife. Le commencement du dos & les ailes font
- couverts de plumes étroites brunes, qui portent à
• leur milieu une tache oblongue d’un blanc-jaunâtre ;
ce lies qui-bordent ces plumes font blanches d’un côté \
& noires dé l’autre.
Moeurs. Uanhinga nage comme le plongeon fur
les rivières d’eau douce , où il fait, avec beaucoup
I i i