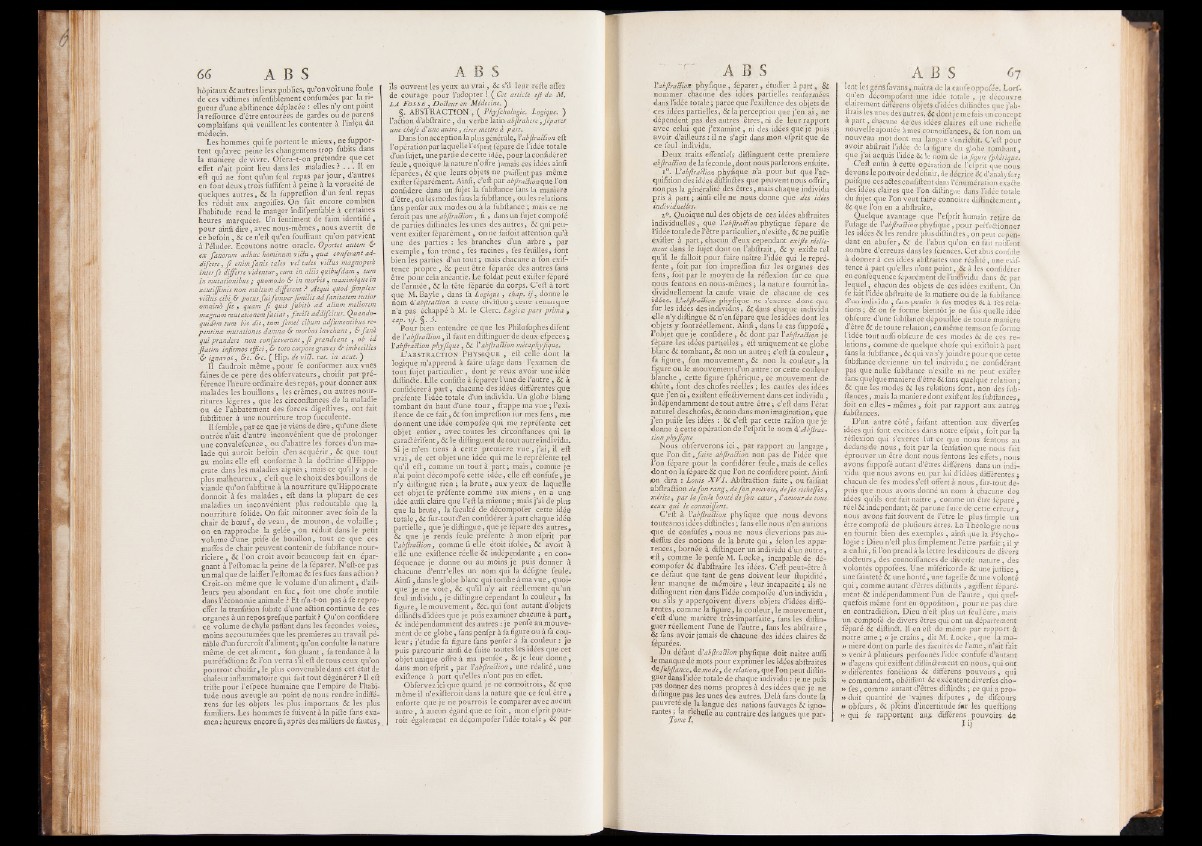
hôpitaux & autres lieux publics, qu’onvoitune foule
de ces vi&imes infenfiblement confumées par la rigueur
d’une abftinence déplacée : elles n’y ont point
la reffource d’être entourées de gardes ou de parens
complaîfans qui veuillent les contenter à l’infçu du
médecin.
Les hommes qui fe portent le mieux, ne fuppor-
ïent qu’avec peine les changemens trop fubits dans
la maniéré de vivre. Ofera-t-on prétendre que cet
effet n’ait point lieu dans les maladies ? . . . Il en
eft qui ne font qu’un feul repas par jour, d autres
en font deux j trois fuffifent à peine à la voracité de
quelques autres, & la fupprefïion d’un feul repas
les réduit aux angoiffes. On fait encore combien
l’habitude rend le manger indifpenfable à certaines
•heures marquées. Un fentiment de faim identifie ,
pour ainfi dire, avec nous-mêmes, nous avertit de
ce befoin, & ce n’eft qu’en foufffant qu’on parvient
à l’éluder. Ecoutons notre oracle. Oportet autem &
ex fanôrum adhuc hominum victu , quee conférant ad-
difcxre, f i eni/pfanis taies vel taies vicias magnoperl
inferfe differre \identur, cum in aliis quibufdam , tum
in mutationibus ; quomodo <5* in morbis, maximeque in
acutiffimis non multurn different ? Atqui quod fimplex
vicias cibi & potus fu i femperfimilis adfanitatem tutior
omninb f i t , quant f i quis fubitb ad alium meliorem
magnam mutationem faciat, facile addifcitur. Quando-
quidlm tum. bis die, tum femel cibum adfumentibus re-
pentince mutationes damna & morbos invehunt, & fané
qui prandere non confueverunt, f i prandeant , ob id
fiatim infirmos effici, & toto corpore graves & imbecilles
& ignavos, &c. &c. ( Hip. de vict. rat. in août. )
Il faudroit même, pour fe conformer aux vues
faines de ce pere des obfervateurs, choifir par préférence
l’heure o rd in a ir e des repas, pour donner aux
malades les bouillons , les crèmes, ou autres nourritures
légères , que les circonftances de la maladie
ou de l’abbatement des forces digeftives, ont fait
fubftituer à une nourriture trop fucculente.
Il femble, par ce que je viens de dire, qu’une diete
outrée n’ ait d’autre inconvénient que de prolonger
une convalefcence, ou d’abattre les forces d’un malade
qui auroit befoin d’en acquérir, & que tout
au moins elle eft conforme à la doûrine d’H ip p o c
r a t e dans les maladies aiguës ; mais ce qu’il y a de
plus malheureux, c’eft que le choix des bouillons de
viande qu’on fubftitue à la nourriture qu’Hippocrate
donnoit à fes malades, eft dans la plupart de ces
maladies un inconvénient plus redoutable que la
nourriture folide. On fait mitonner avec foin de la
chair de boe u f, de v e au , de mouton, de volaille ;
on en-rapproche la gelée , on réduit dans le petit
volume d’une prife de bouillon, tout ce que ces
maffes de chair peuvent contenir de fubftance nourricière
, 6c l’on croit avoir beaucoup fait en épargnant
à l’eftomac la peine de la féparer. N ’eft-ce pas
un mal que de laiffer l’eftomac 6c fes fucs fans aftion ?
Croit-on même que le volume d’un aliment, d’ailleurs
peu abondant en fu c , foit une chofe inutile
dans l’économie an im a le ? Et n’ a - t -o n pas à fe reprocher
la tranfition fubite d’une aftion continue de ces
organes à un repos prefque parfait ? Qu’on confidere
ce volume de chyle paflant dans les fécondés voies,
moins accoutumées que les premières au travail pénible
d’unfurcroît d’aliment; qu’on confulte la nature
même de cet aliment, fon gluant, fa tendance à la
putréfaftion : 6c l’on verra s’il eft de tous ceux qu’on
pourroit choifir, le plus convenable dans cet état de
chaleur inflammatoire qui fait tout dégénérer ? 11 eft
trifte pour l’efpece humaine que l’empire de l’habitude
nous aveugle au point de nous rendre indiffé-
rens fur les objets les plus importans 6c les plus
familiers. Les hommes fe fuivent à la pifte fans examen;
heureux encore fi,après des milliers de fautes,
ils ouvrent les yeux au v ra i, 6c s’il leur refte allez
de courage pour l’adopter ! ( Cet article efi de M.
LA F o s s e , Docteur en Médecine. )
§ . ABSTRACTION , ( Phyfchologie. Logique. )
l’aftion d’abftraire , du verbe latin abfirahere, Jéparer.
une chofe d'une autre, tirer mettre à part.
Dans fon acception la plus générale, Y abftraction eft
l’opération par laquelle l’éfprit fépare de l’idée totale
d’un fujet, une partie de cette idée, pour la confidérer
feule, quoique la nature n’offre jamais ces idées ainfi
féparées, 6c que leurs objets ne puiffent pas même
exifterféparément. Ainfi, c’eft par abfractionne l’on
confidere dans un fujet la fubftance fans la maniéré
d’être, ou les modes fans la fubftance, ou les relations
fans penfer aux modes ou à la fubftance ; mais ce ne
feroit pas une abftraction, fi , dans un fujet compofé
de parties diftinties les unes des autres, & qui peuvent
exifter féparément, on ne faifoit attention qu’à
une des parties : les branches d’un arbre , par
exemple, fon tronc, fes racines, fes feuilles, font
bien les parties d’un tout ; mais chacune a fon existence
propre , 6c peut être féparée des autres fans
être pour cela anéantie. L e foldat peut exifter féparé
de l’armée, 6c la tête féparée du corps. C ’eft à tort
que M. Bayle , dans fa Logique , chap. i j , donne le
nom d'abftraction à cette divifion ; cette remarque
n’a pas échappé à M. le Clerc. Logicte pars prima ,
cap. vj. § . S.
Pour bien entendre ce que les Philofophes difent
de Y abftraction, il faut en diftinguer de deux efpeces ;
Y abfraction phyfique , 6c l’ab[traction métaphyfique.
L’abstraction Physique , eft celle dont la
logique m’apprend à faire ufage dans l’examen de
tout fujet particulier, dont je veux avoir une idée
diftin&e. Elle confifte à féparer l’une de l’autre , 6c à
confidérer à pa rt, chacune des idées différentes que
préfente l’idée totale d’un individu. Un globe blanc
tombant du haut d’une tou r , frappe ma vue ; l’exi.
ftence de ce fait, 6c fon imprefîion fur mes fens,. me
donnent une idée çompofée qui me repréfente cet
objet entier, avèctoutes les circonftances qui le
caraûérifent, 6c le diftinguent de tout autre individu.
Si je m’en tiens à cette première v u e , j’ai, il eft
v r a i, de cet objet une idée qui me le repréfente tel
qu’il e ft , comme un tout à part; mais , comme je
n’ai point décompofé cette idée, elle eft corifufe, je
n’y diftingue rien ; la b rute, aux y eux de laquelle
cet objet fe préfente comme aux miens , en a une
idée aufli claire que l’eft la mienne ; mais j’ai de plus
. que la brute, la faculté de décompofer cette idée
totale, 6c fur-tout d’en confidérer à part chaque idée
partielle, que je diftingue, que je fépare des autres,
6c que je rends feule préfente à mon efprit par
Y ab fraction, comme fi elle étoit ifolée, & avoit à
' elle une exiftence réelle 6c indépendante ; en conféquenee
je donne ou au moins je puis donner à
chacune d’entr’elles un nom qui la défigne feule.;
Ainfi, dans le globe blanc qui tombe à ma v u e , quoiq
u e 'je ne v o ie , 6c qu’i l n’y ait réellement qu’un
feul individu, je diftingue cependant la couleur, la
figure, le mouvement, &c. qui font autant d’objets
diftinâs d’idées que je puis examiner chacune à part,
I 6c indépendamment des autres : je penfe au mouve-
| ment de ce globe, fans penfer à fa figure ou à fa couleur
; j’étudie fa figure fans penfer à fa couleur : je
puis parcourir ainfi de fuite toutes les idées que cet
! objet unique offre à ma penfée , 6c je leur donne ,
| dans mon efprit, par Y ab (traction, une réalité, une
exiftence à part qu’elles n’ont pas en effet.
Obfervez ici que quand je ne connoîtrois, 6c que
même il n’exifteroit dans la nature que ce feul être ,
enforte que je ne pourrois le comparer avec aucun
autre, à aucun égard que ce fo i t , mon efprit pourroit
également en déçompofer l’idée totale, 6c par
Y ab fraction, phyfique , féparer, étudier à part, 6t
nommer chacune des idées partielles renfermées
dans l’idée totale ; parce que l’exiftence des objets de
ces idées partielles, & la perception que j’en a i, ne
dépendent pas des autres êtres, ni de leur rapport
avec celui que j’examine , ni des idées que je puis \
avoir d’ailleurs : il ne s’agit dans mon efprit que de
ce feul individu.
Deux traits effentieîs diftinguent cette première
abfiraction de la fécondé, dont nous parlerons enfuite.
■ i° . Vah fraction phyfique n’a pour but que l’a,c-
quifition des idées diftinftes que peuvent nous offrir,
non pas la généralité des êtres, mais chaque individu
pris à part ; ainfi elle ne nous donne que des idées
individuelles»
2°. Quoique nul des objets de ces idées abftraites
individuelles, que Yabfiraction phyfique fépare de
l’idée totale d.e l’être particulier, n’exifte, 6c ne puiffe
exifter à part, chacun d’eux .cependant exifte réciter
ruent dans le fujet dont on l’abftrait, & y exifte tel
qu’il le falloit pour faire naître l’idée qui le repréfente
, foit par fon imprefîion fur les organes des
fens, foit par le moyen de la réflexion fur ce que
nous fentons en nous-mêmes ; la nature fournit in- j
dividuellement la caufe vraie de chacune de ces.
idées. \t ab fraction phyfique rie s’exerce donc que
fur les idées des individus, ,6c dans chaque individu
elle n’y diftingue & n’en fépare que les idées dont les.
objets y fontréellement. Ainfi, dans le cas fuppofé,
l ’objet que je confidere , 6c dont par Y ab fraction je
fépare les idées partielles, eft uniquement ce globe
blanc 6c tombant, 6c non un autre ; c’eft fa cotueur,
fa figure, fon mouvement, 6c non la couleur, la
figure ou le mouvement d’un autre : or cette couleur
blanche , cette figure fphérique, ce mouvement de
chute, font des chofes réelles ; les caufes des idées
que j’en a i, exiftent effectivement dans cet individu,
indépendamment de tout autre être ; c’eft dans l’état
naturel des chofes, & non dans mon imagination, que
j ’en puife les idées : 6c c’eft par cette raifon que je
donne à cette opération de l’efprit le nom à.'Ab fraction
phyfique
Nous observerons ic i , par rapport au langage,
que l’on dit, faire abfiraction non pas de l’idée que
l ’on fépare pour la confidérer feule, mais de cèlles
dont on la fépare & que l’on ne confidere point. Ainfi
on dira : Louis X V I . Abftra&ion faite , ou faifant
abftradion de fon rang, de fon pouvoir, defes richeffes,
mérite, par la feule bontéde fon coeur, l'amour de tous
ceux qui le connoijfent.
C ’eft à Yabfraclion phyfique que nous devons
toutes nos idees diftinâes ; fans elle nous n’en aurions
que de confufes , nous ne nous élèverions pas au-
deffus des notions de la brute qui, félon les apparences,
bornée à diftinguer un individu d’un autre,
eft, comme le penfe M. L ocke, incapable de décompofer
& d’abftraire les idées. C ’eft peut-être à
ce défaut que tant de gens doivent leur ftupidité,
leur manque de mémoire , leur, incapacité ; ils ne
d ift in gu e n t rien dans l’idée çompofée d’un individu ,
pu s’ils y apperçoivent divers objets d’idées différentes,
comme la figure, la couleur, le mouvement,
c’eft d’une maniéré très-imparfaite, fans les diftinguer
réellement l’une de l’autre, fans les abftraire,
de fans avoir jamais de chacune des idées claires &
feparées.
Du défaut à'abftraction phyfique doit naître aufli
le manque de mots pour exprimer les idées abftraites
*1 zfubfian.ee, dé modé, de relation, que l’on peut diftinguer
dans l’idée totale de chaque individu : je ne puis
pas donner des noms propres à des idées que je ne
diftingue pas les unes des autres. Delà fans doute la
pauvreté de la langue des nations fauvages & igno- I
rantes; la richeffe au contraire des langues que par- I
f r n e u »
lent les gériS fa vans, naîtra de la caufe Oppofée. Lorf-
qu’en décompofant une idée totale , je découvre
clairement diftërens objets d’idées diftinéles que j’ab-
ftrais les unes des autres, & dont je me fais un concept
à part, chacune de ces idées claires eft une richeffe
nouvelle ajoutée âmes çonnoiflances, & fon nom un
nouveau mot dont ma langue s’enrichit. C ’eft pour
avoir abflrait l’idée de la figure du globe tombant,
que j ai acquis 1 idee & le nom de la figure fphérique.
C ’eft enfin à cette opération de l’elprit que nous
devons le pouvoir de définir, de décrire 6c d’analy fer;
puifquç ces aéles confiftent dans l’énumération exafte,
des idées claires que l’on diftingue dans l’idée totale
du fujet que l’on veut faire connoître diftin&ement,
6ç que l’on en a abftrajte.
Quelque avantage que l’ efprit humain retire de
l’ufage de Yabfraclion phyfique, pour perfectionner
les idées 6c les rendre plus diftinéles, on peut cependant
en abufer, 6c de l’abus qu’on en fait naiffent
nombre d’erreurs dans les feiences. C et abus confifte
à donner à ces idées abftraites une réalité, une exiftence
à part qu’elles n’ont point , f6c à les confidérer
en conféquence féparément de l’individu dans & par
lequel, chacun des objets de ces idées exiftent. On
fe fait l’idée abftraite de la matière ou de la fubftance
d’un individu , fans penfer à fes modes 6c à fes relations
; &: on fe forme bientôt je ne fais quelle idée
qbfcure d’une fubftance dépouillée de toute maniéré
d’être & de toute relation; en même temsonfe forme
l’idée tout aufli obfcure de ces modes 6c de ces relations
, comme de quelque chofe qui exiftoit à part
fans la fubftance, 6c qui va s’y joindre pour que cette
. fubftance devienne un tel individu ; ne confidérant
pas que nulle fubftance n’exifte ni ne peut exifter
fans quelque maniéré d’être & fans quelque relation;
& que les modes 6c les relations font, non des fub-
ftances, mais la maniéré dont exiftent les fubftances,
foit en elles - mêmes, foit par rapport aux autres
fubftances.
D ’un autre côté', faifant attention aux diverfes
idées cjui font excitées dans notre efprit, foit par la
réflexion qui s’exerce fur ce que nous fentons au
dedans de nous , foit par la fenfation que nous fait
éprouver un être dont nous fentons les effets, nous
ayons fuppofé autant d’êtres différens dans un individu
que nous avons eu par lui d’idées différentes ;
chacun de fes modes s’eft offert à nous, fur-tout depuis
que nous avons donné un nom à chacune des
idées qu’ils ont fait naître , comme un être féparé ,
réel & indépendant; 6c parune fuite de cette erreur ,
nous avons fait fouvent de l’être le plus fimple un
être compofé de plusieurs êtres. La Théologie nous
en fournit bien des exemples , ainfi que la Pfycho-
logie : Dieu n’eft plus Amplement l’ëtre parfait ; il y
a en lui, fi l’on prend à la lettre les difeours de divers
docteurs, des connoiffances de ddverfe nature , des
volontés oppofées. Une miféricorde 6c une juftice ,
une faintete 6c une bonté., une fageffe 6c une volonté
q u i, comme autant d’êtres diftincts , agiffent féparément
& indépendamment l’un de l’autre, qui quelquefois
même font en oppofition, pour ne pas dire
en contradiction. Dieu n’eft plus uri feul être, mais
un compofé de divers êtres qui ont un département
féparé 6c diftinét. Il en eft de même par rapport à
notre ame ; « je crains, dit M. Locke, que la ma-
» niere dont on parle des facultés de l ’ame, n’ait fait
» venir à plufieurs perfonnès l’idée confufe d’autant
» d’agens qui exiftent diftinétement en nous, qui ont
>» differentes fonctions & différens pouvoirs, qui
» commandent, obéiflent 6c exécutent diverfes cho-
» fe s, comme autant d’êtres diftinéts ; ce qui a pro-
» duit quantité de 'vaines difputes , de difeours
» obfcurs, & pleins, d’incertitude fur les queftions
» qui fe rapportent auÿ “différens pouvoirs de