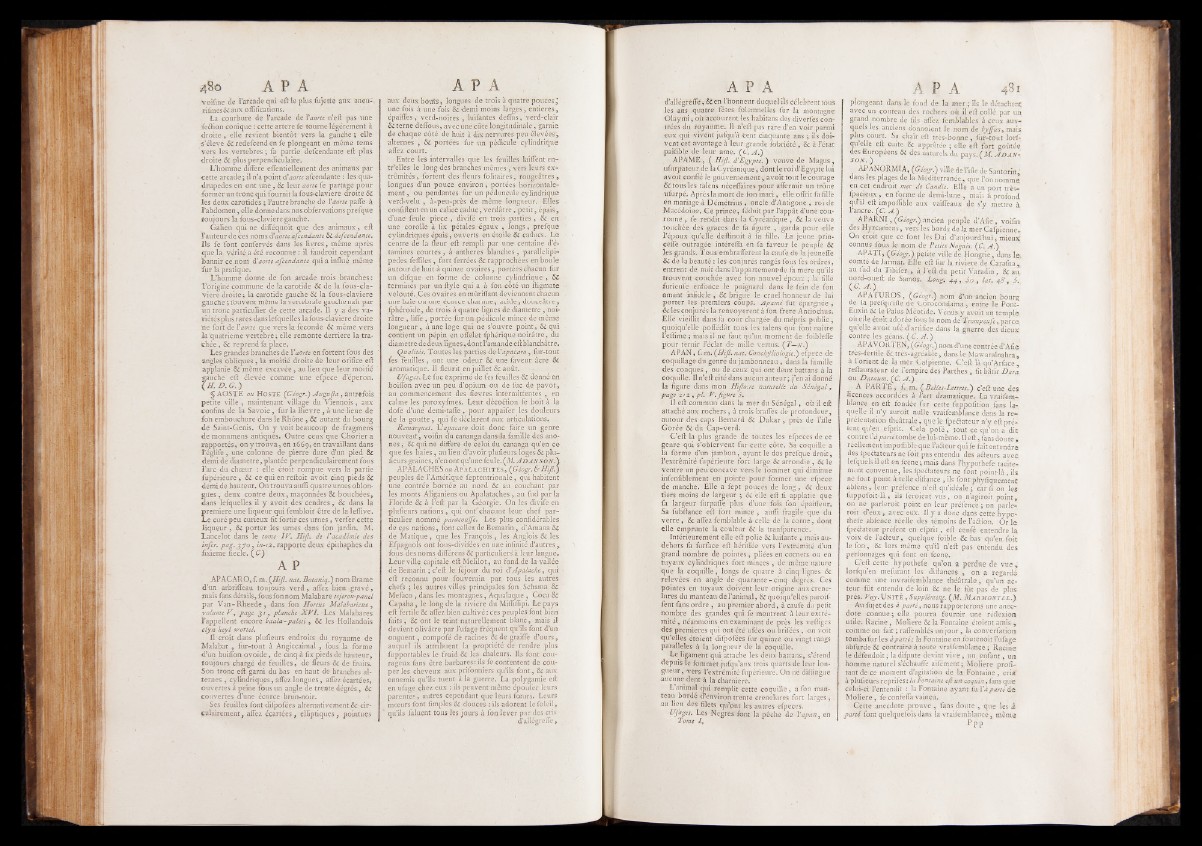
Voîfihe de l’arcade qui eft le plus fujétte atix àneù-
•rifmes& aux oflifications.
La courbure de l’arcade de Vaorte n’eft pas une
fedion conique : cette artere fe tourne légèrement à
droite , elle revient bientôt vers la gauche ; elle
s’élève & redefcend en fe plongeant en même teins
vers les vertebres ; fa partie defcendante eft plus
droite & plus perpendiculaire.
L’homme différé effentiellement des animaux par
cette arcade ; il n’a point d'aorte afcendante : les quadrupèdes
en ont une, & leur aorte fe partage pour
former un tronc qui fournit la fous-claviere droite &
-les deux carotides ; l’autre branche de Vaorte paffe à
l’abdomen, elle donne dans nos obfervations prefque
toujours la fous-claviere gauche.
Gàlien qui ne difféquoit que des animaux, eft
l’auteur de ces noms d'aorte afcendante & defcendante.
Ils fe font confervés dans les livres, même après
que la^ vérité a été -reconnue : il faudrait cependant
bannir ce.nom d'aorte afcendante qui a influé même
fur la pratiqué.
L’homme donne de fon arcade trais -branches :
l ’Origine commune de la carotide & de la fous-claviere
droite; la carotide gauche & la fous-claviere
gauche ; fouvént même la vertébrale gauche naît par
un tronc particulier de cette arcade. 11 y a des variétés
plus rares danslefquelles lafous-claviere droite
ne fort de Vaorte que vers la fécondé & même vers
la quatrième vertebre ; elle remonte derrière la tra-
th é e , & reprend fa place.
Les grandes branches de Y aorte en fortent fous des
angles obliques, la moitié droite dé leur orifice eft
ap'planie & même excavée, au lieu que leur moitié
gauche eft élevée comme une efpece d’éperon.
{H .D . G .)
§ AOSTE ou H o s t e (Géogr.) Augufla ^autrefois
petite v ille , maintenant village du Viennois, aux
confins de la Savoie, fur la Bievre , à une lieue de
fon embouchure dans le Rhône , & autant du bourg
dé Saint-Genis. On y voit beaucoup de fragmens
de monumens antiques. Outre ceux' que Chorier a
rapportés, on y trouva, en 1669, en travaillant dans
l’églife, une colonne de pierre dure d’un pied &
demi de diamètre, plantée perpendiculairement fous
l’arc du choeur : elle étoit rompue vers la partie
fupérieure, & ce qui en reftoit avoit cinq pieds &
demi.de hauteur. On trouva aufli quatre urnes oblon-
gues , deux contre deux, maçonnées & bouchées,
dans lefquelles il y avoit des cendres , & dans la
première une liqueur qui fembloif être de la leflive.
Le curé.peu curieux fit fortir ces urnes, verfer cette
liqueur, & porter les urnes dans fon jardin. M.
Lancelot dans le tome IV. Hifi. de 1'académie des
infer. pag. 3 70 , in-12, rapporte deux épithaphes du
fixieme fiecle. ( C)
AP
APACARO, f. m. (Hifi. nat. Botaniq.) nom Brame
d’un arbriffeau toujours v e rd , allez bien gravé,
mais fans détails, fous fon nom Malabare tsjerou-panel
par Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus,
volume V 1 page 3 1 , planche XVI. Les Malabares
l ’appellent encore baala-paleti, & les Hollandois
clyn heyl wortel.
Il croît dans plufieurs endroits du royaume de
Malabar , fur-tout à Arigiccaimal , fous la forme
d’un buiffon ovoïde, de cinq à lix pieds de hauteur,
toujours chargé de feuilles, de fleurs & de fruits.
Son tronc eft garni du bas en haut de branches alternes
, cylindriques, allez longues, allez écartées,
ouvertes à peine fous un angle de trente dégrés, &
couvertes d’une écorce brun-noir.
Ses feuilles font difpofées alternativement & cir-
çulairement, allez écartées, elliptiques, pointues
aux deux bouts, longues de trois à quatre pouces ^
une fois à une fois & demi moins larges, entières,
épaiffes ,• verd-noires , luifantes deffus, verd-clair
& terne deffous, avec une côte longitudinale /garnie
de chaque côté de huit à dix nervures peu élevées,
alternes * & portées fur un pédicule cylindrique
-allez Court.
Entre les intervalles que les feuilles laiffent en-
tr’elles le long des branches mêmes , vers leurs extrémités,
fortent des fleurs folitaires , rougeâtres ,
longues d’un pouce énviron, portées horizontalement,.
ou pendantes fur un péduncule cylindrique
verd-velu , à-peu-près de même longueur. Elles
confiftent en un calice caduc, verdâtre, petit, épais ,
d’une feule piece , divifé en trois parties , & en
une corolle à lix pétales -égaux , longs, prefque
cylindriques épais, ouverts en étoile & caducs. Le
centre de la fleur eft rempli par une centaine d’étamines
courtes , à anthères blanches, parallelipi-
pedes felïiles , fort ferrées & rapprochées en boule
autour de huit à quinze ovaires, portées chacun fur
un difque en forme de colonne cylindrique , 8c
terminés par un ftyle qui a à fon coté un ftigmate
velouté._Ces ovaires en murilïant deviennent chacun
une baie ou une écorce charnue, acide, douceâtre,
fphéroïde, de trois à quatre lignes de diamètre , -noirâtre
, liffe , portée, fur un pédicule mince de même
longueur , à une loge qui ne s’ouvre point, & qui
contient un pépin en offelet fphérique noirâtre, du
diamètre de deux lignes, dont l’amande eft blanchâtre.
Qualités. Toutes les parties de Yapacaro, fur-tout
fes feuilles, ont une odeur & une faveur âcre &
aromatique. Il fleurit en juillet & août.
Ufiges. Le fuc exprimé de fes feuilles & donné en
boiffon avec un peu d’opium ou de fuc de pavot,
au commencement des fievres intermittentes , en
calme les paroxyfmes. Leur déçodion fe boit à la
dofe d’une demi-taffe, pour appaifer les douleurs
de la goutte, qui fe déclarent aux articulations..
Remarques. apacaro doit donc faire un genre
nouveau, voifin du cananga dans 4a famille des ano-
nes ; & qui ne diffère de celui du cananga qu’en ce
que fes baies, au lieu d’avoir plufieurs loges & plufieurs
graines, n’en ont qu’une feule. (M. 4 d a n s o n .}
APALACHES ou Ap a l a ch itEs , (Géogr. & Hifi.)
peuples de l’Amérique feptentrionale, qui habitent
une contrée bornée au nord- & au couchant par
. les monts Aligàniens ou Apalataches, au fud par la
Floride & à l’eft par la Géorgie. On les divife en
plufieurs nations, qui ont'chacune leur chef particulier
nommé paracoujfe. Les plus confidérables
de ces nations, font celles de Bemarin, d’Amana ôc
de Matique, que, les François, les Anglois & les
Efpagnols ont fous-divifées en une infinité d’autres ,
fous des noms différens & particuliers1 à leur langue.
Leur ville capitale eft Melilot, au fond de la vallée
de Bemarin ; c’eft le féjour du roi d'ApaLache, qui
eft reconnu pour fouverain par. tous les „autres
chefs ; les autres villes principales fon . Schama &
Mefacô, dans les montagnes, Aqualaque , Coca ôc
Capaha, le long de la riviere du Mifluïipi. Le pays
eft fertile & affez bien cultivé : ces peuples font bien
faits , & ont le teint naturellement blanc, mais il
devient olivâtre par l’ufage fréquent qu’ils font d’un
onguent, compofé de racines & de graiffe d’ours,
auquel ils attribuent la propriété de rendre plus
fupportables le froid & les chaleurs. Ils font courageux
fans être barbares: ils fe contentent de couper
les cheveux aux prifonniers qu’ils font, & aux
ennemis qu’ils tuent à la guerre. La polygamie eft
en ufage chez eux : ils peuvent même époufer leurs
parentés, autres cependant que leurs foeurs. Leurs
moeurs font Amples & douces : ils adorent lefoleil,
qu’ils faluent tous les jours à fon lever par des cris
d’allégréffë, Sî en l’honneur duquel ils célèbrent tous
les ans quatre fêtes folemnelles fur là montagne
Olayrhi, où accburent les habitans des diverfes contrées
du royatime. Il n’eft pas rare d’en voir'-parmi
eux qui vivéht jufqu’à Cent cinquante ans ; ils dor-
vent cet avantage à leur grande fobriété , & à l’état
paifible de leur ame. (C. A.)
APAMÉ , ( FUß. d'Egypte. ) veuve de Magus,
ufurpateur de la Cyréanique, dont le roi d’Egypte lui
avoit confié le gouvernement-, avoit tout le courage
& tous les tâléns néceffaires pour affermir un trône
nfurpé. Après la mort de fon mari, elle offrit fa fille
en mariage à Démétrius , oncle d’Antigone, roi de
Macédoine. Ce prince, féduit par l’appât d’uné couronné
y fe rendit dans la Cyréanique , & la veuve
touchée deS grâces de fa figure , garda pour elle
l’époux qu’ellé deftinoit à fa fille. Là.jeune prin-
çëfle outragée intéreffa en fa faveur le peuple &
les grands. Tous embrafferent la caufe de la jeuneffe
& de la beauté : les conjurés rangés fous fes ordres,
entrent dé nuit dans l’appartement-de fa mère qu’ils
trouvent couchée avec fon nouvel époux ; la fille
furieufe énforiçe le poignard dans lé fein de fon
amant infidèle , & brigue le cruel honneur de lui
porter les premiers coups. Ap am é fut épargnée ,
& les conjurés la renvoyèrent à fon frere Antiochus.
Elle vieillit dans fa cour chargée du mépris public,
quoiqu’elle poffédât tous les talens qui fönt naître
l’eftime ; mais il ne faut qu’un moment de foibleffe
pour tfernir l’éclat de mille vertus. (T—N.}
A PAN, f. m. (Hifi. nat. Conchyliologie?) efpece de
coquillage du genre du jambonneau, dans la famille
des conquèS , ou de ceux qui ont deux battans à la
coquille. Il n’eft cité dans aucun auteur; j’en ai donné
la figure dans mon Hfioire naturelle du Sénégal,
page 2 12, pi. V.figure S.
Il èft commun dans la mer du Sénégal, oîi il eft
attaché aux rochers, à trois braffes de profondeur,
autour des caps Bernard & Dakar, près de l’ifle
Corée & du Cap-verd.
C’eft la plus grande de toutes les efpeces de ce
genre qui s’obfervent fur cette côte. S'a coquille a
la forme d’un jambon, ayant le dos prefque droit,
l’extrémité fupérieure fort large & arrondie , & le
ventre un peu concave vers le fommet qui diminue
infenfiblement en pointe pour former une efpece
de manche. Elle a fept pouces de long, & deux
tiers moins de largeur ; & elle eft fi applatie que
fa largeur furpàffe plus d’une fois fon épaiffeur.
Sa fubftance eft fort mince , aufli fragile que du
verre, & affez femblable à celle de la corne, dont
elle emprunte la Couleur & la tranfparencë.
Intérieurèmënt elle eft polie & luifante , mais au-
dehors fa furface eft hériflee vers l’extrémité d’un
grand nombre de pointes, pliéeS en cornets ou en
tuyaux cylindriques fort minces , de même nature
que la coquille, longs de quatre à cinq lignes &
relevées en angle de quarante - cinq dégrés. Ces
pointes en tuyaux doivent leur origine aux crene-
lures du manteau de l’animal, & quoiqu’elles paroif-
fent fans ordre , au premier abord, à caufe du petit
nombre des grandes qui fe montrent à leur extrémité
, néanmoins en examinant de près les veftiges
des premières qui ont été ufées ou brifées , on voit
qu’elles étoient difpofées fur quinze ou vingt rangs
paralleles à là longueur de la coquille.
Le ligament qui attache les deux battans, s’étend
depitis le fommet jufqu’aux trois quarts de leur longueur
, v ers l’extrémité fupérieure. On ne diftingue
■ aucune dent à la charnière.
L animal q'ui remplit cette coquille, a fon manteau
bordé d’énviron trente crenelures fort larges, .
au lieu des filets qu’ont les autres efpeces.
Ufages. Les Negrés font la pêche de \'apany en
Tome /.
plongeant dans le fond de la mer ; ils le détachent
avec un couteau des rochers où, il eft collé par un
grand nombre de fils affez femblables à ceux auxquels
les anciens donnoient le nom de byffus, mais
plus court. Sa chair eft très-bonne, fur-tout lorf*
qu’elle eft cuite & apprêtée ; elle eft fort goûtée
des Européens & des naturels du pays, f M. A d a n -
s o n . .) ’
APaNORMIA, (Géogr.) ville de l’ifle de Santorin,'
dans les plages de la Méditerranée,, que l’on nomme
en cet endroit mer de Candie. Elle a un port tres-
fpacieux, en forme de demi-lune , mais fi profond
qtî’il eft impoflible aux vaiffeaux de s’y mettre à
l’ancre. (C. A.)
A PARNI y (Géogr.) ancien peuple d’Afie, voifin
des Hyrcaniens, vers les bords de la mer Cafpienne,.
On croit que ce font lés Dai d’aujourd’hui, mieux
connus fous le nom de Petits Nogais. (C. A.)
AP ATI, (Géogr.). petite ville de Hongrie, dans le.
comte de Jarmat. Elle eft fur la riviere de.Carafna ,,
au lud du Tibiler ., à l ’eft du petit Varadiri , & au
nord-oueft de Samos'. Long. 4 4 . J 0 -, Ut. 48 . 5:
(C- a .) . V’ 4 '
APATÜROS , (Géogr.) nom d’un ancien bourg
de- la prefqu’ifle de Qoroçondama, entre le Pont-
Euxin '& le Palus Méotide. Vénus y avoit un temple
ou el-le etoit adorée fous le nom de frompeufe, parce
qu’elle avoit ufé d’artifice dans la guerre ejes dieux
contre les géans..(C. A . )
AP AV O RT EN, (Géogr?) nom d’une Contrée d’Afie
très-fertile & très-agréable, dans le Mawaralnahra,
à l’orient de la mer Cafpienne. C’eft là qu’Arface,
reftaurateur de l’empire des Parthes , fit bâtir Dura
ou D,aranm. ( C. A .)
À PARTÉ, f. m. ( Belles-Lettres») c’eft une des
licences accordées à Part dramatique. La vraifem-
blance en eft fondée fur cette fuppofition fans laquelle
il n’y auroit nulle vraifemblance dans la re-
prefentation théâtrale, qliele fpeftateur n’y eft prêtent
qu’en efprit. Cela pofé, .tout ce qu’on a dit
contre l’d porté tombe de lui-même. Il eft, fans doute ,
réellement impoflible que l’a&eur qui fe fait entendre
des ipedateurs ne fôit pas entendu des adeurs avec
lefquels il eft en feene ; mais dans l’hypothefe tacitement
convenue, les fpeàatéurs ne font point-là , ils
né font point à. telle dillanee , ils font physiquement
ablèns, leur préfence n’eft qu’idéale ; car fi on les
luppofoit-là, ils feraient vus, on n’agiroit point,
on ne parlerait point en leur préfence ; on parlerait
d’eux-, avec eux. Il y a donc dans cette hypo-
thefe abfence réelle des témoins de.l’a&ion. Or le
fpeclateur préfent en efprit, eft cenfé entendre là
voix de lad eu r , quelque foible & bas qu’en.foit
le fort, & lors mêmé qu’il n’eft pas entendu des
perlonnages qui font en fçene-,
Gleft cette hypothefe qu’on a perdue de vue ,
lorfqu’en mefurant les diftances , on a regardé
comme une invraifemblance théâtrale, qu’un acteur
Tût entendu de loin & ne le fût pas de plus
près. Voy. U n it é , Supplément. (M. Ma rmontel.)
Au fujetdes à pané, nous rapporterons une anecdote
connue ; elle pourra fournir une réflexion
utile. Racine, Moliere & la Fontaine étoient amis ,
comme on fait ; raffemblés un jour, la converfation
tomba fur les aparté; la Fontaine en foutenoit l’ufage
abfurde & contraire à toute vraifemblance; Racine
le défendoit; ladifpute devint vive, un enfant, un
homme naturel s’échauffe aifément; Moliere profitant
de ce moment d’agitation de la Fontaine , cria
à plufieurs reprifes : la Fontaine efl un coquin, fans que
celui-ci l’entendit : la Fontaine ayant fu Y à parti de
Moliere, fe confeffa vaincu.
Cette anecdote prouve , fans doute , que les â
parte font quelquefois dans la vrailemblance, même
p p'p