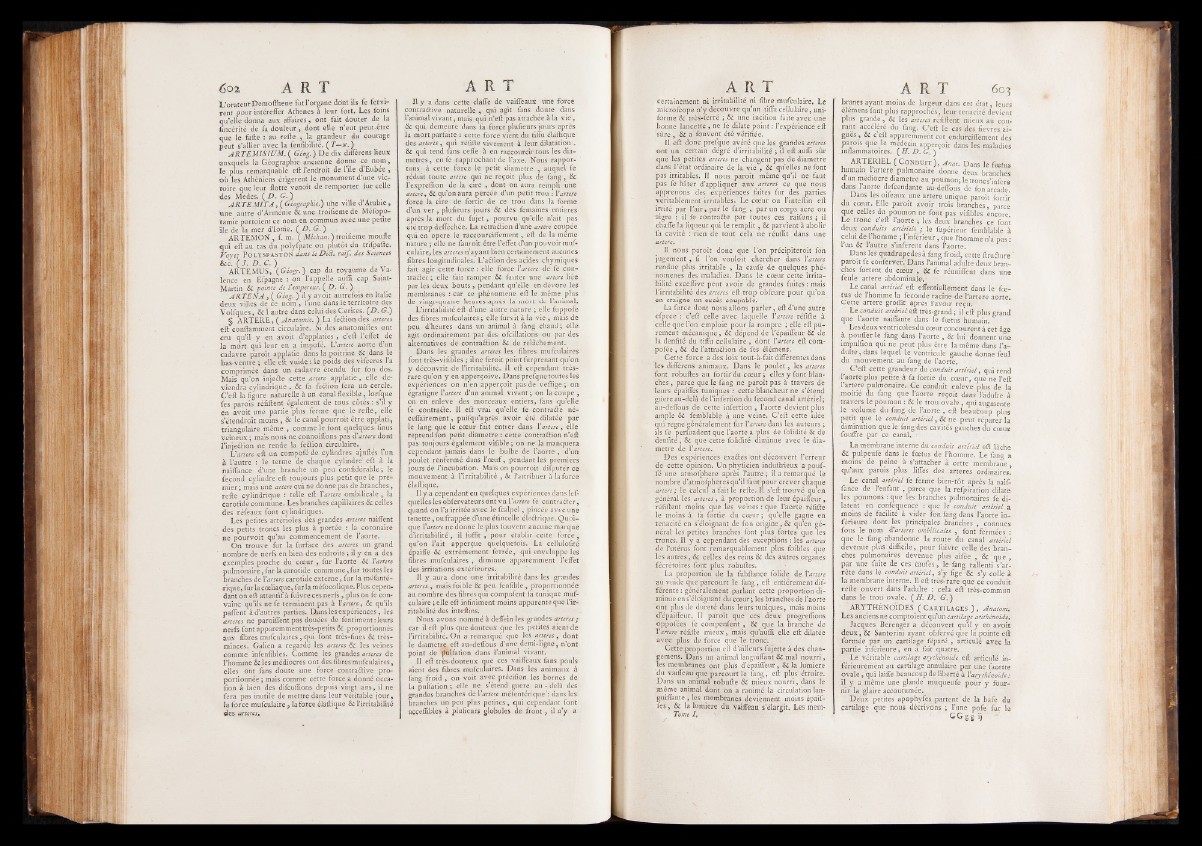
1 ,’orateurDemofthene 'fut l’organe dont ils fe feïyi-
rent pour intéreffer Athènes à leur fort. Les foins
qu’elle donna aux affaires, ont fait douter de la
fincérité de fa douleur, dont elle n’eut peut-être
que le fafte : au relie -, la grandeur du courage
peut s’allier avec la fenfibilité. ( T— N. )
ARTEMIS IUM. ( Gèog.) De dix diffèrens lieux
auxquels la Géographie ancienne donne ce nom,
îe plus remarquable eft l’endroit de l’île d Eubée ,
oîi les Athéniens érigèrent le monument d’une victoire
que leur flotte venoit de remporter fur celle
des Medes» ( D . G. )
A R TE MITA, ( Géographie.') uhe ville d’Arabie,
une autre d’Arménie & une troifieme de Méfopo-
tamie portaient ce nom en commun avec une petite
île de la mer d’Ionie. ( D, G. )
ARTEMON , f. m. ( Méchan. ) troifieme moufle
qui eft au tas du polyfpate ou plutôt du trifpafte.
Voye[ PoLYSPASTON dans le Dicl. raif. des Sciences
& c . ( 7. D. C. ) t
ARTEMUS, ( Géogr. ) cap du royaume de Valence
en Efpagne : on l’appelle aufli cap Saint-
Martin & pointe de l'empereur. (D . G .)
A RTE N A , ( Gèog. ) il y avoit autrefois en Italie
deux villes de ce nom , l’unè dans le territoire des
Volfques, & 1 autre dans celui des Cerites. (D . G.)
§ ARTERE, (Anatomie.) La fe&ion des arteres
eft conftamment circulaire. Si des anatomiftes ont
cru qu’il y en avoit d’applaties , c’eft l’effet de
la mort qui leur en a impofé. Vartere aorte d’un
cadavre paroît applatie dans la poitrine & dans le
bas-ventre ; elle eft vuide : le poids des vifceres l’a
comprimée dans un cadavre étendu fur fon- dos.
Mais qu’on injecte cette /irtere applatie, elle deviendra
cylindrique, & fa feftion fera un cercle.
C’eft la figure naturelle à un canal flexible, lorfque
fes parois réfiftent également de tous côtés : s’il y
en avoit une partie plus ferme que le refte, elle
s’étendroit moins, & le canal pourroit être applati,
triangulaire même , comme le font quelques-finus
veineux ; mais nous ne connoiffons pas d! artere dont
l ’inje&ion ne rende la feâion circulaire.
Vartere eft un compofé de cylindres ajuftés l’un
à l’autre : le terme de chaque cylindre' eft à la
naiffance d’une branche un peu confidérable ; le
fécond cylindre eft toujours plus petit que le premier;
mais une artere qui ne donne pas de branches,
refte cylindrique : telle eft Vartere ombilicale , la
carotide commune. Les branches capillaires & celles
des réfeaux font cylindriques.
Les petites artérioles des grandes arteres naiffent
des petits troncs les plus à portée : la coronaire
ne pourvoit qu’au commencement de l’aorte.
On trouve fur la furface des arteres un grand
nombre de nerfs en bien des endroits ; il y en a des
exemples proche du coeur , fur l’aorte & Vartere
pulmonaire, fur la carotide commune, fur toutes les
branches de Vartere carotide externe, fur la méfanté-
rique, fur la coeliaque, fur la méfocolique. Plus cependant
on eft attentif à fuivre ces nerfs , plus on fe convainc
qu’ils ne fe terminent pas à Vartere, & qu’ils
paffent à d’autres parties. Dans les expériences, les
arteres ne paroiffent pas douées de fentiment: leurs
nerfs fontapparemmenttrès-petits & proportionnés
aux fibres mufculaires, qui font très-fines & très-
minces. Galien a regardé les arteres & les veines
comme infenfibles. Comme les grandes arteres de
l’homme & les médiocres ont des fibres mufculaires,
elles ont fans doute une force contra&ive proportionnée
; mais comme cette force a donné occasion
à bien des difcuflions depuis vingt ans, il ne
fera pas inutile de mettre dans leur véritable jour,
la force mufculaire, la force élaftique & l’irritabilité
<dcs arteres•
Il y a .dans cette claie de vaiffeaux une forcé
contraclive naturelle , qui agit fànS doute dans
l’animal vivant, mais qui n’eft pas attachée à la v ie ,
&c qui demeure dans fa ,force plufieurs jours après
la mort parfaite : cette force vient du tiffu élaftique
d es arteres, qui réfifte vivement à leur dilatation .
& qui tend fans ceffe à en raccourcir tous les diamètres,
.en fe, rapprochant de l’axè. Nous rapportons;,^
cette force le petit diamètre , auquel fe
réduit toute artere qui ne reçoit plus de fang , 8c
î’expreffion de la cire , dont on aura rempli une
artere, & qu’on aura percée d’un petit trou : Vartere
forcé la cire; de fortir de ce trou dans la forme
d’un v e r , plufieurs jours & des femaines entières
après la mort du fujet, pourvu qu’elle n’ait pas
été trop defféchée. La rétraûion d’une artere coupée
•qui en opéré le raceourcifl'ement, eft de la même
nature ; elle ne fauroit être l’effet d’un pouvoir mufculaire,
les arteres n’ayant bien certainement aucunes
fibres longitudinales. L’aftiom des acides chymiques
fait agir cette force : elle force Vartere de fe contracter
; elle fait ramper & fauter une artere liée
par les deux bouts, pendant qii’elle en dévore les
membranes : car ce phénomène eft le même plus
de vingt-quatre heures après la mort de l ’animal.
L’irritabilité eft d’une autre nature ; elle fuppofe
des fibres mufculaires ; elle furvit à la vie , mais de
peu d’heures dans un animal à fang chaud; elle,
agit ordinairement par des ofcillations ou par des
alternatives de contraction & de relâchement.
Dans les grandes. arteres les fibres mufculaires
font très-vifibles ; il ne feroit point furprenant qu’on
y découvrît de l’irritabilité. Il eft cependant très-
rare qu’on y en apperçoive. Dans prefque toutes les
expériences on n’en apperçoit pas de veftige.; on
égratigne Vartere d’un animal vivant; on la coupe ,
on en enleve des morceaux entiers, fans qu’elle
fe - contracte. Il eft vrai qu’elle fe contracte né-
ceffairement, puifqu’après avoir été dilatée par
le fang que le coeur fait entrer dans Vartere, elle
reprend ion petit diamètre : cette contraction n’eft
pas toujours également vifible ; on ne la manquera
cependant jamais dans le bulbe de l’aorte , d’un
. poulet renfermé dans l’oe u f, pendant les premiers
jours de l’incubation. Mais on pourroit difputèr ce
mouvement à l’irritabilité , & l’attribuer à la force
élaftique^
Il y a cependant eu quelques expériences dans Ief-
quelles les obfervateursont vu Vartere fe contracter,
quand on l’a irritée avec le fcalpei, pincée avec une
tenette, ou frappée d’une étincelle éleCtrique. Quoique
Vartere ne donne le plus fouvent aucune marque
d’irritabilité, il fuffit , pour établir cette force,
qu’on l’ait apperçue quelquefois. La cellulofité
epaiffe & extrêmement ferrée, qui enveloppe les
fibres mufculaires , diminue apparemment l’èffet
des irritations extérieures.
Il y aura donc une irritabilité dans les grandes
arteres , mais foible & peu fenfible, proportionnée
au nombre des fibres qui compofent fa tunique mufculaire
; elle eft infiniment moins apparente que l’irritabilité
des inteftins.
Nous avons nommé à deffein les grandes arteres ;
car il eft plus que douteux que les petites aient de
l’irritabilité. On a remarqué que les arteres, dont
le diamètre eft au-deffous d’une demi-ligne, n’ont
point de *j$ftifation dans l’animal vivant.
Il eft très-douteux que ces vaiffeaux fans pouls
aient des fibres mufculaires. Dans les animaux à
fang froid , on voit avec précifion les bornes de
la puffation ; elle ne s’étend guère au - delà des
grandes branches dé Vartere mélentérique : dans les
branches un peu plus petites, qui cependant font
acceflibles à plufieurs globules de front, il n’y a
certainement ni irritabilité ni fibre mufculaire. Le
microfcopè n’y découvre qu’un tiffu cellulaire, uniforme
& très-ferré ; & une incifion faite avec une
bonne lancette , ne fe dilate point : l’expérience eft
sûre , & a fouvent été. vérifiée.
11 eft' donc prefque avéré que les grandes arteres
ont un certain dégré d’irritabilité ; il eft aufli sûr
que. les petites arteres ne changent pas de diamètre
dans l’état ordinaire de la vie , & quelles ne font
pas irritables. Il nous paroît même qu’il ne faut
pas fe hâter d’appliquer aux arteres ce que nous
apprenons des expériences faites fur des parties
véritablement irritables. Le coeur ou l’inteftin eft
irrité par l’air, par le fang , par un corps acre ou
'aigre : il fe contracte par toutes, ces raifons ; il
chaffe la liqueur qui le remplit, & parvient à abolir
fa cavité : rien de tout cela ne réuflit dans une
artere. ■
Il nous paroît donc que l ’on précipîteroit fon
jugement , fi l’on vouloit chercher dans Vartere
rendue plus irritable ,/ï’a calife de quelques phénomènes
des maladies. Dans le coeur cette irritabilité
exceffive peut avoir de grandes fuites : mais
l ’irritabilité des arteres eft trop obfcure pour qu’on
en craigne un excès coupable.
La force dont nous allons parler, eft d’une autre
efpece : c’eft celle avec laquelle Vartere réfifte à
celle que l’on emploie pour la rompre ; elle eft purement
mécanique, & dépend de l’épaiffeur & de
la denfité du tiffu cellulaire , dont Vartere eft com-
pofée , & de l’attraâion de fes élémens.
Cette force a des loix tout-à-fait différentes dans
les diffèrens animaux. Dans le poulet, les arteres
font robuftes au fôrtifdu coeur ; elles y font blanches
, parce que le fang ne paroît pas à travers de
leurs épaiffes tuniques : cette blancheur ne s’étend
güere au-delà del’infertion dit fécond canal artériel;
au-deffous de cette infertion , l’aorte devient plus
ample & femblable à une veine. C ’eft cette idée
qui régné généralement fur Vartere dans les auteurs ;
ils fe perluadent que l’aorte a plus de folidité & de
denfité, & que cette folidité diminue avec le diamètre
de Vartere.
Des expériences exaâes ont découvert l’erreur
de cette opinion. Unphyficien induftrieux a pouffé
une atmofphere après l’autre; il a remarqué le
nombre d’atmofpheres qu’il faut pour crever chaque
artere ; le calcul a fait le refte. Il s’eft trouvé qu’en
général les arteres, à proportion de leur épaiffeur,
réfiftent moins qUe les veines : que l’aorte réfifte
le moins à fa fortie du coeur ; qu’elle gagne en
ténacité en s’éloignant de fon origine, & qu’en général
les petites branches font plus fortes que les
troncs. Il y a cependant des exceptions : les arteres
de l’utérus font .remarquablement plus foibles que
les autres, & celles des reins & des autres organes
fécrétoires font plus robuftes.
La proportion de la fubftance folidë de Vartere
au vuide que parcourt le fang, eft entièrement différente
: généralement parlant cette proportion diminue
en s’éloignant du coeur; les branches de l’aorte
ont plus de dureté dans leurs tuniques, mais moins
d’épaiffeur. Il paroît que ces deux progreffions
oppofées fe compenfent , & que la branche de
Vartere réfifte mieux, mais qu’âuffi elle eft dilatée
avec plus de force que' le tronc.
Cette proportion eft d’ailleurs fûjette à des chan-
gemens. Dans un animal languiffant & mal nourri ,
les membranes ont plus d’épaiffeur, & la lumière
du vaiffeau que parcourt le lang, eft plus étroite.
Dans un animal robufte & mieux nourri, dans le
même animal dont on a ranimé la circulation lan-
guiffante , les membranes deviennent moins épàif-
le s , & la lumière du vaiffeau s’élargit. Les mem-
Tome I,
branes ayant moins de largeur dans cet état, leurs
élémens font plus rapprochés, leur ténacité devient
plus grande, & les arteres réfiftent mieux au courant
accéléré du fang. C’eft le cas des fievres aigues,
& ceft apparemment cet endurciffement des
parois que le médecin apperçoit dans les maladies
. inflammatoires. ( H. D. G. )
ARTERIEL ( C o n d u i t ) , Anat. Dans le foetus
humain 1 artere pulmonaire donne deux branches
d un médiocre diamètre au poumon; le tronc s’infer©
dans l’aorte defeendante au-deffous de fon arcade.
Dans les oifeaux une artere unique paroît fortir
du coeur. Elle paroît avoir trois branches, parce
que celles du poumon ne font pas vifibles encore.
Le tronc c eft l’aorte ; lés deux branches ce font
deux conduits artériels ; le fupérieur femblable à
celui de 1 homme ; 1 inferieur, que l’homme n’a pas t
l’un & l’autre s’inferent dans l’aorte.
Dans les quadrupèdes à fang froid, cette ftru&ure'
parbît'fe conferver. Dans l’animal adulte deux bran-'
ches fortent du coeur , & fe réunifient dans un«
feule artere abdominale.
Le canal artériel eft effentiellement dans le foetus
de 1 homme la fécondé racine de l’artere aorte.
Cette artere groffit après l’avoir reçu/
Le conduit artériel eft très-grand ; il eft plus grand
que l’aorte naiffante dans le foetus humain.
Les deux ventriculesdu coeur concourent à cet âge
à pouffer le fang dans l’aorte , & lui donnent une
impulfion qui ne peut plus être la même dans l’adulte,
dans lequel le ventricule gauche donne feul
du mouvement au fang de l’aorte.
G,eft cette grandeur du conduit artériel, qui rend
l’aorte plus petite à fa fortie du coeur, que ne l’eft
l’artere pulmonaire-Ce conduit enleve plus de la
.moitié du fang que l’aorte reçoit dans l’adulte à
travers le poumon : & le trou ovale , qui augmente
le volume du fang de l’aorte , eft beaucoup plus
petit que le- conduit artériel, & ne peut réparer la
diminution que le fang des cavités gauches du coeur
fouffre par ce canal. •
La membrane interne du conduit artériel eft lâche
& pulpeufe dans le foetus de l’homme. Le fang a
moins de peine à S'attacher à cette membrane
qu’aux parois plus liffes des arteres ordinaires!
Le canal artériel fe ferme bien-tôt après la naïf-
Tance de l’enfant , parce que la refpiration dilate
les poumons : que les branches pulmonaires fe. dilatent
en conféquencé : que le conduit artériel a
moins de facilité à vider fon fang dans l’aorte inférieure
dont les principales branches' , connues
fous le nom d'arteres ombilicales , font fermées :
que le fang abandonne la route du canal artériel
devenue plus difficile, pour fuivre celle des branches
pulmonaires devenue plus aifée , & que ,
par une fuite de ces caufes, le fang rallenti s’arrête
dans le conduit artériel, s’y fige & s’y colle à
la membrane interne. Il eft très-rare que ce conduit
refte ouvert, dans l’adulte : cela eft très-commun
dans le trou ovale. ( H. D. G. )
ARYTHÉNOÏDES ( C a r t i l a g e s ) , Anatoni,
Les anciens ne comptoient qu’un cartilage arithénoïde.
Jacques Berenger a découvert qu’il y en avoit
deux, & Santorini ayant obfervé que la pointe eft
formée par un cartilage fépàré , articulé avec la
partie inférieure, eh a fait quatre.
Le véritable cartilage arythènoïde eft articulé inférieurement
au cartilage annulaire par une facette
ovale, qui laiffe beaucoup de liberté à Varythènoïde ;
il y a même une glande muqueufe pour y fournir
la glaire accoutumée-
Deux petites apophyfes, partent de la bafe du
cartilage que ..nous décrivons ; l’une pofè fur le
G G g g ij