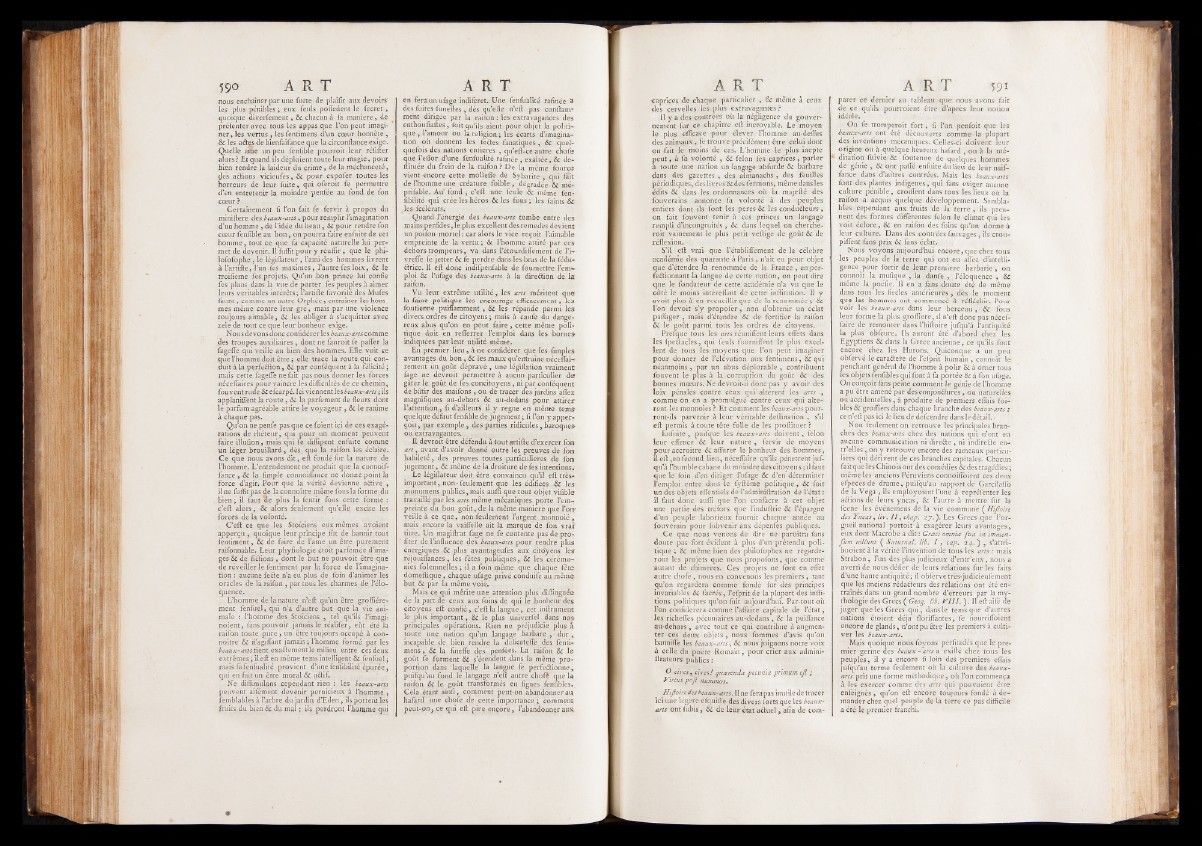
nous enchaîner par une forte de plaifir aux devoirs'
les plus pénibles ; eux feuls pofledent le fecret,
quoique diverfement, & chacun à fa maniéré, de
prélenter avec tous les appas que l ’on peut imaginer
, les vertus , les fentimens d’un coeur honnête ,
& les aélgs de bienfaifance que la circonftance exige.
Quelle arhe un peu fenfible, pourrait leur réfifter
alors? Et quand ils déploient toute leur magie, pour
bien rendre la laideur du crime, de la méchanceté,
des aétions vicieufes, & pour expofer toutes les
horreurs de leur fuite, qui oferoit fe permettre
d’en entretenir la moindre penfée au fond de fon
coeur ?
Certainement fi Fon fait fe fervir à propos du
miniftere des beaux-arts, pour remplir l’imagination
d’un homme, de l’idée du beau, & pour rendre fon
coeur fenfible au bon, on pourra faire enfuite de cet
homme, tout ce que fa capacité naturelle lui permet
de devenir. Il fuffit.pour y réufîïr, que le phi-
lofofophe ; le légiflateur , l’ami des hommes livrent
à l’artifte, l’un lès maximes, l’autrefes loix, & le
troifieme fes-projets. Qu’un bon prince lui confie
fes plans dans la vue de porter fes peuples à aimer
leurs véritables intérêts; l’artifle favorifé des Mufes
faura, comme un autre Orphée, entraîner les hommes
même contre leur gré, mais par une violence
toujours aimable, & les obliger à s’acquitter avec
zele de tout ce que leur bonheur exige.
Nous devons donc confidérer les beaux-arts comme
des troupes auxiliaires, dont ne fauroit fe paffer la
fagefle qui veille au bien des hommes. Elle voit ce
que l’homme doit être ; elle trace la route qui conduit
à la perfection, & par conféquent à la félicité ;
mais cette fagefle ne fait pas nous donner les forces
néceffaires pour vaincre les difficultés de ce chemin,
fouvent rude & efearpé. Ici viennent les beaux-arts ; ils
applaniffent la route, & la parfement de fleurs dont
le parfum agréable attire le voyageur , & le ranime
à chaque pas.
Qu’on ne penfe pas que ce foient ici de ces exagérations
de rhéteur, qui pour un moment peuvent
faire illufion, mais qui fe diflipent enfuite Comme
un léger brouillard, dès que la raifon les éclaire.
Ce que nous avons dit, eft fondé fur la nature de
l’homme. L ’entendement ne produit que la connoif-
fance , & la fimple connoiflance ne donne point la-
force d’agir. Pour que la vérité devienne aélive ,
il ne fuffit pas de la connoître même fous la forme du
bien ; il faut ne plus la fentir fous cette forme :
c’eft alors, & alors feulement qu’elle excite les
forces, de la volonté.
. C’eft ce que les Stoïciens euxmêmes avqient
apperçu , quoique leur principe fut de bannir tout
fentiment, & de faire de l’ame un être purement
raifonnable. Leur phyfiologie étoit parfemée d’images
& de fi étions, dont le but ne pouyoit être que
de réveiller le fentiment par la force de l’imagination
: aucune feéte n’a eu plus de foin d’animer les
oracles de la raifon , par tous les charmes de l’éloquence.
L’homme de la nature n’eft qu’un être grofliére-
ment fenfuel, qui n’a d’autre but que la vie animale':
l’homme des Stoïciens , tel qu’ils l’imagû
noient, fans pouvoir jamais le réalifer, eût été la
raifon toute pure, un être toujours occupé à .connoître
& ri’agiflant jamais ; l’homme formé par les
beaux-arts tient exaétement le milieu entre cesdeux
extrêmes ; il eft en même tems intelligent & fenfuel ;
mais fa fenfualité provient d’une fenfibilité épurée,
qui en fait un être moral & aftif.
Ne diffimulons cependant rien : les beaux-arts
peuvent aifément devenir pernicieux à l’homme ,
femblables à l’arbre du jardin d’Eden, ils portent les
fruits du bien & du mal ; ils perdront l’homme qui
,en ferâ un ufage indiferet. Une fenfualité rafinée a
des fuites funeftes , dès qu’elle n’eft pas conftam-
piént dirigée par la railôn :■ les extravagances des
,entho.u fiaft es , foit qu’ils aient pour objet la politique
, l’amour ou la religion ; les écarts d’imagination
oii donnent les fe.a.es ■ fanatiques , & quelquefois
des nations entières , qu’eft-ce autre chofe
que l’eflbr d’une fenfualité rafinée , exaltée, & de*
ftituée du frein de la rajfon ? De la même fource
vient encore cette môllefle de Sybarite , qui fait
de l’homme une créature foible , dégradée & mé-
prifable. Au’ fond , c’eft une feule & même fenfibilité
qui crée les héros & les fous ; les faints &C
^les.fcélérats^
Quand l’énergie des beaux-arts tombe entre des
mains perfides, le plus excellent desremedes devient
un poifon mortel : car alors le vice reçoit l’aimable
empreinte de la vertu; & l’homme attiré par ces
dehors trompeurs, va dans l’étourdiffement de l’i-
yrelfe fe jetter & fe perdre dans les bras de la fédu-
élrice. 11 eft donc indifpenfable de foumettre l’emploi
& l’ufage des beaux-arts à la direction de la
raifon.
Vu leur extrême utilité , les arts méritent quel
la faine politique les encourage efficacement, les
foiitienne puiflamment , & les répande parmi les
divers ordres de citoyens ; mais à caufe du dangereux
abus qu’on en peut faire , cette même politique
doit en reflerrer l’emploi dans les bornes
indiquées par leur utilité même.
En premier lieu, à ne confidérer que les fimpîes
avantages du bon, & les maux qu’entraîne néceflai-
rement un goût dépravé, une légiflation vraiment
fage ne devrait permettre à. aucun particulier de
gâter le goût de. fes concitoyens, ni par conféquent
de bâtir des maifons , ou de tracer des jardins allez
magnifiques au-dehors & au-dedans pour attirer
l ’attention, fi d’ailleurs il y régné en même tems
quelque défaut fenfible de jugement ; fi l’on y.apper-
çoit, par exemple, des parties ridicules, baroques
ou ëxtrayagantes.
ïl devroit être défendu à tout artifte d’exercer fon
art, avant d’avoir donné outre les preuves de fon
habileté, des preuves toutes particulières de fon
jugement , & même de la droiture de fes intentions.
Le légiflateur doit, être convaincu qu’il eft très-
important, non-feulement que les édifices & les
monumens publics, mais aum qite tout objet vifible
travaillé par les arts même mécaniques porte l’empreinte
du bon goût, de la même maniéré que l’on
veille à ce que, non-feulenient l’argent monnoié ,
mais encore la vaiffelle ait la marque de fon vraï
titre. Un magiftrat fage ne' fe contente pas de profiter
de Finfluence des beaux-arts pour rendre plus
énergiques & plus avantageufes aux citoyens les
réjouiflances, les fêtes publiques, & les cérémonies
folemnelles ; il a foin même que chaque fête
domeftique, chaque ufage privé conduife au même
but & par la même voie.
Mais, ce qui mérite une attention plus diftinguée
de la part de ceux aux foins de qui le bonheur des
citoyens eft confié, c’eft la langue, cet infiniment
le plus important, & le.plus univerfel, dans nos
principales opérations. Rien ne préjudicie plus à
toute une nation, qu’un langage barbare , du r,
incapable de bien rendre la délicateffe des fentimens
, & la fineffe ,des penfées. La raifon & le
goût fe forment & s’étendent dans la même proportion
dans 'laquelle la langue fe perfectionne,
puifqu^au fond le langage n’eft autre chofé que 1^
raifon .& le goût transformés en lignes fenfibles..
Cela étant ainfi, comment peut-on . abandonner an
hafârd une chofe de cette importance ; commènt.
peut-on, ce qui eft pire encore, l’abandonner aux.
caprices de chaque particulier I même à ceux
des cervelles les plus extravagantes?
Il y a.des.contrées oh la négligence du gouvernement
fur ce chapitre eft incroyable. Le moyen
le plus efficace pour élever l’homme au-deflus
des animaux, fe trouve précifément être celui dont
on fait le moins de cas. L’homme lé; plus inepte
peut, à fa volonté , & félon fes caprices, parler
à toute une nation un langage abfurde & barbare
dans des gazettes , des almanachs , des feuilles
périodiques, des livres & des lèrmons, même dans les
édits & dans lès ordonnances oh la majefté des
fouverains ,annonce fa volonté à des. peuples
entiers dont ils font les peres & les conduéleurs,
on fait fouvent tenir à.'ees princes un langage
rempli d’incongruités, & dans lequel on cherche-
roit vainement le plus petit veftige de goût & de
réflexion.
S’il eft vraï que l’établiffèment de la célébré
académie des quarante à Paris , n’ait eu pour objet
que d’étendre la renommée de la France , en perfectionnant
là langue de cette nation, on peut dire
que le fondateur de cette académie n’a vu que le
côté le moins intéreflant de cette inftitution. Il y
avoit plus à! en recueillir que de la renommée ; &
l’on devoit s’y propofer, non d’obtenir un éclat
paflager , mais d’étendre & de fortifier la ^raifon
& le goût parmi tous les ordres de citoyens.
Prefque tous les arts réunifient leurs effets dans
les fpeétacles, qui feuls fourniffent le plus excellent
de tous ' les. moyèns que l’on peut imaginer
pour donner de l’élévation aux fentimens, & qui
néanmoins, par un abus déplorable , contribuent
fouVent le plus à la corruption du goût & des
bonnes moeurs. Ne devrait-il donc pas y avoir des
loix pénalés contre ceux qui'altèrent les arts ,
comme on en a. promulgué contre ceux- qui altèrent
les monnoies? Et comment les beaux-arts pourront
ils parvenir à leur véritable deftination , s’il
eft permis à toute tête folle de les proftituer ?
Enfuite , puifque les beaux-arts doivent, félon
leur eflènee & leur nature , fervir de moyens
pour accroître & aflurer le bonheur des hommes,
il e ft, en fécond lieu, néceflaire qu’ils pénètrent juf-
qu’à l’humble cabane du moindre des citoyen s ; il faut
que le foin d’en diriger Fufagè & d’en déterminer
l’emploi entre dans le fyftême politique , & foit
un des objets effentiels de l’adminiftration de l’état :
il faut donc aufli que Fon confacre à cet objet
une partie des tréfors que l’induftrie & l’épargne
d’un, peuple laborieux fournit chaque' année au
fouverain pour fubvenir aux dépenfes publiques.
Ce que nous venons de dire ne paroîtra fans
doute pas fort évident à plus d’un prétendu politique
; & même bien des philofophes ne regarderont
les projets que nous propofons, que comme
■ autant de chimères. Ces projets ne font en effet
autre chofe , nous en convenons les premiers , tant
qu’on regardera comme fondé fur des principes
invariables & facrés, l’efprit de la plupart des infti*
tions politiques qu’on fuit aujourd’hui. Par-tout oh
l’on corifiderera comme l’affaire capitale de l’état,
les richefles pécuniaires au-dedans , & la puiffance
au-dehors, avec tout ce qui contribue à augmenter
ces deux objets, nous fommes d’avis qu’on
banniffe les beaux-arts, & nous joignons notre voix
à celle du poète Romain, pour crier aux admini-
ftrateurs publics :
O cives, cives J quarenda pecunia primurn ejl ;
Virtüs pojî nurnmos.
Hijloire des beaux-arts. Il ne fera pas inutile de tracer
ici une légère éfquiflê des divers forts que les beaux-
arts ont fübis, & de leur état aû u e l, afin de comparer
ce dernier au tableau que nous avons fait
de ce qu’ils pourroient être d’après leur notion
idéale.
On fe tromperoit fo r t , fi l’on penfoit que les
beaux-arts ont été découverts comme' la plupart
des inventions mecaniqu.es.. C.elles-'ci doivent leur
origine ou à quelque heureux hafard , ou à la méditation
fuiviey & foutenue de quelques hommes
de génie , & q n t paffé enfuite du lieu de leurnaif-
fance dans d’autres contrées. Mais les beaux-arts
font des plantes indigènes, qui fans exiger aucune
culture pénible , croiffent dans tous les lieux oh la
raifon a acquis quelque développement. Semblables
cependant aux fruits de la terre , ils prennent
des formes différentes félon le climat qui les
voit; éclore, & en raifon des foins qu’on donne à
leur culture. Dans des. contrées fàuvages, ils crou-
piffent fans prix & fans éclat. .
Nous voyons aujourd’hui encore, que chez tous
les peuples de la terre qui ont eu aflèz d’intelligence
pour fortir de leur première barbarie , on
connoît la mufique ,f;la danfe l’éloquence , &c
même la poëfie. 11 en a fans doute été de même
dans tous; les fiecles antérieures, dès le moment
que les hommes ont commencé à réfléchir. Pour
voir les beaux-arts dans leur berceau, & fous
leur forme la plus grofîiere,il n’eft donc pas nécef-
faire de remonter dans lliiftoire jufqu’à l’antiquité
la plus obfcure. Ils auront été d’abord chez les
Egyptiens & dans la Grece ancienne, ce qu’ils font
encore chez lès Hurons. Quiconque a un peu
obfervé le caraétere de l’efprit humain , connoît le
penchant général de l’homme à polir & à orner tous
les objets fenfibles qui font à fa portée & à fon ufage.
On conçoit fans peine comment le génie de l’homme
a pu être amené par des conjonctures, ou naturelles
ou accidentelles, à produire de premiers eflais foi-
bles & groflîers dans chaque branche des beaux-arts :
ce n’eft pas ici le lieu de defeendre dans le détail. »
Non feulement on retrouve les principales branches
des beaux-arts chez des nations qui n’ont eu
aucune communication ni direéte , ni indirefte en-
tr’elles, on y retrouve encore des rameaux particuliers
qui dérivent de ces branches capitales. Chacun
fait que les Chinois ont des comédies & des tragédies ;
même les anciens Péruviens connoifloienr ces deux
efpeces de drame, puifqu’au rapport de GarcÜaflb
de la Vega , ils èmployoient l’une à repréfenter les
a étions de leurs yncas, & l’autre à mettre fur la
feene les événemens de la vie commune ( Hijloire
des Yncas, liv. / / , chap. uy. ). Les Grecs .que l’orgueil
national portoit à exagérer leurs avantages,
eux dont Macrobe a dit : Grceci omnia fua in immen-
fum tollunt ( Saturnal. lib. I , cap. 24. ) , s’attri-
buoient à la vérité l’invention de tous les arts : mais
Strabon, l’un des plus judicieux d’entr’eux, nous a
averti de nous défier de leurs relations fur les faits
d’une haute antiquité; il obfervetrès-judicieufement
que les anciens rédaéleurs des relations ont été entraînés
dans un grand nombre d’ erreurs par la mythologie
des Grecs ( Geog. lib. V III. ). Il eft aifé de
juger que les Grecs qui, dans le tems que d’autres
nations étoient déjà floriflantes, fe nourriffoient
encore de glands, n’ont pu être les premiers à cultiver
les beaux-arts.
Mais quoique nous foyons perfuadés que le premier
germe des beaux-arts a exifté chez tous les
peuples, il y a encore fi loin -des premiers eflais
jufqu’aii terme feulement oh la culture des beaux-
arts prit une forme méthodique, oh l’on commença
à les exercer comme des arts qui pouvoient être
enfeignés , qu’on eft encore toujours fondé à demander
chez quel peuple de là terre ce pas difficile
a été le premier franchi.