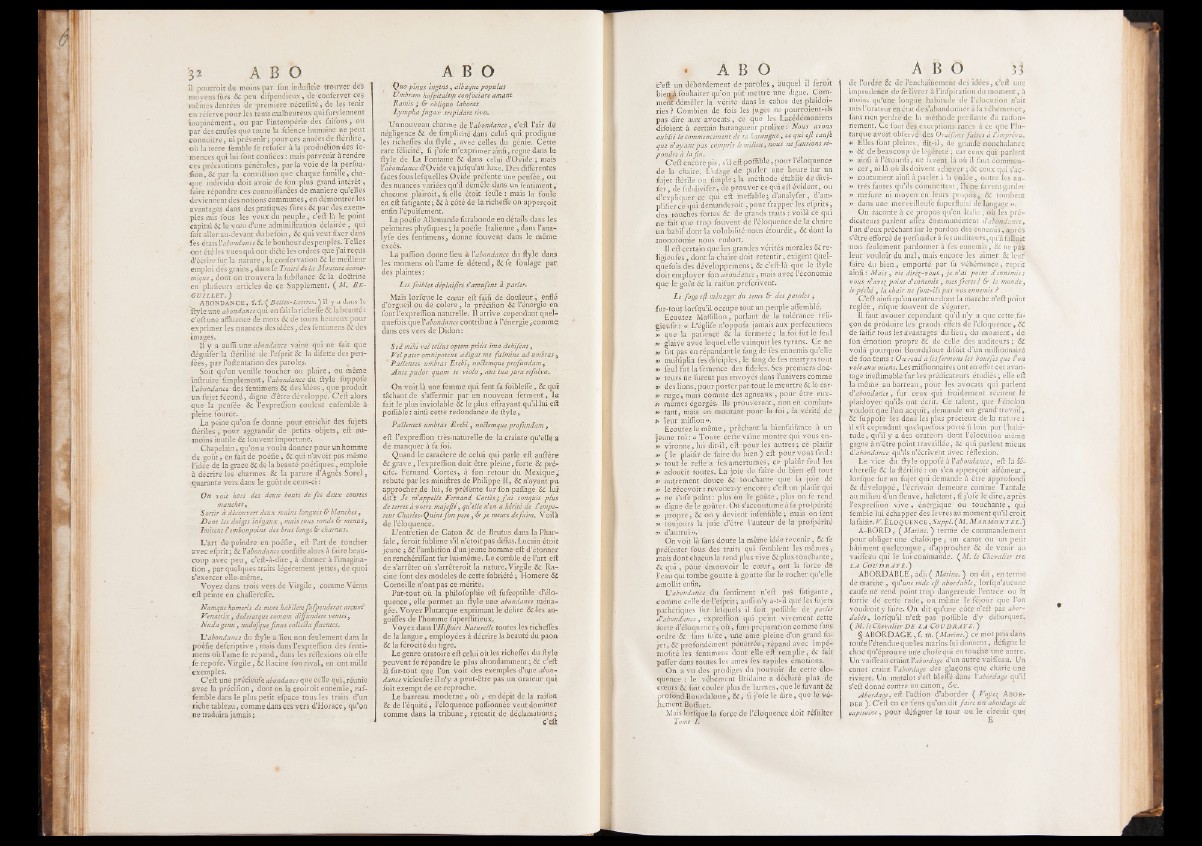
3^ A B O
il pourroir du moins par foninduftrie trouver-deS
moyens fûrs & peu difpendieux, de conferver ces
mêmes denrées de première néceffité, de les tenir
en réfervepour les teins malheureux quifurviennent
inopinément, ou par l’intempérie des faifons, ou
par des caufes que toute la fcienee humaine ne peut
connoître, ni prévenir; pour ces années de ftérilité,
où la terre femble fe refufer à la production des fe-
mences qui lui font confiées : mais parvenir à rendre
ces précautions générales, parla voie de la perfua-
jfion, 8c par la conviction que chaque famille, chaque
individu doit avoir de fon plus grand intérêt,
faire répandre ces connoiffances de maniéré qu’elles
deviennent des notions commîmes, en démontrer les
avantages dans des pratiques fîires 8c par des exemples
mis fous les yeux du peuple , c’eft là le point
capital 8c le voeu d’une adminiftration éclairée , qui
fait aller au-devant du befoin, 8c qui veut fixer dans
fes états V abondance 8c le bonheur des peuples. T elles
ont été les vues qui ont diCté les ordres que j’ai reçus
d’écrire fur la nature, la confervation 8c le meilleur
emploi dés grains, dans fe Traité de la Mouture économique
, dont on trouvera la fubfiance 8c la doCtrine
en plufieurs articles de-ce Supplément. ( M. B e-
GUILLET. )
Abondance , f. f. ( Belles-Lettres. ) il y a dans le
ftyle une abondance qui en faitlaricheffe & labeaute :
c’eft une affluence de mots & de tours heureux pour
exprimer les nuances des idées, des fentimens 8c des
images. -
Il y a aufli une abondance vaine qui ne fait que
déguifer la ftérilité de l’efprit Sc la difette des pen-
fées, par l’oftentation des parole^.
Soit qu’on veuille toucher ou plaire, ou même
inftruire fimplement, l’abondance du ftyle fuppofe
Y abondance des fentimens 8c des idées, que produit
un fujet fécond, digne d’être développé. C’eft alors
que la penfée & l’expreflïon coulent enfemble à
pleine fourçe. . -
La peine qu’on fe donné pour enrichir des fujets
ftériles, pour aggrandir de petits objets, eft au-
moins inutile 8c fouvent importune.
Chapelain, qu’on a voulu donner pour un homme
de goût, en fait de poéfie, & qui n’avoit pas même
l ’idée de la grâce & de la beauté poétiques, emploie
à décrire les charmes 8c la parure d’Agnès Sorel,
quarante vers dans le goût de ceux-ci :
On voit hors des deux bouts de fes deux courtes
manches,
Sortir à découvert deux mains longues & blanches,
Dont les doigts inégaux, mais tous ronds & menus,
Imitent Vembonpoint des bras longs & charnus.
L ’art de peindre en poéfie, eft l’art dë toucher
avec efprit ; 8c Y abondance confifte alors à faire beaucoup
avec peu , c’eft-à-dire, à donner à l’imagination
, par quelques traits légèrement jettés, de quoi
s’exercer elle-même.
Voyez dans trois vers de Virgile, comme Vénus
eft peinte en chaffer'efle.
Namque humeris de more habilem fufpenderat arcmri
Venatrix, dederatque comam dijfundere vends,
Nuda genu, nudofqueJinus collecta jluentes.
U abondance du ftyle a lieu non feulement dans la
. poéfie defcriptive , mais dans l’expreflîon des fentimens
oùl’ame fe répand, dans les réflexions où elle
fe repofe. Virgile, & Racine fon rival, en ont mille
exemples.
C ’eft une précieufe abondance, que celle qui, réunie
avec la précifion, dont on la croiroit ennemie, raf-
femble dans le plus petit efpace tous les traits d’un
riche tableau, comme dans ces vers d’Horace, qu’on
ne traduira jamais :
A B O
Quo pinus ingens, albaque populus
Umbram hofpitalem confociare amant
Ramis ; & obliquo laborat
Lympha fugax trepidare rivo.
Un nouveau charme de Y abondance, c’eft l’air de'
négligence 8c de fimplicité dans celui qui prodigue
les richefles du ftyle , avec celles du génie. Cette
rare félicité', fi j’ofe m’exprimer ainfi, régné dans le
ftyle de La Fontaine & dans celui d’Ovide ; mais
Y abondance d’Ovide va jufqu’au luxe. Des différentes
faces fous lefquelles Ovide préfente une penfée,, oii
des nuances variées qu’il démêle dans un fentiment,
chacune plairoit, fi elle étoit feule : mais la foule
en eft fatigante; 8c à côté de la richeffe on apperçoit
enfin l’épuifement.
La poéfie Allemande furabonde en détails dans les
peintures phyfiques ; la poéfie Italienne , dans l’ana-
lyfe des fentimens, donne fouvent dans le même
excès. ■
La paflîon donne lieu à Yabondance du ftyle dans
les momens où l’ame fe détend, 8c fe foulage par,
des plaintes :
Les foibles déplaifirs s’amufent à parler.
Mais lorfque le coeur eft faifi de d o u le u ren flé
d’orgueil ou de colere, la précifion -8c l’énergie en
font l’expreflion naturelle. 11 arrive cependant quelquefois
que Y abondance contribue à l’énergie, comme;
dans ces vers de Didon:
Sed mïhi vel tellus optem priùs ima dehifcat,
Velpater omnipotens adigat me fulmine ad umbras g
* Pallentes umbras Erébi, noctemque profundam*
Ante pudôr quam te violo, aùt tua jura refolvo.
On voit là une femme qui fent fa foibleffe, & qui
tâchant de s’affermir par un nouveau ferment, le
fait le plus inviolable 8c le plus effrayant qu’il lui eft
poflible : ainfi cette redondance de ftyle,
Pallentes umbras Erebi , noctemque profundam ,
eft l’expreflion très-naturelle de la crainte qu’elle a
de manquer à fa foi.
Quand le caraétere de celui qui parle eft auftère
8c grave, l’expreflion doit être pleine, forte 8c pré-,
cife. Fernand Cortès, à fon retour du Mexique,'
rebuté par les miniftres de Philippe II, 8c n’ayant pu
approcher jde lui, fe préfente fur'fon paffage 8c lui
dit': Je niappelle Fernand Cortès; f a i conquis plus
de terres à votre majejlé, quelle rien a hérité de Ü,empereur
Charles-Quint fon pere, & je meurs defaim. Voilà
de l’éloquence. >
L’entretien de Caton 8c de Brutus dans la Phar-
fale, feroit.fublime s’il n’étoitpas diffus. Lucain étoit
jeune ; & l’ambition d’un jeune homme eft d’étonner
en renchériflant fur lui-même. Le comble de l’art eft
de s’arrêter où s’arrêteront la nature. Virgile 8c Racine
font des modèles de cette fobriété ; Homere 8c
Corneille n’ont pas ce mérite.
Par-tout où la philofophie eft fufceptible d’éloquence
, elle permet au ftyle une' abondance ménagée.
Voyez Plutarque exprimant le délire 8c4 es an-,
goiffes de l’homme fuperftitieux.
Voyez dans YHifioire Naturelle toutes les richefles
de la langue, employées à décrire la beauté du paon
8c la férocité du tigre.
Le genre oratoire eft c elui où les richefles du ftyle
peuvent fe répandre le plus abondamment ; 8c c’eft
là furrtout que l’on voit des exemples d’tqie abondance
vicieufe : il n’y a peut-être pas un orateur qui
foit exempt de ce reproche.
Le barreau moderne, où , en dépit de la raifon
& de l’équité, l’éloquence paflionnée veut dominer
comme dans la tribune, retentit de déclamations; c’eft
• A B O
fc’eft un débordement de paroles , duquel il feroit
bieiÿjà fouhaiter qu’on pût mettre une digue. Com-
mem démêler la vérité dans le cahos des plaidoiries
? Combien de fois les juges ne pourroient-ils
pas dire aux avocats, ce que les Lacédémoniens
difoient à certain harangueur prolixe : Nous avons
oublié le commencement de ta harangue, ce qui ejl cauft
qiie ri ayant pas compris le milieu, nous lie f aurions repondre
a la fin. ■
C’eft encore pis, s’il eft poflible, pour l’eloquence
de là chaire. L’ufage de parler une heure fur un
fujet ftérile ou Ample ; la méthode établie de divi-
f e r , de fubdivifer, de prouver ce qui èft évident, ou
d’expliquer ce qui eft ineffable; dartalyfer, damplifier
ce qui demanderoit, pour frapper les efprits,
des touches fortes & de grands traits : voilà ce qui
ne fait que trop fouvent de l’éloquence de la chaire
un babil dont la volubilité nous étourdit, & dont la
monotomie nous endort.
Il eft certain que les grandes vérités morales & re-
ligieufes, dont la chaire doit retentir, exigent quelquefois
des développemens ; 8c c’eft-là que le ftyle
doit employer fon abondance, mais avec l’ecônomie
que le goût 8c la raifon prefcrivent.
Le fage eft ménager du tems & des paroles ;
jfur-tout lorfqu’il occupe tout un peuple affeniblé.
•Ecoutez Maflillon, parlant de la tolérance reli-
fjieùfe : « L’églife n’oppofa jamais aux perféeutions
s) que la patience & la fermeté; la .foi fut le feul
»> glaive avec lequel elle vainquit les tyrans. Ce rte
>» fût pas en répandant le fane de fes ennemis qu’elle
multiplia fes difciples, le fang de fes martyrs tout
feul fut la femence des fideles'. Ses piremiers doc-
teurs fie furent pas envoyés dans l’univers comme
dès lions, pour porter par-tout le meurtre & le car-
■ *> nage, mais comme des agneaux, pour être eux-
37 mêmes égorgés. Ils prouvèrent, non en combat-
» tant, mais en mourant pour la fo i , la vérité de
*> leur million ». > .
Ecoutez le mêriiè, prêchant la bienfaifànte a un
jeune roi : « Toute cette vaine montre qui vous en-
» vironne, lui dit-il, eft pour les autres; cë plaifir
» ( le plaifir de faire du bien ) eft pour vdUS feul :
tout le refte a fes amertumes, ce plaifir feul les
adoutit toutes. Là joie de faire du bien èft tout
5> autrement douce & touchante que la joie dé
■ y, lè recevoir : revenez^ éric'ore; c’eft un plaifir qui
» ne s\ife point : plus ôri le goûte, plus on fe rend
digne de le goûter. On s’accoutume à fa profpérite
a» propre, & on y devient infënfible ; mais on fënt
» toujours la joie d’être l’àliteur dé la profpérité
2» d’autrui».1
On voit là fans doute la même idée revenir, &: fe
préfenter fous, des traits qui femblent les mêmes ,
mais dont chacun la rend plus vive & plus, touchante ;
& q u i, pour émouvoir le coeur, ont la forcé dë
Teau qui tombe goutte à goutte fur le rocher qü’éllè
amollit enfin.
\Jabondance du fentiment n’eft pas fatigante ,
comme celle de l’efprit; aufii n’y a-t-il que lès fujets
pathétiques fur lefquels il foit poflible dé parler
d’abondance, expreflibri qui peint vivement cette
forte d’éloquence, o ù , fans préparation comme fans
ordre & fans fuite, Urtë ame pleine d’un grand fuje
t, & profondément pénétrée, répand avec impé-
tuofité les fentimens dont elle eft remplie, & fait
paffer dans toutes les âmes fes rapides émotions.
On a vu des prodigës du pouvoir de cette élo*
quence : le véhément Bridaine a déchire plus de
coeurs & fait couler plus de larmes, que le favant &
profond Bourdalbue, fi j’ofe le dire, que le véhément
Bpffuet.
: Mais lorfque la force de l’élôquence doit réftilter
Tonie L
A B Ö
de l’ordre & de l’enchâîfiement des! idées, c’efl: une
imprudence de fe livrer à l’infpiration du moment, à
moins qu’une longue habitude de l’élocution n’ait
mis l’orateur en état de s’abandonner à fa véhémence ;
fans rien perdre de la méthode preffante dti raifon-
nemenr. Ce font des exceptions rares à ce que Plutarque
avoit obfervé des O raifons faites à Cimprévu.
« Elles font pleines, dit-il, de grande nonchalance
» & de beaucoup de légèreté ; car ceux qui parlent
» ainfi à l’étourdi, rie favent là où il faut cômmen-
» cé r, ni là où ils doivent achever ; & ceux qui s’ac-
» côutument ainfi à parler à la v o lé e , outre les au-
» très fautes qu’ils commettent, ils ne favent garder
» mefure ni moyen en leurs propos, & tombent
» dans une mervèilleufe fuperfluité de langage».
On fâconte à dé propos qu’en Italie , Où les prédicateurs
parlent affez communément <Yabondancey
l’un d’eux prêchant fur le pardon des ennemis, après
s’être efforcé de perfuader à fes auditeurs, qu’il fàlloit
non feulement pardonner à fes ennemis, 8c ne pas
leur vouloir du mal, mais encore les aimer 8c leur
faire du bieri, emporté par fa véhémence, reprit
ainfi : Mais , nie diré^-vous ,ye n’ai point J ennemis:
vous ri ave£ point d'enhemis , mes frerts ! & le monde ,
le péché , la chair ne font-ils pas vós ennemis i
C ’eft ainfi qu’un orateur dont la rriarche n’eft point
réglée, rifque fouvent de s’égarer.
11 faut avouer cependant qu’il n’y a que cette,façon
de produire les grands effets de l’éloquence , 8c
de fâifir tou$ les avantages du lieu, du moment, dé
fon émotion propre 8c de celle des auditeurs ; 8c
voilà- pourquoi Bourdàloue difoit d’un mifliOrinairé
de fon tzm s iO n rend à fes fermons lés bourfesque fon
vole aux mieàs. Les miflionnair’es ont en effet cet avantage
iriéftimable fur les prédicateurs étudiés ; elle eft
la même au barreau, pour les avocats qui parlent
üabondance, fur ceux qui froidement récitent le
plaidoyer qu’ils ont écrit. Ce talent, que Fénelon
vouloir que l’on acquît, demande un grànd'travail,
8c fuppofé les donif lès plus précieux de la nature i
il eft cependant quelquefois pörté fi loin par l’habitude
, qu’il y a des orateurs dont 1’éloéutiöp même
gagne àn’être point travaillée, 8c qiù parlent mieux
üabondance qu’ils n’écrivent avec réflexion.
Le vice du ftyle oppofé à Y abondance, eft là fé-
chereffe 8c la ftérilité : on s’en apperçoit aifément i
lorfque fur un fujet qui demande à être approfondi
8c développé, l’écrivain demeure comme Tantale
au milieu d’un fleuve, haletant, lî- j’ofe le dire, après
l’expreflion v iv e , énergique ou touchante, qui
femble lui échapper des Ievres au moirierit qu’il croit
la faifir, V. Éloquence , Suppl. (AL Mà r m o n t e l .)
A-BÖRD,- ( Mariné. ) ternie de commandement
pour Obliger une chàlo'upe ,■ un canot ou un petit
bâtiment quelco'nquè, d’approcher 8c de venir au
vaifleàu qui lé lui coriimànde. (AL le Chevalier DE
L A G ô Ü D R À Y Ê i')
ABORDABLE, àdji ( Màrine. ) Ori dit, en terme
de marine , qu’w/ze rude ejl abordable^ Iorfqu’aucune
caufé ne rend point trop dangerëufe l’entrée ou là
fortie dè cette fade, où même le féjoùr que l’on
voudroit y faite. On dit qu’une côte n’eft pas abordable
, lorfqü’il n’eft pas poflible d’y débarquer.
( M. lé Chevalier DE LA COUDRÀYÈ. )
§’ ABO RDAGE, f. ni. (Marine.) ce mot pris dans
tOufe' l’étendue que les marins lui donnent, défigne le
chod qu’éprouve une chofe qui en touche une autre.
Un vaifleau craint Y abordage d’un autre vaifleau. Un
canot craint VaboYdage des glaçons que chârie une
riviere. Un matelot s’eft blefle dans Y abordage qu’if
s’eft donné contre un canon, &c.
Abordage,- èft l’aéHon d’aborder ( Voye^ ABORDER
). C’eft en ce fens qu’on dit faire un abordage dè
capitaine, pour défigrier lè tour ou le circuit que